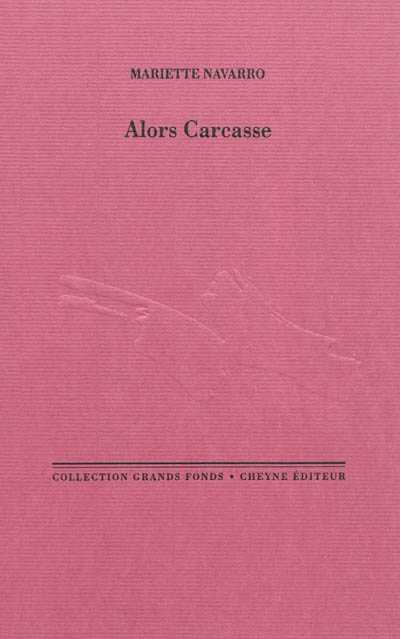Livres-Addict.fr
Toutes les critiques livres de Livres-Addict.fr
"L'Envoleuse" de Laure des Accords (Verdier)
Laure des Accords ne nous raconte pas une histoire selon un mode classique et une progression linéaire, elle nous égare et nous plonge dans un fouillis confus de sensations dont il nous appartient de démêler l'écheveau. Les temps, les époques se percutent, les émotions se catapultent. C'est une histoire d'amour plurielle et des plus singulières qui se multiplie, se diffracte, se partage dans le temps et entre les corps. Romain et Guillemette, en bout de course, en bord de mort, se remémorent, en épisodes saillants et sensations aiguës, l'amour qui, depuis l'enfance, les unit. Ils ont dû, pour trouver le chemin vers l'autre, surmonter des écueils, conjurer des impossibilités.(suite)
"L'envers des autres" de Kaouther Adimi (Actes Sud)
 C'est
un entrelacs de voix cassées, éraillées, parfois caracoleuses et
bondissantes mais toujours fragiles, toujours prélevées sur le
tranchant du péril. C'est
un texte d'une beauté amère et désolée. C'est un sang véhément, violent
même, qui irrigue ces voix mais la vie qui bat dans ces corps est une
vie captive, une vie sans exutoire. C'est
un texte qui met en scène et en voix les enfants de l'Algérie
contemporaine et ces enfants-là sont gravement désaxés.(suite)
C'est
un entrelacs de voix cassées, éraillées, parfois caracoleuses et
bondissantes mais toujours fragiles, toujours prélevées sur le
tranchant du péril. C'est
un texte d'une beauté amère et désolée. C'est un sang véhément, violent
même, qui irrigue ces voix mais la vie qui bat dans ces corps est une
vie captive, une vie sans exutoire. C'est
un texte qui met en scène et en voix les enfants de l'Algérie
contemporaine et ces enfants-là sont gravement désaxés.(suite)
"Corps volatils" de Jakuta Alikavazovic (L'Olivier)
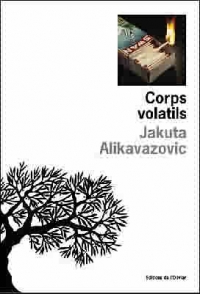 C'est un
livre en
apesanteur, peut-être même un livre sur l'apesanteur. Les personnages
tiennent à peine au sol, ils semblent toujours en passe de s'évaporer
et ce n'est donc pas un hasard si le narrateur, Colin, tire sa
subsistance du trafic de narcotiques qu'il effectue pour le compte de
Quentin, son colocataire, ami et accessoirement médecin véreux. Colin,
donc, fournit en produits illicites des femmes vaporeuses, des
élégantes poreuses...(suite)
C'est un
livre en
apesanteur, peut-être même un livre sur l'apesanteur. Les personnages
tiennent à peine au sol, ils semblent toujours en passe de s'évaporer
et ce n'est donc pas un hasard si le narrateur, Colin, tire sa
subsistance du trafic de narcotiques qu'il effectue pour le compte de
Quentin, son colocataire, ami et accessoirement médecin véreux. Colin,
donc, fournit en produits illicites des femmes vaporeuses, des
élégantes poreuses...(suite)
"Petit éloge des petites filles" d'Eva Almassy (Folio Gallimard)
 Eva
Almassy parle des petites filles comme personne. Elles apparaissent,
ciselées sous sa plume, plus vraies que nature. Les fictives et les
réelles.Car être une petite fille, c'est toute une affaire et
ensuite, c'est l'affaire d'une vie que de chercher à restituer, à
ressusciter cet état au plus juste, que de restaurer le lien avec ce
monde enfui (enfoui ?), tout de périlleux enchantements. (suite)
Eva
Almassy parle des petites filles comme personne. Elles apparaissent,
ciselées sous sa plume, plus vraies que nature. Les fictives et les
réelles.Car être une petite fille, c'est toute une affaire et
ensuite, c'est l'affaire d'une vie que de chercher à restituer, à
ressusciter cet état au plus juste, que de restaurer le lien avec ce
monde enfui (enfoui ?), tout de périlleux enchantements. (suite)
"Anna la nuit" de José Alvarez (Grasset)
 C'est
un récit colchique. Un texte fleur-vénéneuse qui prend racine en vous
et diffuse loin dans le corps ses pousses et son magnétisme funestes.
Il
y a un parfum à la Huysmans, des raffinements corrompus, une jouissance
perverse à étreindre la noirceur, un vif plaisir à se gorger de délices
décadentes. Mais
c'est aussi et d'abord un hymne éperdu à la
femme aimée et perdue. Cantate et thrène. Cadence incantatoire et
Cantique des cantiques ébouillanté, versé vif dans le chaudron des
ténèbres. (suite)
C'est
un récit colchique. Un texte fleur-vénéneuse qui prend racine en vous
et diffuse loin dans le corps ses pousses et son magnétisme funestes.
Il
y a un parfum à la Huysmans, des raffinements corrompus, une jouissance
perverse à étreindre la noirceur, un vif plaisir à se gorger de délices
décadentes. Mais
c'est aussi et d'abord un hymne éperdu à la
femme aimée et perdue. Cantate et thrène. Cadence incantatoire et
Cantique des cantiques ébouillanté, versé vif dans le chaudron des
ténèbres. (suite)
"Liquide" de Philippe Annocque (Quidam)
Voici un
texte d'une
frappante et flagrante originalité. Un texte qui emprunte, pour évoquer
les sujets éternels (l'amour, l'origine, l'identité, la mort), des
voies inusitées. Un texte qui avance par capillarité
thématique
et compose, peu à peu, par versement de mots, cousinage, alliage et
contagion de sens, une étrange et envoûtante mosaïque. (suite)
"Liège, oui" de Joanne Anton (Allia)
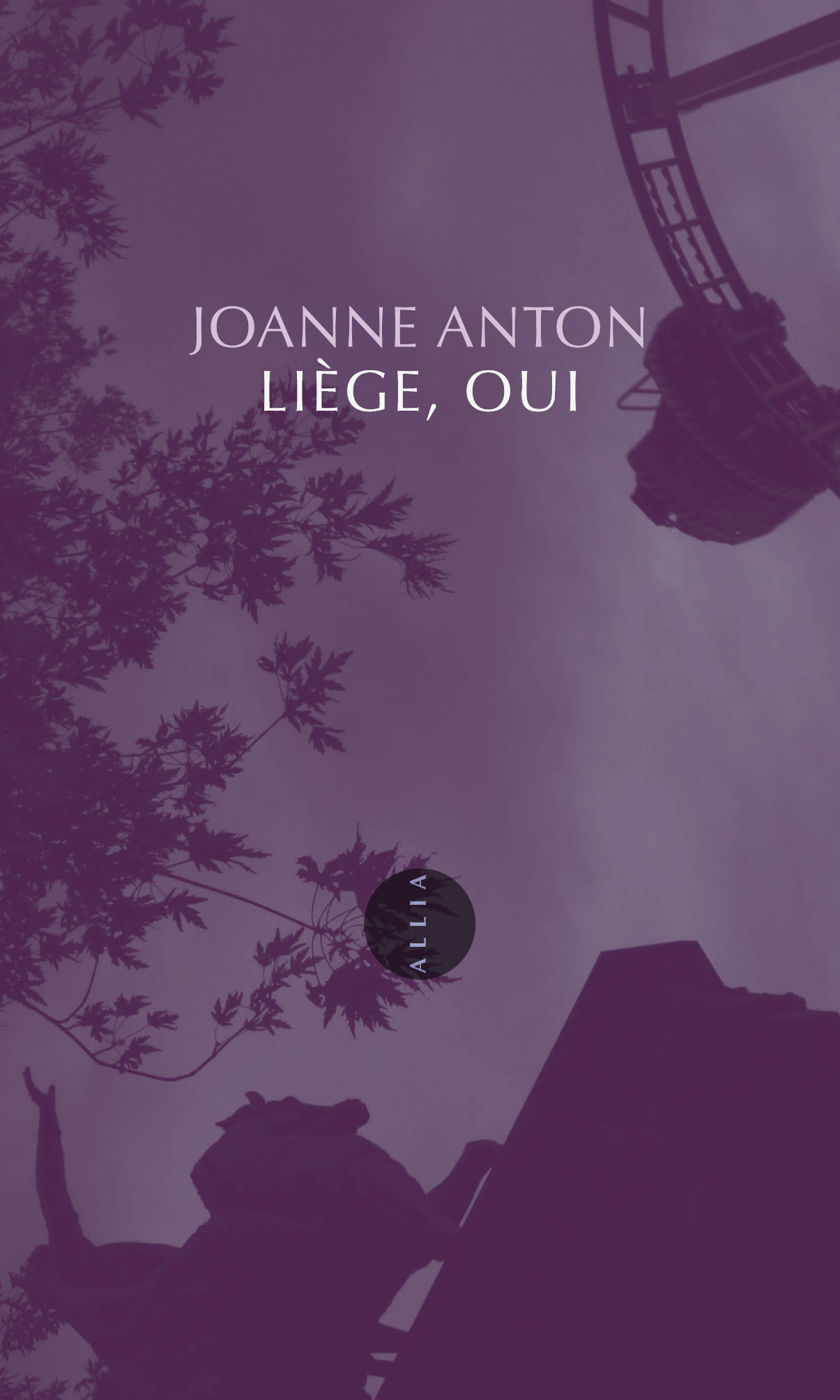 Joanne Anton nous
entraîne au fil
d’une quête identitaire qui se déploie à travers un prisme particulier.
Celle
qui parle est une identité révoltée contre la convention qui,
tyranniquement,
replie une personne sur ses origines et, singulièrement, ses origines
géographiques. Ce que la narratrice de Joanne Anton récuse, c’est son
appartenance à la ville de Liège et ses connexions supposées avec elle.
La narratrice a élu
domicile à
Paris où elle s’est exilée volontairement. Elle a beau avoir quitté
Liège
depuis une bonne quinzaine d’années, les renouements, sporadiques et
aléatoires, avec son berceau originel continuent de constituer, chaque
fois,
une épreuve. (suite)
Joanne Anton nous
entraîne au fil
d’une quête identitaire qui se déploie à travers un prisme particulier.
Celle
qui parle est une identité révoltée contre la convention qui,
tyranniquement,
replie une personne sur ses origines et, singulièrement, ses origines
géographiques. Ce que la narratrice de Joanne Anton récuse, c’est son
appartenance à la ville de Liège et ses connexions supposées avec elle.
La narratrice a élu
domicile à
Paris où elle s’est exilée volontairement. Elle a beau avoir quitté
Liège
depuis une bonne quinzaine d’années, les renouements, sporadiques et
aléatoires, avec son berceau originel continuent de constituer, chaque
fois,
une épreuve. (suite)
"Le Moi-peau" de Didier Anzieu (Dunod)
Il faut lire "Le Moi-peau". C'est bien plus qu'un livre de théorie psychanalytique, c'est un tissage de mots qui crée du trouble et du sens, du lien et du liant, qui avive et qui panse. Le postulat (génial et génialement étayé) de Didier Anzieu est que la peau n'est pas cette enveloppe neutre et purement fonctionnelle à quoi nous tendons à la réduire mais qu'elle est une entité psychique à part entière et que c'est à partir des informations qu'elle enregistre dans la prime enfance que se constitue la personnalité. (suite)
"A ciel ouvert" de Nelly Arcan (Seuil)
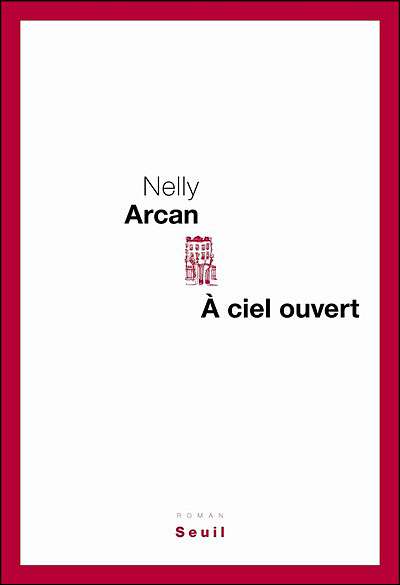 C'est
une histoire d'aujourd'hui. Une fable qui est aussi une radioscopie.
Aliénation scalpellisée. Nelly Arcan s'était livrée en pâture dans ses
deux premiers textes ("Putain" et "Folle") auscultant tour à tour la
condition de prostituée et la dureté voire l'impossibilité des rapports
amoureux. Elle délaisse ici le matériau purement autobiographique pour
le récit romanesque mais elle n'en poursuit pas moins son exploration
des états-limite dans lesquels la société contemporaine précipite les
femmes mais aussi les hommes. (suite)
C'est
une histoire d'aujourd'hui. Une fable qui est aussi une radioscopie.
Aliénation scalpellisée. Nelly Arcan s'était livrée en pâture dans ses
deux premiers textes ("Putain" et "Folle") auscultant tour à tour la
condition de prostituée et la dureté voire l'impossibilité des rapports
amoureux. Elle délaisse ici le matériau purement autobiographique pour
le récit romanesque mais elle n'en poursuit pas moins son exploration
des états-limite dans lesquels la société contemporaine précipite les
femmes mais aussi les hommes. (suite)
"Tromba" de Ben Arès (maelström reevolution)
 "Tromba" est un texte
qui défile et s'effile sur le tranchant d'une quête qui est aussi une
errance,
une immersion et une perdition consentie. Il est constitué de
deux volets,
deux parties qui souterrainement se
répondent et donnent la parole, successivement, d'abord à une instance
masculine puis à des voix féminines. C'est un homme donc,
"L'Etranger", qui, au commencement, s'enfonce dans la touffeur d'une
île malgache. Il est assailli d'impressions, criblé de sensations crues
et il
recense, étourdi, couleurs, odeurs, saveurs, rythmes, balancements,
déhanchements qui dévalent et lui entrent dans le corps. (suite)
"Tromba" est un texte
qui défile et s'effile sur le tranchant d'une quête qui est aussi une
errance,
une immersion et une perdition consentie. Il est constitué de
deux volets,
deux parties qui souterrainement se
répondent et donnent la parole, successivement, d'abord à une instance
masculine puis à des voix féminines. C'est un homme donc,
"L'Etranger", qui, au commencement, s'enfonce dans la touffeur d'une
île malgache. Il est assailli d'impressions, criblé de sensations crues
et il
recense, étourdi, couleurs, odeurs, saveurs, rythmes, balancements,
déhanchements qui dévalent et lui entrent dans le corps. (suite)
"On sait l'autre" d'Edith Azam (P.O.L.)
Edith Azam est une corsaire du verbe. Elle sabre la syntaxe et se joue souverainement des codes de la narration. Elle nous jette, ex abrupto, à l'intérieur d'un "on" indistinct et singulier qui se trouve en état d'alerte. Un "on" reclus en ses appartements et perclus d'angoisse, soulevé de panique car il s'attend au pire, s'apprête à se voir assiégé par "l'autre", figure pressante, oppressante, figure de la menace par excellence. S'engage alors un ballet préventif et défensif qui consiste, pour le narrateur, à parer les coups, à colmater les bèches sensibles, à conforter les bases précaires de la forteresse érigée. (suite)
"Décembre m’a ciguë" d’Edith Azam
(P.O.L)
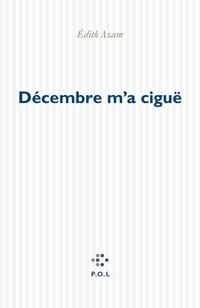 Edith Azam doit
ressembler à un
elfe fouineur, un faune aux oreilles très pointues. Et très pointées.
Car elle
perçoit tout et capte même les infrasons, les vibrations pulsatiles,
les
pulsations sur basse continue, les mots inarticulés, imprononcés ou
proférés
dans une langue indéchiffrable, une langue qui n’est pas la commune,
celle dite
de la tribu. Et c’est une écriture
comme une
arbalète qui ajuste son tir et jamais ne manque sa cible. Et c’est
comme un
haïku prolongé et qui s’attache à dire le plus improbable. Car le texte
tout
entier n’est rien d’autre qu’une manœuvre dilatoire et conjuratoire. (suite)
Edith Azam doit
ressembler à un
elfe fouineur, un faune aux oreilles très pointues. Et très pointées.
Car elle
perçoit tout et capte même les infrasons, les vibrations pulsatiles,
les
pulsations sur basse continue, les mots inarticulés, imprononcés ou
proférés
dans une langue indéchiffrable, une langue qui n’est pas la commune,
celle dite
de la tribu. Et c’est une écriture
comme une
arbalète qui ajuste son tir et jamais ne manque sa cible. Et c’est
comme un
haïku prolongé et qui s’attache à dire le plus improbable. Car le texte
tout
entier n’est rien d’autre qu’une manœuvre dilatoire et conjuratoire. (suite)
"Vita (La vie légère)" de Leonor Baldaque (Gallimard)
 C'est
un livre de terre, de feu, mais d'air surtout. Un texte suspendu, qui
s'élève indéfiniment comme gonflé à l'hélium et tient, en apesanteur,
sur le fil de l'improbable, dans les méandres de songeries qui sont
tout sauf creuses. C'est un texte d'éther et d'envol, une
miniature ciselée qui plane très haut mais qui, cependant, fait la part
belle aux sens, qui est tout entier une traversée sensorielle, qui ne
tient que par le recensement infatigable des sensations à vif. (suite)
C'est
un livre de terre, de feu, mais d'air surtout. Un texte suspendu, qui
s'élève indéfiniment comme gonflé à l'hélium et tient, en apesanteur,
sur le fil de l'improbable, dans les méandres de songeries qui sont
tout sauf creuses. C'est un texte d'éther et d'envol, une
miniature ciselée qui plane très haut mais qui, cependant, fait la part
belle aux sens, qui est tout entier une traversée sensorielle, qui ne
tient que par le recensement infatigable des sensations à vif. (suite)
"Les jours clairs" de Zsuzsa Bank (éditions Piranha)
C'est un texte plein d'eaux troubles, de lumières tamisés, de temps suspendus. C'est un poème en prose ou une prose quasi céleste qui couvre l'étendue d'un long roman et qui, cependant, pas un instant ne distille l'ennui ni ne donne le sentiment d'être abstruse, hermétique, affectée ou superflue. C'est si beau, si déchirable, qu'on tremble presque face à tant d'inespéré. Ce sont des enfances dansées, des adolescences cabriolées, des lumières déposées et tout le tragique de l'existence filigrané, piqué en points si délicats qu'ils éraflent à peine. Et pourtant ils s'impriment profond, soulèvent silencieusement et bouleversent. Et, toujours, la grâce préside à toute chose. (suite)
"Le nageur" de Zsuzsa Bank (Christian Bourgois)
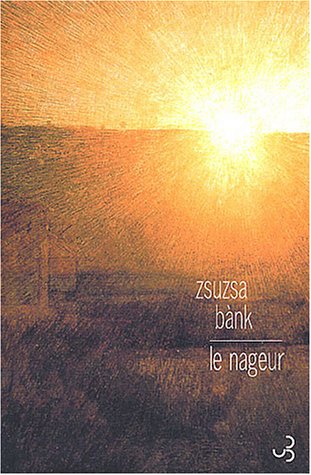 C'est
une voix pâle et presque atone, une voix d'eau étale qui traverse ce
livre étrange et délicat. C'est la voix de Kata, une enfant qui raconte
la Hongrie de 1956, le départ brutal de sa mère pour l'Ouest et le
désemparement qui s'empare des autres membres de la famille : le père,
abîmé dans le silence et dans ses rêveries hautement nicotiniques,
Isti, le petit frère singulier qui entend des choses "qui ne
produisent pas de son" et elle-même, fidèle vigile, observatrice et
accompagnatrice des deux autres. (suite)
C'est
une voix pâle et presque atone, une voix d'eau étale qui traverse ce
livre étrange et délicat. C'est la voix de Kata, une enfant qui raconte
la Hongrie de 1956, le départ brutal de sa mère pour l'Ouest et le
désemparement qui s'empare des autres membres de la famille : le père,
abîmé dans le silence et dans ses rêveries hautement nicotiniques,
Isti, le petit frère singulier qui entend des choses "qui ne
produisent pas de son" et elle-même, fidèle vigile, observatrice et
accompagnatrice des deux autres. (suite)
"Versions de Teresa" d'Andrés Barba (Christian Bourgeois)
C'est un texte de trouble, de tremblements et de voix alternées. C'est la chair empêchée dont les poussées véhémentes, bien que muselées, éclosent de singulière Ensorfaçon. C'est l'histoire d'une double fascination, d'un corps plein qui est aussi un corps en creux, qui cristallise attentes, émois, fantasmes et qui, malgré lui, s'agrège et s'accapare deux vies. C'est la sombre mélopée, la douloureuse lancinance du désir qui descend loin dans les mots et dans la chair. (suite)
"Emmaüs" d’Alessandro
Baricco
(Gallimard)
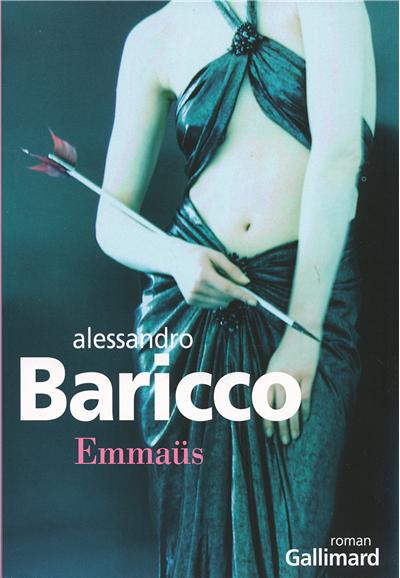 C’est un texte de
fièvre et de
saccades. Un incendie qui court sous la peau et entre la couture serrée
des
mots. C’est une incantation
chuchotée,
un récit tout ensemble cru et pudique, tissé de poésie en creux et de
lyrisme
rentré. C’est l’histoire d’un
envoûtement
pluriel. Une sorcellerie proliférante. Racontée par une voix seule mais
qui en
charrie d’autres, se gonfle, s’augmente et s’irrigue d’elles. Un peu à
la
manière d’un chœur antique. Et c’est aussi, cette voix multiple, la
troublante
indistinction de l’adolescence. (suite)
C’est un texte de
fièvre et de
saccades. Un incendie qui court sous la peau et entre la couture serrée
des
mots. C’est une incantation
chuchotée,
un récit tout ensemble cru et pudique, tissé de poésie en creux et de
lyrisme
rentré. C’est l’histoire d’un
envoûtement
pluriel. Une sorcellerie proliférante. Racontée par une voix seule mais
qui en
charrie d’autres, se gonfle, s’augmente et s’irrigue d’elles. Un peu à
la
manière d’un chœur antique. Et c’est aussi, cette voix multiple, la
troublante
indistinction de l’adolescence. (suite)
"La femme d'un homme qui" de Nick Barlay (Quidam éditeur)
 C'est
un texte qui fulgure lentement. Un alliage insolite entre trépidation
et ressassement. Entre percées fracassantes et délitement. Entre
brusques accélérations, sorties de route inopinées et enfoncements dans
les tourbes et les eaux les plus troubles. C'est une histoire qui
déroute tout du long, à chaque angle, à chaque
carrefour, mais c'est surtout une langue sans équivalent qui restitue,
avec une précision métronomique, le tracé sinueux d'une quête à la
fois heurté et comateuse. (suite)
C'est
un texte qui fulgure lentement. Un alliage insolite entre trépidation
et ressassement. Entre percées fracassantes et délitement. Entre
brusques accélérations, sorties de route inopinées et enfoncements dans
les tourbes et les eaux les plus troubles. C'est une histoire qui
déroute tout du long, à chaque angle, à chaque
carrefour, mais c'est surtout une langue sans équivalent qui restitue,
avec une précision métronomique, le tracé sinueux d'une quête à la
fois heurté et comateuse. (suite)
"Mr" d'Emma Becker (Denoël)
Emma Becker est une casse-cou revendiquée et même auto-proclamée. Une frondeuse et une fonceuse, une cascadeuse immodérée. Une qui n'hésite pas à défoncer et milite en faveur de la vie éventrée. Une acrobate et une forcenée. De la vie et de l'écriture. Une intempérante dévoreuse d'hommes. De sexe. D'amours libertines et débridées. A vingt ans à peine, cette singulière jeune fille affiche un parcours existentiel impressionnant agrémenté de quelques intéressantes fêlures à l'âme qui le rehaussent.(suite)
"Les neiges bleues" de Piotr Bednarski (Autrement)
 Ce
petit livre est un viatique, un livre thaumaturge qui prodigue soins et
réconfort. Un recel de mots qui pansent et qui exaltent. Et ces
bienfaits sont prodigués par Petia un jeune enfant qui vit dans des
conditions tragiques et fait précocément l'épreuve du mal. Il est
parqué, avec sa mère, dans un camp, antichambre du goulag, soumis à la
juridiction et à la folie de Staline. Mais il vit aussi soumis à une
constante irradiation, celle dispensée par sa mère dont la brauté est
telle qu'elle foudroie quiconque passe à proximité d'elle. (suite)
Ce
petit livre est un viatique, un livre thaumaturge qui prodigue soins et
réconfort. Un recel de mots qui pansent et qui exaltent. Et ces
bienfaits sont prodigués par Petia un jeune enfant qui vit dans des
conditions tragiques et fait précocément l'épreuve du mal. Il est
parqué, avec sa mère, dans un camp, antichambre du goulag, soumis à la
juridiction et à la folie de Staline. Mais il vit aussi soumis à une
constante irradiation, celle dispensée par sa mère dont la brauté est
telle qu'elle foudroie quiconque passe à proximité d'elle. (suite)
"L’enfant" de Raymond Bellour
(P.O.L)
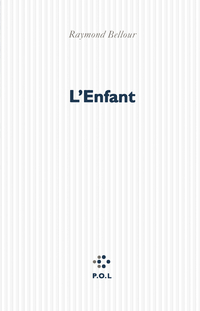 C’est un texte
composite, composé
de fragments galvaniques et sidérés. C’est l’enfance à bride abattue et
par
bribes arrachées, par éclats de sensations exhumées, commuées en
compositions
vibratoires et fulgurales. C’est
« l’enfant »
indéterminé, général, durassien et extrêmement singulier, qui vient à
nous fort
de son royaume, de son univers farouche et réservé. C’est une voix
blanche qui se
pose sur la page comme un croquis parfait, un croquis qui est au faîte,
qui est
la cime, qui est l’accomplissement dans son inachèvement même. Un
croquis qui
porte l’inachèvement à son point de perfection. (suite)
C’est un texte
composite, composé
de fragments galvaniques et sidérés. C’est l’enfance à bride abattue et
par
bribes arrachées, par éclats de sensations exhumées, commuées en
compositions
vibratoires et fulgurales. C’est
« l’enfant »
indéterminé, général, durassien et extrêmement singulier, qui vient à
nous fort
de son royaume, de son univers farouche et réservé. C’est une voix
blanche qui se
pose sur la page comme un croquis parfait, un croquis qui est au faîte,
qui est
la cime, qui est l’accomplissement dans son inachèvement même. Un
croquis qui
porte l’inachèvement à son point de perfection. (suite)
"G." de John Berger (Seuil)
 "G."
est l'un de ces livres contondants : de quelque côté que vous le
preniez, il résiste, heurte, entaille. Livre inconfortable, il projette
le lecteur de-ci de-là, sur les bas-côtés, dans les hauteurs, dans les
fondrières et les chemins creux sans jamais lui laisser le loisir de
souffler, de trouver un semblant de répit le long d'une route au tracé
rectiligne. (suite)
"G."
est l'un de ces livres contondants : de quelque côté que vous le
preniez, il résiste, heurte, entaille. Livre inconfortable, il projette
le lecteur de-ci de-là, sur les bas-côtés, dans les hauteurs, dans les
fondrières et les chemins creux sans jamais lui laisser le loisir de
souffler, de trouver un semblant de répit le long d'une route au tracé
rectiligne. (suite)
"Ressusciter" de Christian Bobin (Gallimard)
 Ce
qui advient, quand on ouvre un livre de Christian Bobin, c'est qu'on
ferme tous les autres. Et on le fait avec un soulagement infini. On
sort enfin de toute démonstration, qu'elle soit virtuose ou pas. On est
dans le vif, le nu, le feu qui éclaire et réchauffe. Dès les
premiers mots de Bobin, tous les autres livres semblent caducs, tous
les autres livres tombent en désuétude et en poussière. On a subitement
le sentiment, très rare avec un livre, de rentrer au pays, de revenir
chez soi, d'être délivré de l'exil et de l'égarement dans lesquels tous
les autres livres nous plongent. (suite)
Ce
qui advient, quand on ouvre un livre de Christian Bobin, c'est qu'on
ferme tous les autres. Et on le fait avec un soulagement infini. On
sort enfin de toute démonstration, qu'elle soit virtuose ou pas. On est
dans le vif, le nu, le feu qui éclaire et réchauffe. Dès les
premiers mots de Bobin, tous les autres livres semblent caducs, tous
les autres livres tombent en désuétude et en poussière. On a subitement
le sentiment, très rare avec un livre, de rentrer au pays, de revenir
chez soi, d'être délivré de l'exil et de l'égarement dans lesquels tous
les autres livres nous plongent. (suite)
"Les Impurs" de Caroline Boidé (Serge Safran)
 C'est
un livre de terre et de cendres. Terre brûlée, terre brûlante incrustée
loin de dans le corps. Cendres fumantes tombées du haut d'un feu
galvanique. C'est une histoire éternelle d'amour et de mort. D'honneur,
de
raison sociale et de passion aussi irréductible qu'inextinguible. C'est
un homme, captif de son image, de sa résonance mondaine et des
mensonges communautaires qui se cogne à l'absolue singularité d'une
femme. Ce sont deux folies divergentes qui se percutent et un moment se
conjoignent pour ensuite se combattre jusqu'à la mort. (suite)
C'est
un livre de terre et de cendres. Terre brûlée, terre brûlante incrustée
loin de dans le corps. Cendres fumantes tombées du haut d'un feu
galvanique. C'est une histoire éternelle d'amour et de mort. D'honneur,
de
raison sociale et de passion aussi irréductible qu'inextinguible. C'est
un homme, captif de son image, de sa résonance mondaine et des
mensonges communautaires qui se cogne à l'absolue singularité d'une
femme. Ce sont deux folies divergentes qui se percutent et un moment se
conjoignent pour ensuite se combattre jusqu'à la mort. (suite)
"Comme un veilleur attend l'aurore" de Caroline Boidé (Ed. Léo Scheer)
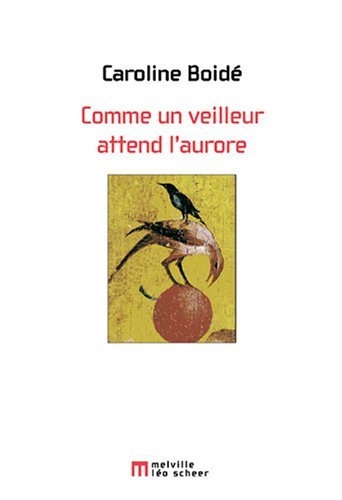 Le titre
est extrait d'un
psaume et le texte est irrigué par ce flux mystique, par ce désir de
transcendance. Mais il s'agit d'abord d'un amour fracturé et d'une
jeune femme qui va panser dans un monastère israëlien la désertion de
l'aimé.Le récit se déploie sur deux fronts : on éprouve en
alternance l'immersion dans la vie monastique et la remémoration de la
défunte relation amoureuse. (suite)
Le titre
est extrait d'un
psaume et le texte est irrigué par ce flux mystique, par ce désir de
transcendance. Mais il s'agit d'abord d'un amour fracturé et d'une
jeune femme qui va panser dans un monastère israëlien la désertion de
l'aimé.Le récit se déploie sur deux fronts : on éprouve en
alternance l'immersion dans la vie monastique et la remémoration de la
défunte relation amoureuse. (suite)
"Echapper aux tueurs" de Matthieu de Boisséson (Gallimard)
 C'est
un texte tout en apesanteur, un texte aérien aux ailes diaprées dont
nous enchantent les vibrations fines et les nuances scintillantes et
ocellées. C'est, sous la forme d'un vagabondage rêveur d'une infinie
légèreté, une profession de foi et de ferveur. Matthieu de
Boisséson est l'orpailleur de sa propre vie. Il baguenaude au fil des
jours et il en extrait de précieuses et perçantes pépites. (suite)
C'est
un texte tout en apesanteur, un texte aérien aux ailes diaprées dont
nous enchantent les vibrations fines et les nuances scintillantes et
ocellées. C'est, sous la forme d'un vagabondage rêveur d'une infinie
légèreté, une profession de foi et de ferveur. Matthieu de
Boisséson est l'orpailleur de sa propre vie. Il baguenaude au fil des
jours et il en extrait de précieuses et perçantes pépites. (suite)
"Murmures à Beyoglu" de David Boratav (Gallimard)
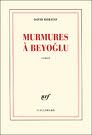 David
Boratav orchestre
avec brio un voyage tant spatial que
mémoriel. Il dessine avec ses mots des arabesques ouvragées.Voici un
homme qui plonge dans les limbes de son passé, un
passé dont il a
été spolié. Il tutoie les fantômes de son enfance et s'essaie, en même
temps, à apprivoiser les formes neuves du lieu originel. C'est une
percée verticale et une exploration longitudinale. (suite)
David
Boratav orchestre
avec brio un voyage tant spatial que
mémoriel. Il dessine avec ses mots des arabesques ouvragées.Voici un
homme qui plonge dans les limbes de son passé, un
passé dont il a
été spolié. Il tutoie les fantômes de son enfance et s'essaie, en même
temps, à apprivoiser les formes neuves du lieu originel. C'est une
percée verticale et une exploration longitudinale. (suite)
"Le retour" de Jacques Borel (Gallimard)
Jacques Borel est un passeur et un prestidigitateur. Il opère une passation de pouvoirs. Entre le temps et le verbe, ente les mots et les choses. Son écriture, à la fois sourcière, minière, spéléologue l'entraîne, par effet d'envoûtement et de contagion interne, dans des contrées qu'il n'entendait pas explorer. L'auteur, en réalité, se surprend lui-même, débouté qu'il est, par la force déportatrice de l'écriture, de la mission qu'il s'était assignée. (suite)
"Milo" de David Bosc (Allia)
 David Bosc a inventé
un genre. Ou il a écrit un récit inclassable. Mais la première
hypothèse est plus excitante. On pourrait croire que ce singulier
tissage qu'il a réalisé ressortit au
récit poétique mais c'est bien plus complexe que cela. Il s'agit d'un
texte situé en contrebas et à l'envers du récit normé et amarré. Un
exode inversé. Un retour amont sur les lieux rustiques, élémentaires de
l'enfance campagnarde. (suite)
David Bosc a inventé
un genre. Ou il a écrit un récit inclassable. Mais la première
hypothèse est plus excitante. On pourrait croire que ce singulier
tissage qu'il a réalisé ressortit au
récit poétique mais c'est bien plus complexe que cela. Il s'agit d'un
texte situé en contrebas et à l'envers du récit normé et amarré. Un
exode inversé. Un retour amont sur les lieux rustiques, élémentaires de
l'enfance campagnarde. (suite)
"S'autodétruire et les enfants" de Nicolas Bouyssi (P.O.L)
Nicolas Bouyssi opère comme une mécanique de précision, implacablement, et sans anesthésie. Il n'y a pas d'enrobage ni d'accommodement progressif. C'est ex abrupto et le dépeçage débute instantanément au fil d'une écriture métronomique, millimétrique, obsédante et qui ne concède rien. Nicolas Bouyssi ne parle que de l'organique, du plus extrême tripal mais cette matière bouillante, bouillonnante et hautement inflammable, il la traite et la découpe au scalpel, la neutralise chirurgicalement si bien qu'elle ressort de l'opération verbale presque criogénisée. (suite)
"Lithium pour Médée" de Kate Braverman (Quidam éditeur)
C'est une voix. C'est d'abord une voix. Rauque et éraillée. Tuméfiée et fêlée de trop de coups reçus. Et c'est pourtant une voix étrangement vierge et par moments flûtée et perlée d'enfance. Une voix blanchie parce que brûlée jusqu'à l'extrême consomption. Une voix atone aussi, qui égrène sans fin ses litanies. Une voix outremer et d'incessants ressacs. Une voix qui prend tout, qui emporte tout.(suite)
"Château-Rouge Hôtel" de Renaud Burel (Allia)

"Lettres à Mita" de Cristina Campo
 Ce
n'est pas un livre, c'est une grâce accordée. C'est le fourmillement du
sang, la scansion de la vie sur la plus haute portée de l'âme. Une âme
très noble, taillée à vif, effilée sur le tranchant de la plus haute
exigence. Une voix céleste et cependant aux prises, tout du long, avec
les tourments du siècle. Avec, notamment, les limites du corps et
celles des êtres. Le feu spirituel est ici tenu dans le gel paradoxal
d'une écriture de cristal. (suite)
Ce
n'est pas un livre, c'est une grâce accordée. C'est le fourmillement du
sang, la scansion de la vie sur la plus haute portée de l'âme. Une âme
très noble, taillée à vif, effilée sur le tranchant de la plus haute
exigence. Une voix céleste et cependant aux prises, tout du long, avec
les tourments du siècle. Avec, notamment, les limites du corps et
celles des êtres. Le feu spirituel est ici tenu dans le gel paradoxal
d'une écriture de cristal. (suite)
"Brûlons tous ces punks pour l'amour des elfes" de Julien Campredon (Monsieur Toussaint Louverture)
 Les
nouvelles de Julien Campredon sont de petites grenades dégoupillées,
une poignée de crépitantes pépites, une décoction un peu sorcière, une
combinaison de saveurs épicées qui éclatent sur les papilles. Nous
voici en compagnie de personnages archétypaux, de figures qui
ressortissent souvent
de la fable, de la légende ou des poncifs littéraires mais
rien n'advient de ce qu'on pourrait attendre
car Julien Campredon déroute les progressions formatées, il pulvérise
les clichés et court-circuite les voies balisées. (suite)
Les
nouvelles de Julien Campredon sont de petites grenades dégoupillées,
une poignée de crépitantes pépites, une décoction un peu sorcière, une
combinaison de saveurs épicées qui éclatent sur les papilles. Nous
voici en compagnie de personnages archétypaux, de figures qui
ressortissent souvent
de la fable, de la légende ou des poncifs littéraires mais
rien n'advient de ce qu'on pourrait attendre
car Julien Campredon déroute les progressions formatées, il pulvérise
les clichés et court-circuite les voies balisées. (suite)
"L'hiver des Feltram" de Pierre Cassou-Noguès (éd. MF)
 Pierre
Cassou-Noguès est un roué et un vorace. Il ne peut se contenter de
simplement écrire. Il faut qu'il nous manipule et nous égare et aussi
qu'il se livre à de très sophistiquées démonstrations et expériences.
Et tout cela, il le fait avec une évidente délectation et avec un non
moins évident brio. Il
nous balade dans le bassin d'Arcachon et
sur la surface moirée, miroitante d'une mer redoutable. L'intrigue
avouée, "visible", parait plus que rectiligne. Mais peu à peu, on
découvre des strates, des ramifications, des sédiments enfouis qui
lancinent l'esprit et le lancent sur d'innombrables pistes
d'interprétation. (suite)
Pierre
Cassou-Noguès est un roué et un vorace. Il ne peut se contenter de
simplement écrire. Il faut qu'il nous manipule et nous égare et aussi
qu'il se livre à de très sophistiquées démonstrations et expériences.
Et tout cela, il le fait avec une évidente délectation et avec un non
moins évident brio. Il
nous balade dans le bassin d'Arcachon et
sur la surface moirée, miroitante d'une mer redoutable. L'intrigue
avouée, "visible", parait plus que rectiligne. Mais peu à peu, on
découvre des strates, des ramifications, des sédiments enfouis qui
lancinent l'esprit et le lancent sur d'innombrables pistes
d'interprétation. (suite)
"Raphaël et Raphaël" de René de Ceccatty (Flammarion)
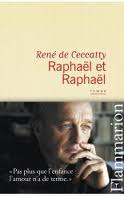 Voici un
texte roué,
moiré, qui captive, requiert, éblouit. Qui égare aussi. Kaléidoscope
d'émotions et d'idées virtuoses. Un texte qui tourne et tournoie,
obsessionnel, entêtant, sur
lui-même et
n'hésite pas à interroger ouvertement ses propres fondements, à mettre
en cause et en danger les principes mêmes et les conditions de son
existence. Il est question, dans ce récit, d'un amour. (suite)
Voici un
texte roué,
moiré, qui captive, requiert, éblouit. Qui égare aussi. Kaléidoscope
d'émotions et d'idées virtuoses. Un texte qui tourne et tournoie,
obsessionnel, entêtant, sur
lui-même et
n'hésite pas à interroger ouvertement ses propres fondements, à mettre
en cause et en danger les principes mêmes et les conditions de son
existence. Il est question, dans ce récit, d'un amour. (suite)
Muriel Cerf : Hommage
 Personne
n'a rien vu, personne n'a rien su ni pénétré. Ni les éblouis de la
premières heure, les prodigues en dithyrambes, ni ensuite les
dédaigneux, les oublieux qui, des décennies durant, ont cru bon
d'ignorer une oeuvre majeure et flamboyante. Personne ou presque, n'a
pris, de son vivant, la mesure de Muriel
Cerf. Car
Muriel Cerf, ce ne fut pas seulement les fulgurances de "L'Antivoyage"
et les étourdissants "dons narratifs" d'une gamine de 20 ans qui
frappèrent des sommités littéraires, les laissant pantois,
parfaitement ébaubis. Muriel Cerf c'est, avant tout, les foudres et les
fureurs d'une langue chatoyante qui claque et pétarade à tout-va. (suite)
Personne
n'a rien vu, personne n'a rien su ni pénétré. Ni les éblouis de la
premières heure, les prodigues en dithyrambes, ni ensuite les
dédaigneux, les oublieux qui, des décennies durant, ont cru bon
d'ignorer une oeuvre majeure et flamboyante. Personne ou presque, n'a
pris, de son vivant, la mesure de Muriel
Cerf. Car
Muriel Cerf, ce ne fut pas seulement les fulgurances de "L'Antivoyage"
et les étourdissants "dons narratifs" d'une gamine de 20 ans qui
frappèrent des sommités littéraires, les laissant pantois,
parfaitement ébaubis. Muriel Cerf c'est, avant tout, les foudres et les
fureurs d'une langue chatoyante qui claque et pétarade à tout-va. (suite)
"Le palais des autres jours" de Yasmine Char (Gallimard)
 C'est
un récit d'arrachement écrit à l'arraché. Un texte écrit sur le
tranchant d'une fracture multiple. Un texte sur les ruptures et dégâts
collatéraux. Les ruptures causées par l'élan impétueux, l'impérieux
désir de fuite qui anime deux corps bouillonnant d'une jeunesse pas
encore
domptée ni matraquée. Et puis les ruptures qui adviennent sans qu'on
veuille, à contretemps, à contre-courant des désirs
essentiels. (suite)
C'est
un récit d'arrachement écrit à l'arraché. Un texte écrit sur le
tranchant d'une fracture multiple. Un texte sur les ruptures et dégâts
collatéraux. Les ruptures causées par l'élan impétueux, l'impérieux
désir de fuite qui anime deux corps bouillonnant d'une jeunesse pas
encore
domptée ni matraquée. Et puis les ruptures qui adviennent sans qu'on
veuille, à contretemps, à contre-courant des désirs
essentiels. (suite)
"Miroirs de Julien L." d’Yves Charnet (Le Diable Vauvert)
"Immense et rouge" de Marie Chartres (photos Akin Cetin) (Les inaperçus)
 C'est
un texte qui rebrousse tout. Qui prend à rebours les attentes et les
habitudes du lecteur. Qui pratique sans cesse des sorties de route, qui
dédaigne hautement les tracés trop nets, les cours rectilignes et les
autoroutes de l'écriture.
C'est
un texte qui rebrousse tout. Qui prend à rebours les attentes et les
habitudes du lecteur. Qui pratique sans cesse des sorties de route, qui
dédaigne hautement les tracés trop nets, les cours rectilignes et les
autoroutes de l'écriture.
Un
texte qui avance par à-coups, ruées, saccades et secousses sismiques.
Une langue râpeuse qui sarcle, fouette, dépèce, violente sans trêve
mais avec une infinie douceur. Une forêt d'épines, un cactus dans un
écrin des plus suaves. Un texte qui magnifiquement nous égare en
pulvérisant tous les
codes de la narration classique. C'est un poème craché, un flux
incantatoire qu'on ne peut
assigner ni étiqueter. (suite)
"Cette bête que tu as sur la peau" de Marie Chartres (Les éditions du chemin de fer)
 Marie
Chartres n'écrit pas, comme beaucoup le font, à partir de l'écorchure
et une fois amorcé le processus de cicatrisation. Elle écrit de
l'intérieur, depuis le centre du cratère et à l'intérieur d'une
écorchure sans bords. C'est un livre de sang et de chair, ce sont des
livres de chair arrachée, des arpents de peau dépecée, c'est l'enfance
qui remonte à la gorge et une écriture au couteau, une qui fore
jusqu'au fin fond des tripes et n'épargne rien. (suite)
Marie
Chartres n'écrit pas, comme beaucoup le font, à partir de l'écorchure
et une fois amorcé le processus de cicatrisation. Elle écrit de
l'intérieur, depuis le centre du cratère et à l'intérieur d'une
écorchure sans bords. C'est un livre de sang et de chair, ce sont des
livres de chair arrachée, des arpents de peau dépecée, c'est l'enfance
qui remonte à la gorge et une écriture au couteau, une qui fore
jusqu'au fin fond des tripes et n'épargne rien. (suite)
"Approche du principe d’éloignement" de Jean-Paul
Chavent (Léo Scheer)
 Voici
un texte qui arbore des allures de recueil aphoristique et dont on
s’attend,
donc, à ce qu’il recèle une matière toute spéculative. Or, il n’en est
rien et
c’est même tout le contraire : la matière est bouillante,
saignante,
prélevée sur le cœur et les entrailles à vif.
Voici
un texte qui arbore des allures de recueil aphoristique et dont on
s’attend,
donc, à ce qu’il recèle une matière toute spéculative. Or, il n’en est
rien et
c’est même tout le contraire : la matière est bouillante,
saignante,
prélevée sur le cœur et les entrailles à vif.
"Chapitre Los" d’Hélène Cixous (Galilée)
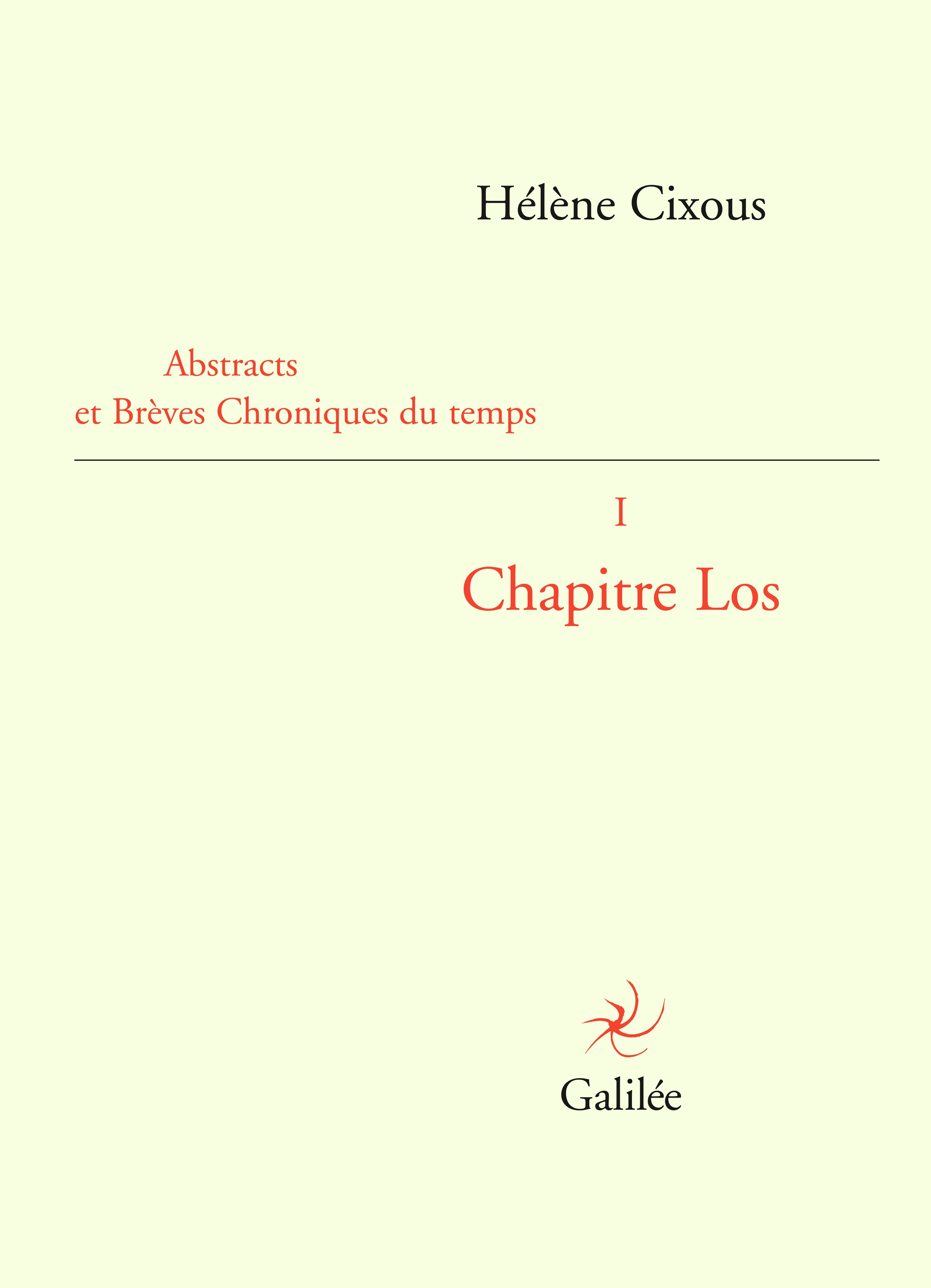 Hélène Cixous est une
grande prêtresse présidant
des
cérémonies qui demeurent secrètes, cryptés, même à elle qui pourtant
officie
sans désemparer. Tel un oracle, tout ensemble intrépide et glacé
d’effroi,
elle épouse les entrelacs, les tracés complexes de la mémoire. Elle se
fraie un
chemin incertain au cœur de ces fluctuantes arabesques. Ce livre-ci a,
comme tous les textes d’Hélène
Cixous, pour
office explicite de maintenir sa mère en vie, de l’arracher, encore et
encore,
à la mort qui se fait de plus en plus pressante. Mais c’est aussi un
magnifique tombeau. En
hommage, non pas
à ladite mère, mais à l’ami-amant, l’indésignable car trop dense, trop
instamment présent Carlos Fuentes. (suite)
Hélène Cixous est une
grande prêtresse présidant
des
cérémonies qui demeurent secrètes, cryptés, même à elle qui pourtant
officie
sans désemparer. Tel un oracle, tout ensemble intrépide et glacé
d’effroi,
elle épouse les entrelacs, les tracés complexes de la mémoire. Elle se
fraie un
chemin incertain au cœur de ces fluctuantes arabesques. Ce livre-ci a,
comme tous les textes d’Hélène
Cixous, pour
office explicite de maintenir sa mère en vie, de l’arracher, encore et
encore,
à la mort qui se fait de plus en plus pressante. Mais c’est aussi un
magnifique tombeau. En
hommage, non pas
à ladite mère, mais à l’ami-amant, l’indésignable car trop dense, trop
instamment présent Carlos Fuentes. (suite)
"Revirements dans l'antarctique du coeur" d'Hélène Cixous (Galilée)
 C'est un
texte qui fuse, taille, entaille, cisaille, crisse,
siffle, perce, vrombit, vire, troue, tire à hue et à dia. Un
texte dans lequel l'écriture est à elle-même son propre objet, sa
propre nourriture et qui, tel un cyclotron, attire et broie toute forme
de vie au coeur de sa machinerie infernale. C'est le combat,
toujours perdu, toujours réengagé, de l'écriture contre elle-même.
Il est question de la mère, bien
sûr, centenaire, et devenue l'enfant inversée de son enfant. Il est
question de la famille et de ses méfaits, des prédations et
prévarications qu'elle opère sur le corps de l'écrivain, sur le corps
même de l'écriture. (suite)
C'est un
texte qui fuse, taille, entaille, cisaille, crisse,
siffle, perce, vrombit, vire, troue, tire à hue et à dia. Un
texte dans lequel l'écriture est à elle-même son propre objet, sa
propre nourriture et qui, tel un cyclotron, attire et broie toute forme
de vie au coeur de sa machinerie infernale. C'est le combat,
toujours perdu, toujours réengagé, de l'écriture contre elle-même.
Il est question de la mère, bien
sûr, centenaire, et devenue l'enfant inversée de son enfant. Il est
question de la famille et de ses méfaits, des prédations et
prévarications qu'elle opère sur le corps de l'écrivain, sur le corps
même de l'écriture. (suite)
"Sauf
les fleurs" de Nicolas Clément (Buchet-Chastel)
 C’est
un texte qui vous cueille à fleur d’âme, à fleur d’émotion. Tout de
suite et
tout du long. C’est une voix qui se module et fluctue au fil du texte
mais
s’articule toujours au point de plus haute acuité. C’est la voix de
Marthe qui
dit les choses sans ambages mais sans jamais sacrifier aux lois et
codes usuels
de la langue. C’est donc une langue qui s’invente à mesure et s’ajuste
aux
événements dont elle restitue la teneur au plus près des pulsations
vitales.(suite)
C’est
un texte qui vous cueille à fleur d’âme, à fleur d’émotion. Tout de
suite et
tout du long. C’est une voix qui se module et fluctue au fil du texte
mais
s’articule toujours au point de plus haute acuité. C’est la voix de
Marthe qui
dit les choses sans ambages mais sans jamais sacrifier aux lois et
codes usuels
de la langue. C’est donc une langue qui s’invente à mesure et s’ajuste
aux
événements dont elle restitue la teneur au plus près des pulsations
vitales.(suite)
"Une fille occupée" de Domique Conil (Actes Sud)
 Domique
Conil raconte une histoire crachée, expulsée dans une salve de
rage, condensée dans le nom monosyllabique qu'elle attribue à son
héroïque
: Ka. Ka grandit au sein d'une famille qui érige en règle une magie
aux effets pernicieux, délétères et même dévastateurs.C'est un livre
qui
tout entier s'articule autour du pouvoir des mots, pouvoir perçant,
pulvérisant ou salvateur. (suite)
Domique
Conil raconte une histoire crachée, expulsée dans une salve de
rage, condensée dans le nom monosyllabique qu'elle attribue à son
héroïque
: Ka. Ka grandit au sein d'une famille qui érige en règle une magie
aux effets pernicieux, délétères et même dévastateurs.C'est un livre
qui
tout entier s'articule autour du pouvoir des mots, pouvoir perçant,
pulvérisant ou salvateur. (suite)
"Je suis pas la bête à manger" de Nathalie Constans, dessins Anya Belyat-Giunta (Les éditions du chemin de fer)
Voici un texte qui
ne
ressemble
pas. Un texte qui ne plie pas, ne se subordonne pas, ne concède rien. Un texte parfaitement franc-tireur et
dissident mais qui, pourtant, n'a rien de vindicatif ni d'offensif : il
s'élève, léger, aérien, presque vaporeux et souvent cocasse, dans un
allègre
battement d'ailes. C'est une partition à trois voix très distinctes
qui,
chacune, livre une version singulière de la situation et des
événements. Il y a d'abord No,
jeune créature
sauvage et féminine d'ascendance mythologique. Elle vivait retranchée,
terrée
dans la forêt jusqu'à la mort récente de ses grands-parents. (suite)
"La reformation des imbéciles" de Nathalie Constans (éd du Chemin de fer)
 Nathalie
Constans n'a pas froid aux yeux. Elle n'a pas peur des rapprochements
insolites et incongrus, elle orchestre les collusions les plus inouïes,
elle fait oeuvre surréaliste au sens plénier et original du terme. Ce
sont deux voix des confins qui s'élèvent, d'abord distantes et
distinctes puis qui s'entrelacent et se mêlent. Un homme, une femme.
Elle, c'est Kimi, elle est la petite-fille du guerrier apache Géronimo,
seule survivante d'une lignée décimée par les guerres successives. (suite)
Nathalie
Constans n'a pas froid aux yeux. Elle n'a pas peur des rapprochements
insolites et incongrus, elle orchestre les collusions les plus inouïes,
elle fait oeuvre surréaliste au sens plénier et original du terme. Ce
sont deux voix des confins qui s'élèvent, d'abord distantes et
distinctes puis qui s'entrelacent et se mêlent. Un homme, une femme.
Elle, c'est Kimi, elle est la petite-fille du guerrier apache Géronimo,
seule survivante d'une lignée décimée par les guerres successives. (suite)
"L'autre" d'Enzo Cormann (théâtre) (Ed. de Minuit)
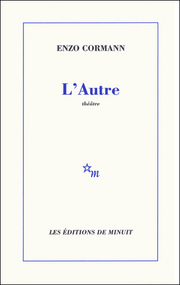 Deux
femmes, un homme. Le même pour les deux femmes. Mais Enzo Cormann fait
un usage tout à fait particulier de l'adultère et de la double vie.
Particulier, insolent, insolite, libérateur. Le style, très vif, court
le long des nombreuses ellipses et des phrases mordantes. Mado et Lila
sont deux femmes d'une quarantaine d'années qui se rencontrent après
qu'elles ont confondu l'homme de leur vie lequel a mené conjointement,
pendant des années, une vie de famille avec l'une et l'autre. (suite)
Deux
femmes, un homme. Le même pour les deux femmes. Mais Enzo Cormann fait
un usage tout à fait particulier de l'adultère et de la double vie.
Particulier, insolent, insolite, libérateur. Le style, très vif, court
le long des nombreuses ellipses et des phrases mordantes. Mado et Lila
sont deux femmes d'une quarantaine d'années qui se rencontrent après
qu'elles ont confondu l'homme de leur vie lequel a mené conjointement,
pendant des années, une vie de famille avec l'une et l'autre. (suite)
"Surfaces sensibles" d'Enzo Cormann (Gallimard)
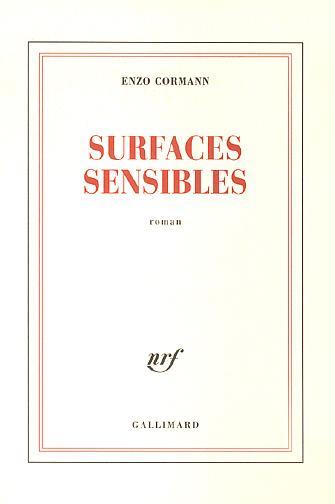 C'est
un texte qui tient, fragile, par les voix. Fil tendu, ténu de voix
féminines. Trois femmes, trois générations provisoirement réunies dans
la même maison. Trois figures de l'art : une photographe, une
chanteuse, une musicienne prodige. Vies cabossées, voix embusquées.En
haut, face à la baie vitrée qui offre une vue privilégiée, siège Lori
Kemp, photographe qui eut son heure de gloire. En dessous vit, recluse
et mutique, sa fille Zoé dont les talents sont musicaux. (suite)
C'est
un texte qui tient, fragile, par les voix. Fil tendu, ténu de voix
féminines. Trois femmes, trois générations provisoirement réunies dans
la même maison. Trois figures de l'art : une photographe, une
chanteuse, une musicienne prodige. Vies cabossées, voix embusquées.En
haut, face à la baie vitrée qui offre une vue privilégiée, siège Lori
Kemp, photographe qui eut son heure de gloire. En dessous vit, recluse
et mutique, sa fille Zoé dont les talents sont musicaux. (suite)
"La langue maternelle" de Marie Cosnay (Cheyne Editeur)
 On entre dans ce
texte par
à-coups, par immersions brusques qui laissent au bord d’être sans
souffle.
C’est un texte de confins et d’enfouissement, de crêtes et
d’escarpements. Un
texte qui exige toujours davantage à mesure qu’on avance le long de son
tracé
abrasif et qu’on approche ses sources balbutiantes et cachées. Il n’y a
pas de
sens littéral et univoque. Tout est pluriel, infiniment ramifié,
disséminé dans
les strates sédimentées qui affleurent dans et entre les mots. C’est le
récit,
syncopé,
transversal et tout de chemins de traverse, d’un affranchissement.
C’est une
voix qui fuse, se fraie, s’extrait, se singularise, se décante et
s’impose,
vierge et détonante, au travers des écueils multiples qui se
potentialisent : ceux d’une existence corsetée et ceux d’une
langue
éculée. (suite)
On entre dans ce
texte par
à-coups, par immersions brusques qui laissent au bord d’être sans
souffle.
C’est un texte de confins et d’enfouissement, de crêtes et
d’escarpements. Un
texte qui exige toujours davantage à mesure qu’on avance le long de son
tracé
abrasif et qu’on approche ses sources balbutiantes et cachées. Il n’y a
pas de
sens littéral et univoque. Tout est pluriel, infiniment ramifié,
disséminé dans
les strates sédimentées qui affleurent dans et entre les mots. C’est le
récit,
syncopé,
transversal et tout de chemins de traverse, d’un affranchissement.
C’est une
voix qui fuse, se fraie, s’extrait, se singularise, se décante et
s’impose,
vierge et détonante, au travers des écueils multiples qui se
potentialisent : ceux d’une existence corsetée et ceux d’une
langue
éculée. (suite)
"A notre humanité" de Marie Cosnay (Quidam éditeur)
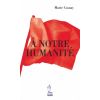 C'est
un texte somnambule et acéré. Un texte d'un onirisme fou et d'un
réalisme tranchant. Un texte d'herbes folles, de feu follet,
un texte dansé et cadencé et tenu, moins sur le mur des Fédérés que sur
la crête la plus haute de la langue. Un
texte de pointes et de cals, de tourbe et d'éther, de secousses et de
langueurs, de frénésie rêveuse et de prose bousculée qui se trempe aux
sources les plus poétiques. Un texte qui se scande au rythme des
détonations, des corps dressés et des corps tombés. (suite)
C'est
un texte somnambule et acéré. Un texte d'un onirisme fou et d'un
réalisme tranchant. Un texte d'herbes folles, de feu follet,
un texte dansé et cadencé et tenu, moins sur le mur des Fédérés que sur
la crête la plus haute de la langue. Un
texte de pointes et de cals, de tourbe et d'éther, de secousses et de
langueurs, de frénésie rêveuse et de prose bousculée qui se trempe aux
sources les plus poétiques. Un texte qui se scande au rythme des
détonations, des corps dressés et des corps tombés. (suite)
"Adèle, la scène perdue" de Marie Cosnay (Cheyne éditeur)
 C'est
un livre de failles et de fractures. Un livre irrigué par une sourde
violence. C'est une langue qui
semble tissée de douceurs et de lenteurs. Mais c'est trompeur : c'est
une écriture à bout portant,
qui troue le corps et dont la force d'impact et la vitesse d'exécution
agissent à retardement. La lame se plante dans l'embrumement d'un
distillat trouble, d'une fausse anesthésie. Le nu saille et la part
dévolue à ce qui se dérobe est infinie. (suite)
C'est
un livre de failles et de fractures. Un livre irrigué par une sourde
violence. C'est une langue qui
semble tissée de douceurs et de lenteurs. Mais c'est trompeur : c'est
une écriture à bout portant,
qui troue le corps et dont la force d'impact et la vitesse d'exécution
agissent à retardement. La lame se plante dans l'embrumement d'un
distillat trouble, d'une fausse anesthésie. Le nu saille et la part
dévolue à ce qui se dérobe est infinie. (suite)
"L'écorcobaliseur" de Bérangère Cournut (Attila)
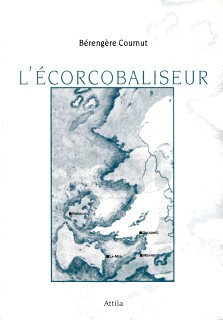 C’est un livre qui
tangue, porté par une houle cadencée,
tour à tour heurtée et dansante. La typographie même en est affectée,
hérissée,
irrégulière qui semble mimer le ressac, les flux, les embruns, les
éclats
écumeux. Nous sommes transportés à La-Mer,
lieu improbable, île
énigmatique sise au large d’une ville nommée Menfrez. Dans ces contrées
reculées, un drame agite la population et cristallise les passions. (suite)
C’est un livre qui
tangue, porté par une houle cadencée,
tour à tour heurtée et dansante. La typographie même en est affectée,
hérissée,
irrégulière qui semble mimer le ressac, les flux, les embruns, les
éclats
écumeux. Nous sommes transportés à La-Mer,
lieu improbable, île
énigmatique sise au large d’une ville nommée Menfrez. Dans ces contrées
reculées, un drame agite la population et cristallise les passions. (suite)
"Ariste" de Claire Cros (Michalon)
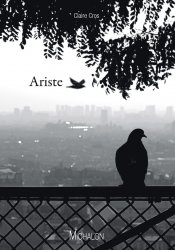 Attention,
livre rare.
Pépite, joyau, gisement. Gisement de Pépites.
Attention,
livre rare.
Pépite, joyau, gisement. Gisement de Pépites.
Ce qui frappe au premier chef, c'est l'objet. L'objet-livre, son ampleur, son volume, son aspect insolite et non-conforme. Mille pages, nullement compressées, nullement honteuses, qui s'imposent, se donnent comme une fière évidence ou comme un défi en ces temps d'anémie, d'indigence et de frilosité littéraire. (suite)
"Exil intermédiaire" de Céline Curiol (Actes Sud)
 Céline
Curiol nous entraîne dans un voyage sonore. A la rencontre de New-York,
appréhendée à travers les voix et les rumeurs qui s'y déploient. Deux
femmes, une ville. Deux femmes à l'aube du nouveau millénaire, à un
tournant de leur vie personnnelle,
amoureuse, une ville, New-York. Deux femmes sans connexions apparentes,
inconnues l'une de l'autre et que seule rassemble la ville qu'elles
investissent le temps d'un week-end, celui du 4 juillet, le temps
nécessaire pour s'ausculter et déterminer l'orientation qu'elles vont
imprimer à leur existence. (suite)
Céline
Curiol nous entraîne dans un voyage sonore. A la rencontre de New-York,
appréhendée à travers les voix et les rumeurs qui s'y déploient. Deux
femmes, une ville. Deux femmes à l'aube du nouveau millénaire, à un
tournant de leur vie personnnelle,
amoureuse, une ville, New-York. Deux femmes sans connexions apparentes,
inconnues l'une de l'autre et que seule rassemble la ville qu'elles
investissent le temps d'un week-end, celui du 4 juillet, le temps
nécessaire pour s'ausculter et déterminer l'orientation qu'elles vont
imprimer à leur existence. (suite)
"La blonde" de Lydie Dattas (Gallimard)
Ce sont des mots qui filent de rétine à rétine, sans pause ni déposition. Des instantanés - photographiques et sensoriels - arrachés au mystère de la peinture. C'est Lydie Dattas - "La foudre", "La nuit spirituelle" - qui porte au plus haut degré de combustion le noir de Pierre Soulages. C'est la rencontre, le choc thermique du chaud et du froid. C'est la friction, l'entrechoquement entre l'obscur et l'incandescence, lesquels existent probablement à parts égales chez les deux artistes : deux échappés du rang, deux authentiques sauvages. (suite)
"La foudre" de Lydie Dattas (Mercure de France)
 Ce
n'est pas un livre, c'est une déflagration et Lydie Dattas n'est pas un
écrivain, c'est une prestidigitatrice chamane, une torche vive qui
jette
son être entier dans le feu de ses mots. Née d'une mère
théâtrale, comédienne dans l'âme, et d'un père organiste et
essentiellement poète, Lydie Dattas a reçu en héritage le sens de la
démesure, de l'irrégularité et du sacré. (suite)
Ce
n'est pas un livre, c'est une déflagration et Lydie Dattas n'est pas un
écrivain, c'est une prestidigitatrice chamane, une torche vive qui
jette
son être entier dans le feu de ses mots. Née d'une mère
théâtrale, comédienne dans l'âme, et d'un père organiste et
essentiellement poète, Lydie Dattas a reçu en héritage le sens de la
démesure, de l'irrégularité et du sacré. (suite)
"Georgia" de Julien
Delmaire (Grasset)
 C’est un texte
chorégraphié et
castagné. Un cognement endiablé de corps entrechoqués. C’est un
festival de
souffles, de heurts, de cadences débridées. C’est un texte tissé
d’ondes de
choc, de fureurs éperdues, d’envols sublimes et poignardés. Venance, le
jeune
homme dont nous
suivons le parcours, a des allures mythologiques de héros percé par le
destin.
Né sur les rives d’un fleuve d’Afrique, il se retrouve, pour cause de
conditions inclémentes et insuffisantes, catapulté dans une France qui
le
malmène et le bafoue. (suite)
C’est un texte
chorégraphié et
castagné. Un cognement endiablé de corps entrechoqués. C’est un
festival de
souffles, de heurts, de cadences débridées. C’est un texte tissé
d’ondes de
choc, de fureurs éperdues, d’envols sublimes et poignardés. Venance, le
jeune
homme dont nous
suivons le parcours, a des allures mythologiques de héros percé par le
destin.
Né sur les rives d’un fleuve d’Afrique, il se retrouve, pour cause de
conditions inclémentes et insuffisantes, catapulté dans une France qui
le
malmène et le bafoue. (suite)
"L'immédiat" de Marie Delos (Seuil)
 C'est
un récit en forme de fugue, une évasion réussie, une coupante et
mélodieuse éclosion, tout entier irrigué de musique, placé sous le
signe et la haute garde de Prokofiev. Il est question d'une jeune
bruxelloise qui n'en peut plus des bornes mutilantes de son quotidien,
de l'existence rectiligne, préfabriquée, autoroutière qui se profile,
dont ses congénères s'accommodent mais qu'elle aspire à fuir. (suite)
C'est
un récit en forme de fugue, une évasion réussie, une coupante et
mélodieuse éclosion, tout entier irrigué de musique, placé sous le
signe et la haute garde de Prokofiev. Il est question d'une jeune
bruxelloise qui n'en peut plus des bornes mutilantes de son quotidien,
de l'existence rectiligne, préfabriquée, autoroutière qui se profile,
dont ses congénères s'accommodent mais qu'elle aspire à fuir. (suite)
"Maria avec et sans rien" de Joan Didion (Robert Laffont)
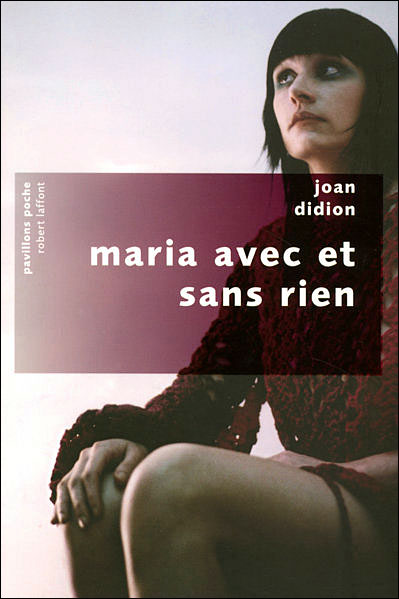 C'est
un roman écrit à la machette doublé d'un récit de givre : émotions et
sensations semblent gelées aussitôt que surgies et énoncées. L'héroïne
est une jeune femme prénommée Maria et d'elle on apprendra pas
grand-chose sinon incidemment et comme par accident. Pas la moindre
notation psychologique. Rien que des faits, de courtes séquences
syncopées. (suite)
C'est
un roman écrit à la machette doublé d'un récit de givre : émotions et
sensations semblent gelées aussitôt que surgies et énoncées. L'héroïne
est une jeune femme prénommée Maria et d'elle on apprendra pas
grand-chose sinon incidemment et comme par accident. Pas la moindre
notation psychologique. Rien que des faits, de courtes séquences
syncopées. (suite)
"Nous nous attendons" d'Ariane Dreyfus (Le Castor Astral)
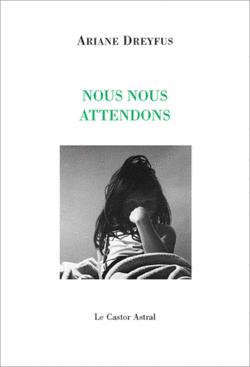 Ariane
Dreyfus écrit une poésie faussement limpide. Tout est là, semble-t-il,
posé, déposé, dans les mots simples et sans effet et cependant tout
échappe. Il se produit chaque fois un décrochement. Et l'éclat, aussi,
est ailleurs. Ces textes sont des esquilles, des éclats fragmentaires
prélevés sur des scènes et sensations quotidiennes. Il y a, surtout,
les plis légers, les rumeurs feutrées, les foudres lentes et les
pointes aiguës qui accompagnent l'amour quand il se fait, se partage
entre les corps. C'est la saisie, impromptue mais en profondeur, de
gestes à la volée, de froissements, de chuchotements, de fines et
sapides saveurs, de ténuités: toutes choses qui d'ordinaire relèvent de
l'indicible voire de l'imperceptible mais qu'Ariane Dreyfus
recueille dans des mots simples et séminaux. (suite)
Ariane
Dreyfus écrit une poésie faussement limpide. Tout est là, semble-t-il,
posé, déposé, dans les mots simples et sans effet et cependant tout
échappe. Il se produit chaque fois un décrochement. Et l'éclat, aussi,
est ailleurs. Ces textes sont des esquilles, des éclats fragmentaires
prélevés sur des scènes et sensations quotidiennes. Il y a, surtout,
les plis légers, les rumeurs feutrées, les foudres lentes et les
pointes aiguës qui accompagnent l'amour quand il se fait, se partage
entre les corps. C'est la saisie, impromptue mais en profondeur, de
gestes à la volée, de froissements, de chuchotements, de fines et
sapides saveurs, de ténuités: toutes choses qui d'ordinaire relèvent de
l'indicible voire de l'imperceptible mais qu'Ariane Dreyfus
recueille dans des mots simples et séminaux. (suite)
"Emportée" de Paule du Bouchet (Actes Sud)
 C'est
un texte de fièvre et de foudre. Un texte d'une force galvanique et
d'une si tremblante fragilité qu'on craint à tout moment que ne se
brise la voix qui s'élève. C'est un texte d'ardeur, de résistance et
d'amour. Un combat
qui se mue en consentement. C'est
une histoire de difficile filiation. Car il est difficile d'être la
fille de l'amour même. L'auteur, Paule du Bouchet, est la fille du
poète
André du Bouchet et de Tina Jolas qui fut, des années durant, l'amante
secrète de René Char. (suite)
C'est
un texte de fièvre et de foudre. Un texte d'une force galvanique et
d'une si tremblante fragilité qu'on craint à tout moment que ne se
brise la voix qui s'élève. C'est un texte d'ardeur, de résistance et
d'amour. Un combat
qui se mue en consentement. C'est
une histoire de difficile filiation. Car il est difficile d'être la
fille de l'amour même. L'auteur, Paule du Bouchet, est la fille du
poète
André du Bouchet et de Tina Jolas qui fut, des années durant, l'amante
secrète de René Char. (suite)
"Spéracurel" d'Anna Dubosc (éd. des promenades)
 Anna
Dubosc vit comme le vent : au gré du souffle qu'elle épouse, dans
lequel elle se fond et flue quelle que soit la force des impacts
adverses. Et elle écrit de même, en pointes, en sautillements, en
rebonds et entrechats, elle écrit la course dansée du vent et même la
mort avec elle, prend des allures enjouées et peut prêter à sourire.
Elle
nous livre de sa vie des petites touches incisives, colorées,
savoureuses et qu'on déguste avec délectation. (suite)
Anna
Dubosc vit comme le vent : au gré du souffle qu'elle épouse, dans
lequel elle se fond et flue quelle que soit la force des impacts
adverses. Et elle écrit de même, en pointes, en sautillements, en
rebonds et entrechats, elle écrit la course dansée du vent et même la
mort avec elle, prend des allures enjouées et peut prêter à sourire.
Elle
nous livre de sa vie des petites touches incisives, colorées,
savoureuses et qu'on déguste avec délectation. (suite)
"Un long silence de carnaval" de Miguel Duplan (Quidam)
 Ce texte est
d'abord une
langue. Insolente, dissidente, caracolante et percutante. C'est
aussi un portrait troué. Une vie d'homme rongée par des vitriols
divers, cabossée par des dérapages de moins en moins contrôlés.
Jean-Baptiste Simonin, le présumé héros du récit, est un flic
errant, un peu comme le juif errant : bien
que ancré dans un contexte (Cayenne) et lesté de charges diverses
(femme, famille, maîtresse, métier), il n'est pas assignable. (suite)
Ce texte est
d'abord une
langue. Insolente, dissidente, caracolante et percutante. C'est
aussi un portrait troué. Une vie d'homme rongée par des vitriols
divers, cabossée par des dérapages de moins en moins contrôlés.
Jean-Baptiste Simonin, le présumé héros du récit, est un flic
errant, un peu comme le juif errant : bien
que ancré dans un contexte (Cayenne) et lesté de charges diverses
(femme, famille, maîtresse, métier), il n'est pas assignable. (suite)
"Le quatuor d'Alexandrie" de Lawrence Durrell
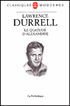 C'est
une somme romanesque éblouissante, une oeuvre grandiose et étonnamment
méconnue voire ignorée. Quatre récits qui, d'une manière et dans une
langue virtuoses, se répondent, se percutent, se font écho, se
corrigent et se complètent. On se trouve clairement face au
fantasme qui agit tout écrivain : celui de l'oeuvre totale. Sauf qu'ici
le rêve et son accomplissement coïncident presque. C'est une rhapsodie,
une fugue et de pleines pages de plain-chant. Une cathédrale
proustienne sur un mode baroque. (suite)
C'est
une somme romanesque éblouissante, une oeuvre grandiose et étonnamment
méconnue voire ignorée. Quatre récits qui, d'une manière et dans une
langue virtuoses, se répondent, se percutent, se font écho, se
corrigent et se complètent. On se trouve clairement face au
fantasme qui agit tout écrivain : celui de l'oeuvre totale. Sauf qu'ici
le rêve et son accomplissement coïncident presque. C'est une rhapsodie,
une fugue et de pleines pages de plain-chant. Une cathédrale
proustienne sur un mode baroque. (suite)
"Petits pains au chocolat" de Roxane Duru (S. Million éditeur)
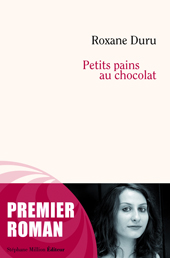 C'est
un texte déroutant. Tout de hérissements, d'entrechoquements
contrastés. Un texte heurté avec, par intermittences, des coulées de
douceur, des salves de poésie pure. Soit Lou, 18 ans, fraîchement
débarqué de sa province ensoleillée qui va, le temps d'une saison, se
frotter, au sein d'une estivale prépa Science Po, à d'imbuvables
nantis, taillés sur un modèle interchangeable, égaux en morgue et
nonchalance étudiée. (suite)
C'est
un texte déroutant. Tout de hérissements, d'entrechoquements
contrastés. Un texte heurté avec, par intermittences, des coulées de
douceur, des salves de poésie pure. Soit Lou, 18 ans, fraîchement
débarqué de sa province ensoleillée qui va, le temps d'une saison, se
frotter, au sein d'une estivale prépa Science Po, à d'imbuvables
nantis, taillés sur un modèle interchangeable, égaux en morgue et
nonchalance étudiée. (suite)
"Retour
à Patmos" de Patricia Emsens (Edition des Busclats)
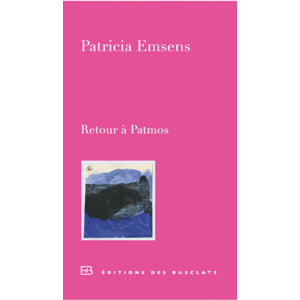 C’est
un texte si délicat et dont l’écriture, ténue, aérienne, se pose si peu
sur la
page, qu’on pourrait s’y tromper. Car la charge de violence que
recèlent les
mots frappe comme obliquement et en sourdine mais l’impact n’en est pas
moins
ravageur. C’est,
sous des dehors usuels et à travers des manières usagères, une approche
singulière et subtile du déchirement amoureux. C’est autour d’un lieu,
l’île de
Patmos, que tout s’articule et se cristallise. C’est un retour qui se
double
d’une expérience inaugurale et favorise un dénuement, suspendu depuis
des
années. (suite)
C’est
un texte si délicat et dont l’écriture, ténue, aérienne, se pose si peu
sur la
page, qu’on pourrait s’y tromper. Car la charge de violence que
recèlent les
mots frappe comme obliquement et en sourdine mais l’impact n’en est pas
moins
ravageur. C’est,
sous des dehors usuels et à travers des manières usagères, une approche
singulière et subtile du déchirement amoureux. C’est autour d’un lieu,
l’île de
Patmos, que tout s’articule et se cristallise. C’est un retour qui se
double
d’une expérience inaugurale et favorise un dénuement, suspendu depuis
des
années. (suite)
"Blanche et Marie" de Per Olov Enquist (Actes Sud)
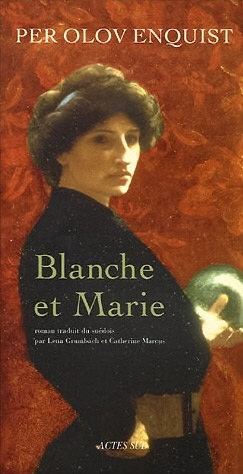 "Blanche et
Marie", c'est
un coup de projecteur extraordinairement prenant sur deux personnages
historiques, l'un illustrissime, l'autre méconnu. Coup
de
projecteur mais aussi approche très singulière. Marie, c'est rien moins
que Marie Curie et Blanche, c'est Blanche Wittman, d'abord cas
psychiatrique, patiente du professeur Charcot et appât public, renommée
par ses spectaculaires manifestations d'hystérie lesquelles
illustraient à merveille les théories du grand professeur. Puis
assistante de Marie Curie. (suite)
"Blanche et
Marie", c'est
un coup de projecteur extraordinairement prenant sur deux personnages
historiques, l'un illustrissime, l'autre méconnu. Coup
de
projecteur mais aussi approche très singulière. Marie, c'est rien moins
que Marie Curie et Blanche, c'est Blanche Wittman, d'abord cas
psychiatrique, patiente du professeur Charcot et appât public, renommée
par ses spectaculaires manifestations d'hystérie lesquelles
illustraient à merveille les théories du grand professeur. Puis
assistante de Marie Curie. (suite)
"26a" de Diana Evans
 C'est
un récit qui tire des larmes. Un texte qui s'avance d'abord à pas
feutrés, l'air de rien, tout en fantaisie et pas de côté puis
qui
s'enfle, s'étoffe, prend son envol pour finr en mode majeur et
magistral. C'est
une voix trempée aux ors de la magie, rompue aux sortilèges de
l'enfance, une voix qui, par touches légères, vous retourne l'âme et va
fouiller loin dans les entrailles à vif. (suite)
C'est
un récit qui tire des larmes. Un texte qui s'avance d'abord à pas
feutrés, l'air de rien, tout en fantaisie et pas de côté puis
qui
s'enfle, s'étoffe, prend son envol pour finr en mode majeur et
magistral. C'est
une voix trempée aux ors de la magie, rompue aux sortilèges de
l'enfance, une voix qui, par touches légères, vous retourne l'âme et va
fouiller loin dans les entrailles à vif. (suite)
"La fille américaine" de Monika Fagerholm (Stock)
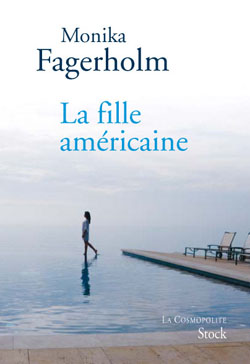 Nous voici
dans une région
des confins, dans le Grand Nord qu'irriguent secrets et mystères. On
croit être en prise avec ce qui relève de la sorcellerie mais c'est
parce qu'on effectue une plongée dans les profondeurs hantées de
l'adolescence. Le roman est composé d'une
constellation des questions obsédantes, questions de vie ou de mort à
ce point récurrentes qu'elles se chargent d'une force
incantatoire. C'est
un texte d'une facture complexe, sophistiquée même qui mêle habilement
les strates temporelles jusqu'à produire un prenant effet de vertige. (suite)
Nous voici
dans une région
des confins, dans le Grand Nord qu'irriguent secrets et mystères. On
croit être en prise avec ce qui relève de la sorcellerie mais c'est
parce qu'on effectue une plongée dans les profondeurs hantées de
l'adolescence. Le roman est composé d'une
constellation des questions obsédantes, questions de vie ou de mort à
ce point récurrentes qu'elles se chargent d'une force
incantatoire. C'est
un texte d'une facture complexe, sophistiquée même qui mêle habilement
les strates temporelles jusqu'à produire un prenant effet de vertige. (suite)
"L'avenir n'est plus ce qu'il était" de Richard Farina (Calmann-Lévy)
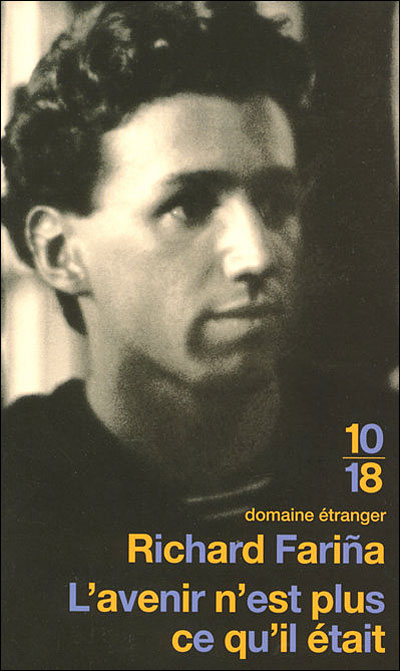 Dès
le départ, il y a des signes qui ne trompent pas. On est bien en
littérature, dans la vraie, la pure. Car on subit d'emblée une
translation, on est déporté hors du cadre, les repères lénifiants sont
retirés comme une échelle sous les pieds du grimpeur.
Dès
le départ, il y a des signes qui ne trompent pas. On est bien en
littérature, dans la vraie, la pure. Car on subit d'emblée une
translation, on est déporté hors du cadre, les repères lénifiants sont
retirés comme une échelle sous les pieds du grimpeur.
On ne sait pas bien où on se trouve, on identifie peu à peu les attributs d'un milieu étudiant. Ca grouille, on se canarde de mots d'esprit plus ou moins scabreux, on se frotte, se frictionne par joutes verbales interposées. (suite)
"Rideau de verre" de Claire Fercak (Verticales)
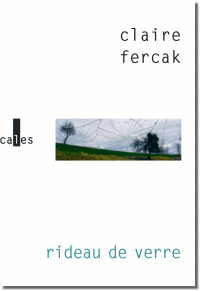 Ce
livre est d'abord
une langue. Eclatée, syncopée, comme sarclée et scarifiée par la
douleur
qui cherche un idiome adéquat pour se dire. C'est un
récit autobiographique revisité par une émule de Chloé Delaume : la
parenté saute aux yeux dans l'usage de la langue comme dans la
thématique. La figure du père tortionnaire et détraqué est
centrale. (suite)
Ce
livre est d'abord
une langue. Eclatée, syncopée, comme sarclée et scarifiée par la
douleur
qui cherche un idiome adéquat pour se dire. C'est un
récit autobiographique revisité par une émule de Chloé Delaume : la
parenté saute aux yeux dans l'usage de la langue comme dans la
thématique. La figure du père tortionnaire et détraqué est
centrale. (suite)
"Abris et déblais" d'Eric Ferrari (Cheyne éditeur)
Eric Ferrari écrit
raide et
troué. Mais il procède à un décapage si radical que les silences des
trouées
sont d'une densité égale à celle des mots, pesés et comptés. La poésie
qu'il
pratique n'est
pas un chant, on croirait plutôt une volée de coups assenés mais des
coups qui
provoquent l'éblouissement et procurent la jouissance. Les raccourcis,
dans
cette langue tout ensemble concassée et ciselée, sont si fulgurants
qu'ils
nécessitent parfois plusieurs lectures pour qu'on prenne pleinement la
mesure
de l'épaisseur et de la teneur humaine qu'ils recèlent. Et pourtant,
dès
l'abord, on est saisi, percé. On sait qu'on touche là l'intensité brute
mais
aussi, et paradoxalement, une forme de beauté suprême et suprêmement
raffinée. (suite)
"Un sourire particulier" de Pauline Flepp (Max Milo)
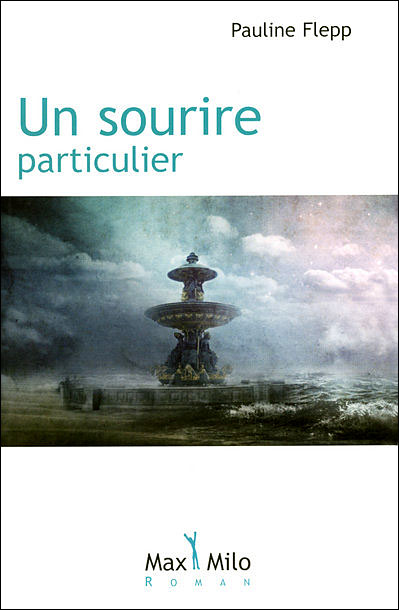 Elle
a dix-sept ans, elle se prénomme Line, elle funambule sa vie en quête
d'instants absolus, d'instants qui recèlent le suc plénier de la vie. A
une fête, elle rencontre Julien, beau ténébreux désenchanté, elle le
met au défi de se jeter dans le vide, ce qu'il fait, sachant toutefois
que c'est d'un premier étage qu'il se précipite. (suite)
Elle
a dix-sept ans, elle se prénomme Line, elle funambule sa vie en quête
d'instants absolus, d'instants qui recèlent le suc plénier de la vie. A
une fête, elle rencontre Julien, beau ténébreux désenchanté, elle le
met au défi de se jeter dans le vide, ce qu'il fait, sachant toutefois
que c'est d'un premier étage qu'il se précipite. (suite)
"Encore une nuit de merde dans cette ville pourrie" de Nick Flynn (Gallimard)
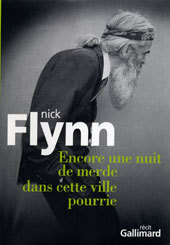 C'est
un exercice de prestidigitation effectué à l'aveugle. Il s'agit de
faire apparaitre le père inconnu, absent, de brosse par touches
incertaines un portrait dont les contours et même le motif central sans
cesse se dérobent. C'est un récit, non un roman et
l'histoire est d'autant plus ahurissante qu'elle est vraie. Le père
s'est évaporé durant l'âge tendre de l'auteur, père et fils se
croiseront brièvement quelques années plus tard avant de se retrouver
alors que l'auteur, déjà adulte, travaille dans un foyer de SDF et que
le père, lui, est devenu clochard (suite)
C'est
un exercice de prestidigitation effectué à l'aveugle. Il s'agit de
faire apparaitre le père inconnu, absent, de brosse par touches
incertaines un portrait dont les contours et même le motif central sans
cesse se dérobent. C'est un récit, non un roman et
l'histoire est d'autant plus ahurissante qu'elle est vraie. Le père
s'est évaporé durant l'âge tendre de l'auteur, père et fils se
croiseront brièvement quelques années plus tard avant de se retrouver
alors que l'auteur, déjà adulte, travaille dans un foyer de SDF et que
le père, lui, est devenu clochard (suite)
"La remise à bateaux" de Jon Fosse (Circé)
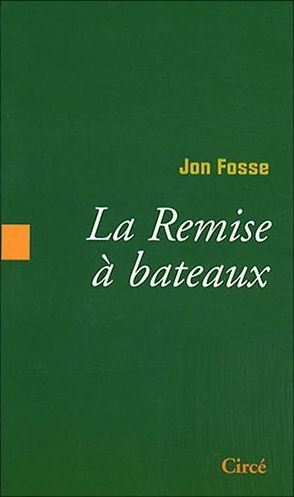 C'est un petit
livre, une
intrigue bien mince, réduite à presque rien : le narrateur, trente ans
passés, solitaire, célibataire sans emploi, vivant chez sa mère,
retrouve Knut, son ami d'enfance, son allié des années d'adolescence,
perdu de vue depuis dix ans et de retour dans sa ville d'origine,
subitement réapparu sous la forme d'un homme accompli, marié, père de
deux fillettes, professeur de musique. (suite)
C'est un petit
livre, une
intrigue bien mince, réduite à presque rien : le narrateur, trente ans
passés, solitaire, célibataire sans emploi, vivant chez sa mère,
retrouve Knut, son ami d'enfance, son allié des années d'adolescence,
perdu de vue depuis dix ans et de retour dans sa ville d'origine,
subitement réapparu sous la forme d'un homme accompli, marié, père de
deux fillettes, professeur de musique. (suite)
"Par effraction" d'Hélène Frappat (Allia)
 Hélène
Frappat aime les jeux de miroir, les jeux d'écho, et c'est une
orchestratrice virtuose de sortilèges. Elle
nous emmène, nous tient, nous ferre avec de l'infime et du ténu. Son
texte a quelque chose de nacré, de vaporeux, d'immatériel. Un texte
comme une buée en suspension. La narration se déploie sur quatre
fronts, il y a quatre entrées, quatre pistes qui
s'entrelacent pour former ce tissage sybillin. (suite)
Hélène
Frappat aime les jeux de miroir, les jeux d'écho, et c'est une
orchestratrice virtuose de sortilèges. Elle
nous emmène, nous tient, nous ferre avec de l'infime et du ténu. Son
texte a quelque chose de nacré, de vaporeux, d'immatériel. Un texte
comme une buée en suspension. La narration se déploie sur quatre
fronts, il y a quatre entrées, quatre pistes qui
s'entrelacent pour former ce tissage sybillin. (suite)
"La poupée de Kokoschka" d'Hélène Frédérick (Verticales)
 Hélène
Frédérick a des dispositions médiumniques. Elle tisse des destins et
invente des états (du corps et de l'âme) dans lesquels elle s'immerge
avec une empathie et une prescience des choses peu communes. Ainsi
d'Hermine Moos, la jeune femme que le peintre Kokoschka investit un
jour
d'une insolite mission. Il s'agit pour elle (qui est couturière de
théâtre) de créer une poupée-marionnette à l'effigie d'Alma Mahler
laquelle
fut l'amante en allée du peintre et dont il est hanté au point de
vouloir vivre avec son ersatz inanimé. (suite)
Hélène
Frédérick a des dispositions médiumniques. Elle tisse des destins et
invente des états (du corps et de l'âme) dans lesquels elle s'immerge
avec une empathie et une prescience des choses peu communes. Ainsi
d'Hermine Moos, la jeune femme que le peintre Kokoschka investit un
jour
d'une insolite mission. Il s'agit pour elle (qui est couturière de
théâtre) de créer une poupée-marionnette à l'effigie d'Alma Mahler
laquelle
fut l'amante en allée du peintre et dont il est hanté au point de
vouloir vivre avec son ersatz inanimé. (suite)
"Désirée" de Marie Frering (Quidam)
 "Désirée"
est un récit frontalier et passeur. Une voie de traverse. Une vie
traversière. Une flamme qui caresse des mèches douces et disposées.
Une explosion d'étincelles versicolores sous la
peau. "Désirée"
est un tissage et une gerbe folle de mots délivrés
de leur emploi usuel. "Désirée" est un portrait tout d'éclairs
saisissants et de
portes dérobées. Désirée est évidemment orpheline car quels parents
pourraient
assigner une filette aussi libre. (suite)
"Désirée"
est un récit frontalier et passeur. Une voie de traverse. Une vie
traversière. Une flamme qui caresse des mèches douces et disposées.
Une explosion d'étincelles versicolores sous la
peau. "Désirée"
est un tissage et une gerbe folle de mots délivrés
de leur emploi usuel. "Désirée" est un portrait tout d'éclairs
saisissants et de
portes dérobées. Désirée est évidemment orpheline car quels parents
pourraient
assigner une filette aussi libre. (suite)
"Aimer fatigue" de Philippe Fusaro (l'Olivier)
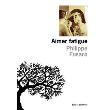 C'est un récit plein de creux
et de déliés. Une
voltige et
une déambulation gracieuses autant que nébuleuses. C'est une variation
subtile et sensible autour de
motifs
éculés, de figures fatiguées. Ce sont des personnages et des lieux
attendus
mais que l'auteur décale imperceptiblement pour les arracher à leur
emploi
convenu. Et, tout du long, ces figures familières sont travaillées de
l'intérieur par une étrangeté qui les doue d'un mystère et d'un pouvoir
de
fascination absolument vierges. Il y a Lulù, actrice issu du moule
italien le plus
classique, le plus caractéristique mais qui s'évertue à gommer ses
traits distinctifs
pour accéder à une aura et à une gloire hollywoodiennes.(suite)
C'est un récit plein de creux
et de déliés. Une
voltige et
une déambulation gracieuses autant que nébuleuses. C'est une variation
subtile et sensible autour de
motifs
éculés, de figures fatiguées. Ce sont des personnages et des lieux
attendus
mais que l'auteur décale imperceptiblement pour les arracher à leur
emploi
convenu. Et, tout du long, ces figures familières sont travaillées de
l'intérieur par une étrangeté qui les doue d'un mystère et d'un pouvoir
de
fascination absolument vierges. Il y a Lulù, actrice issu du moule
italien le plus
classique, le plus caractéristique mais qui s'évertue à gommer ses
traits distinctifs
pour accéder à une aura et à une gloire hollywoodiennes.(suite)
"L'affreux Pastis de la rue des merles" de Carlo Emilio Gadda (Seuil)
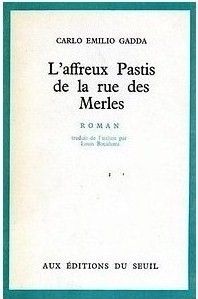 Il faudrait inventer
un idiome
particulier pour rendre compte de ce texte. Ce n'est pas un livre,
c'est un alambic, un élixir, un nectar, une ambroisie. Ce n'est pas un
livre, c'est un passage à un état modifié de conscience. Ce n'est pas
un récit, c'est un furieux, intempérant, impudent, impénitent,
truculent, gargantuesque usage de la langue. (suite)
Il faudrait inventer
un idiome
particulier pour rendre compte de ce texte. Ce n'est pas un livre,
c'est un alambic, un élixir, un nectar, une ambroisie. Ce n'est pas un
livre, c'est un passage à un état modifié de conscience. Ce n'est pas
un récit, c'est un furieux, intempérant, impudent, impénitent,
truculent, gargantuesque usage de la langue. (suite)
"Si rien ne bouge" d'Hélène Gaudy (éd. du Rouergue)
 Hélène
Gaudy est une marionnettiste, une manipulatrice de premier ordre. Elle
se plait à détraquer insensiblement les atmosphères et elle excelle à
ce petit jeu : elle opère l'air de rien, par petites touches, par
petites phrases toutes de suggestion et d'ellipses, phrases d'apparence
anodine mais de portée assassine, forces de frappe, recels de charges
atomiques.Voici un trio familial bien policé, bien sanglé dans
ses certitudes bourgeoises bien-pensantes. Il y a Samuel, le père, Lise
la mère et Nina, l'unique fille
adolescente âgée de 14 ans. (suite)
Hélène
Gaudy est une marionnettiste, une manipulatrice de premier ordre. Elle
se plait à détraquer insensiblement les atmosphères et elle excelle à
ce petit jeu : elle opère l'air de rien, par petites touches, par
petites phrases toutes de suggestion et d'ellipses, phrases d'apparence
anodine mais de portée assassine, forces de frappe, recels de charges
atomiques.Voici un trio familial bien policé, bien sanglé dans
ses certitudes bourgeoises bien-pensantes. Il y a Samuel, le père, Lise
la mère et Nina, l'unique fille
adolescente âgée de 14 ans. (suite)
"Je te nous aime" d’Albane Gellé (Cheyne éditeur)
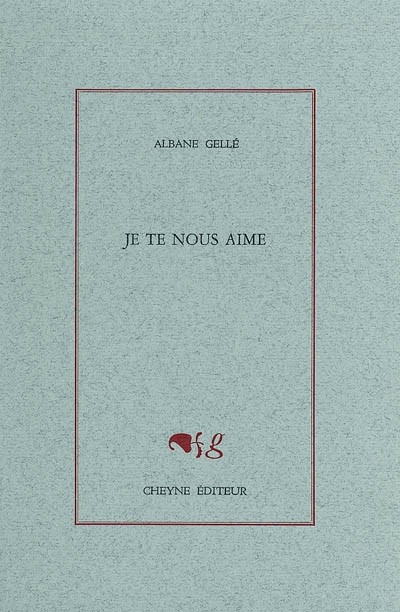 Albane Gellé procède
par
soustraction. Elle épluche et ne garde, de la vie et du verbe, que le
plus nu,
le plus prégnant, le plus urgent. Quelque chose comme une ligne drue ou
un
parfum d’enfance. C’est le ballet, non
de deux
prénoms, mais de deux pronoms. C’est l’histoire, à la fois universelle,
générique, et absolument singulière, de « il » et
« elle ».
Avec des mots simples et une sensibilité à vif, Albane Gellé décrit ce
mouvement si particulier par lequel deux entités irréductibles se
cognent, se
percutent et peu à peu s’apprivoisent. Comment s’assouplit la dureté
granitique, la résistance calcaire, hérissée d’
« il » et
« elle » qui, irrésistiblement convergent pour, à la fin,
former cet
improbable « nous ». (suite)
Albane Gellé procède
par
soustraction. Elle épluche et ne garde, de la vie et du verbe, que le
plus nu,
le plus prégnant, le plus urgent. Quelque chose comme une ligne drue ou
un
parfum d’enfance. C’est le ballet, non
de deux
prénoms, mais de deux pronoms. C’est l’histoire, à la fois universelle,
générique, et absolument singulière, de « il » et
« elle ».
Avec des mots simples et une sensibilité à vif, Albane Gellé décrit ce
mouvement si particulier par lequel deux entités irréductibles se
cognent, se
percutent et peu à peu s’apprivoisent. Comment s’assouplit la dureté
granitique, la résistance calcaire, hérissée d’
« il » et
« elle » qui, irrésistiblement convergent pour, à la fin,
former cet
improbable « nous ». (suite)
"Si je suis de ce monde" d’Albane Gellé (Cheyne
éditeur)
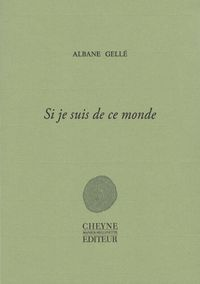 Albane Gellé
s’établit et se
resserre tout entière autour d’un infinitif dont elle cherche à
épouser, sinon
à épuiser, les lignes de force et les ressources multiples. Et qui se
multiplient chemin faisant. L’infinitif, c’est
« tenir », c’est la pièce maitresse, l’épine dorsale qui
architecture
le texte tout entier. Ce verbe est programmatique, il condense et
cristallise
tout ce qui, simultanément, éclate et se ramifie sur la page. Et Albane
Gellé
propose des déclinaisons à la fois subtiles, percutantes et
inattendues. Elle
allie, dans son approche, puissance et délicatesse. (suite)
Albane Gellé
s’établit et se
resserre tout entière autour d’un infinitif dont elle cherche à
épouser, sinon
à épuiser, les lignes de force et les ressources multiples. Et qui se
multiplient chemin faisant. L’infinitif, c’est
« tenir », c’est la pièce maitresse, l’épine dorsale qui
architecture
le texte tout entier. Ce verbe est programmatique, il condense et
cristallise
tout ce qui, simultanément, éclate et se ramifie sur la page. Et Albane
Gellé
propose des déclinaisons à la fois subtiles, percutantes et
inattendues. Elle
allie, dans son approche, puissance et délicatesse. (suite)
"Gin et les italiens" de Goldie Goldbloom (Christian Bourgois)
 C'est
un livre de cabrioles, de voltes, de saltos et de salves furieusement
inventives. Un texte aux allures de cavalcade et de valse légère. Avec
des phrases frondeuses qui claquent et rendent un son absolument
inédit. C'est une histoire éternelle contée dans une langue singulière
et, surtout, sur un mode radicalement neuf. On
se trouve en Australie, en 1944. Celle qui parle, c'est Gin, une femme
qui est tout entière une étrangeté et dont la voix alerte et saisit en
ce qu'elle se fait le relais d'un regard qui est d'une rare acuité et
d'une singularité totale. (suite)
C'est
un livre de cabrioles, de voltes, de saltos et de salves furieusement
inventives. Un texte aux allures de cavalcade et de valse légère. Avec
des phrases frondeuses qui claquent et rendent un son absolument
inédit. C'est une histoire éternelle contée dans une langue singulière
et, surtout, sur un mode radicalement neuf. On
se trouve en Australie, en 1944. Celle qui parle, c'est Gin, une femme
qui est tout entière une étrangeté et dont la voix alerte et saisit en
ce qu'elle se fait le relais d'un regard qui est d'une rare acuité et
d'une singularité totale. (suite)
"La pornographie" de Witold Gombrowicz
 Gombrowicz
est un prestidigitateur qui nous balade dans les bois sombres, dans la
forêt touffue de ses fantastiques et fantasmagoriques divagations.
Cette fois, il s'attaque au chapitre de l'érotisme qu'il s'attache à
renouveler et il y réussit au-delà de toute espérance : il va si loin
dans l'insolite, dans le dépaysement que la déroute est aussi totale
qu'est complet l'enchantement. Car il invente des chemins et des
cheminements qu'on ne savait pas pouvoir emprunter. Et il égare, avec
une évidente délectation, les processus et les procédés ordinaires. (suite)
Gombrowicz
est un prestidigitateur qui nous balade dans les bois sombres, dans la
forêt touffue de ses fantastiques et fantasmagoriques divagations.
Cette fois, il s'attaque au chapitre de l'érotisme qu'il s'attache à
renouveler et il y réussit au-delà de toute espérance : il va si loin
dans l'insolite, dans le dépaysement que la déroute est aussi totale
qu'est complet l'enchantement. Car il invente des chemins et des
cheminements qu'on ne savait pas pouvoir emprunter. Et il égare, avec
une évidente délectation, les processus et les procédés ordinaires. (suite)
"Visage vive" de
Matthieu Gosztola (Gros Textes)
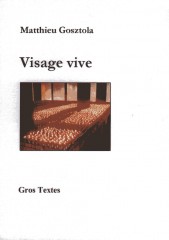 Les poèmes ici
rassemblés sont
d’une délicatesse telle qu’on peut longtemps ignorer quelle est la
nature de la
douleur évoquée et combien elle est perçante. On peut confondre, croire
que
l’homme qui exhale sa douce plainte déplore la défection d’une femme
aimée. La gravité réelle de
la perte
subie ne se dessine que graduellement, au fil des mots aériens, presque
vaporeux de Matthieu Goztola. On dirait que l’auteur a à cœur
d’épargner, non seulement lui-même et le lecteur, mais le texte
lui-même :
c’est comme s’il veillait à ne pas trop brutaliser les mots afin que la
douleur, si brûlante, ne se propage pas trop vite ni trop loin. C’est
une
tentative de circonscription de la douleur qui pourtant s’échappe et
imprime sa
marque de manière d’autant plus prégnante. (suite)
Les poèmes ici
rassemblés sont
d’une délicatesse telle qu’on peut longtemps ignorer quelle est la
nature de la
douleur évoquée et combien elle est perçante. On peut confondre, croire
que
l’homme qui exhale sa douce plainte déplore la défection d’une femme
aimée. La gravité réelle de
la perte
subie ne se dessine que graduellement, au fil des mots aériens, presque
vaporeux de Matthieu Goztola. On dirait que l’auteur a à cœur
d’épargner, non seulement lui-même et le lecteur, mais le texte
lui-même :
c’est comme s’il veillait à ne pas trop brutaliser les mots afin que la
douleur, si brûlante, ne se propage pas trop vite ni trop loin. C’est
une
tentative de circonscription de la douleur qui pourtant s’échappe et
imprime sa
marque de manière d’autant plus prégnante. (suite)
"Un âge irresponsable" de Lavinia Greenlaw (Joëlle Losfeld)
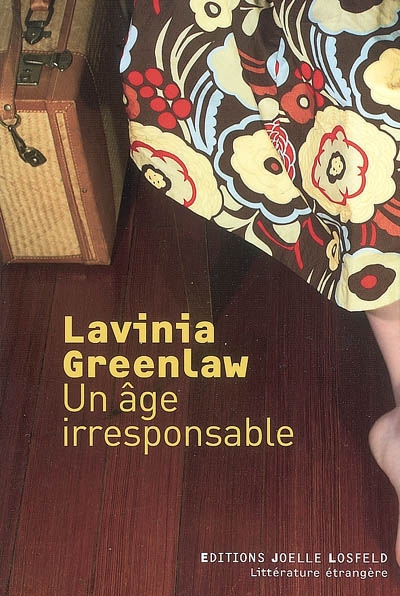 C'est un livre
traître. Il
paraît léger, aérien, d'une parfaite innocuité.
On pourrait presque croire qu'il distille l'ennui et être sur le point
de le refermer quand tout à coup quelque chose se condense et se
cristallise, un charme étrange se met à agir, le texte prend corps et
on est pris, on embarque allégrement, on ne craint plus le long
cours. (suite)
C'est un livre
traître. Il
paraît léger, aérien, d'une parfaite innocuité.
On pourrait presque croire qu'il distille l'ennui et être sur le point
de le refermer quand tout à coup quelque chose se condense et se
cristallise, un charme étrange se met à agir, le texte prend corps et
on est pris, on embarque allégrement, on ne craint plus le long
cours. (suite)
"Sous vide" de Jean-Pierre Guillard (Les Fondeurs de briques)
 C'est
une odyssée intérieure d'autant plus saisissante qu'involontaire. Une
expérience des confins. Une aventure sensorielle extrême à rebours de
ce que cette expression recouvre ordinairement.
C'est
une odyssée intérieure d'autant plus saisissante qu'involontaire. Une
expérience des confins. Une aventure sensorielle extrême à rebours de
ce que cette expression recouvre ordinairement.
Un étrécissement du monde. Une plongée dans des eaux plus que troubles, plus que saumâtres. A la suite d'une agression, l'auteur, peintre de son état, perd le sens du goût et de l'odorat, troubles qui répondent aux doux noms d'agueusie et anosmie. C'est là que débute son entreprise littéraire, laquelle s'apparente à une opération de survie. (suite)
"La grande musique" de Kirsty Gunn (Christian Bourgois)
C'est un texte d'une singularité telle qu'on peine à le qualifier. Un texte qui procède de la musique et qui tend, par les mots, à traduire l'essence même de la musique. C'est aussi, et simultanément, un récit fiévreux, sauvage, qui se déroule dans un lieu non moins sauvage. Dans les confins désolés et tempétueux d'une Écosse inhospitalière et propre à enflammer l'imagination. Et l'histoire qui est distillée diachroniquement, anachroniquement, par bonds, voltes et court-circuits, est d'un romantisme effréné. C'est un peu "Les Hauts de Hurlevents" scandés selon le tempo de la cornemuse. (suite)
"Trilogie sale de la Havane" de Pedro Juan Gutiérrez (10/18)
 Vous qui entrez
ici,
abandonnez toute velléité de raffinement.
Ici, c'est du cru, du pulsant, du pulsionnel absolu. Ici le corps est
roi, d'une royauté déchue, il se commet avec l'ordure, l'abjection, il
n'écoute que ses humeurs, ses appétits, il a de constants démêlés avec
la peur, la faim, la violence, la souillure, il a sans cesse à en
découdre pour sa survie. Nous sommes à Cuba au début des années
90 et le narrateur, Pedro Juan, tenant une sorte de journal erratique
et ventral, orchestre une visite guidée du chaos, de la vie éclatée et
nous offre une chronique magistrale de Cuba en ses bas-fonds. (suite)
Vous qui entrez
ici,
abandonnez toute velléité de raffinement.
Ici, c'est du cru, du pulsant, du pulsionnel absolu. Ici le corps est
roi, d'une royauté déchue, il se commet avec l'ordure, l'abjection, il
n'écoute que ses humeurs, ses appétits, il a de constants démêlés avec
la peur, la faim, la violence, la souillure, il a sans cesse à en
découdre pour sa survie. Nous sommes à Cuba au début des années
90 et le narrateur, Pedro Juan, tenant une sorte de journal erratique
et ventral, orchestre une visite guidée du chaos, de la vie éclatée et
nous offre une chronique magistrale de Cuba en ses bas-fonds. (suite)
"Les écrits d'Etty Hillesum" (Seuil)
 Ceci
n'est pas un livre, c'est une bombe, une déflagration continue. Et ce
n'est pas un journal intime, c'est un manifeste, un traité
révolutionnaire. C'est un foudroiement sans pareil, une claque
magistrale. Voici une jeune femme néerlandaise de 27 ans qui
évolue dans le tumulte de la seconde guerre mondiale. Elle se nomme
Etty Hillesum, elle est juive mais surtout dotée d'un prodigieux
appétit de vivre et d'une appétence spirituelle pareillement dévorante,
proportionelle aux désirs charnels qui la tenaillent. (suite)
Ceci
n'est pas un livre, c'est une bombe, une déflagration continue. Et ce
n'est pas un journal intime, c'est un manifeste, un traité
révolutionnaire. C'est un foudroiement sans pareil, une claque
magistrale. Voici une jeune femme néerlandaise de 27 ans qui
évolue dans le tumulte de la seconde guerre mondiale. Elle se nomme
Etty Hillesum, elle est juive mais surtout dotée d'un prodigieux
appétit de vivre et d'une appétence spirituelle pareillement dévorante,
proportionelle aux désirs charnels qui la tenaillent. (suite)
"Scarborough" de Christophe Honoré (L'Olivier)
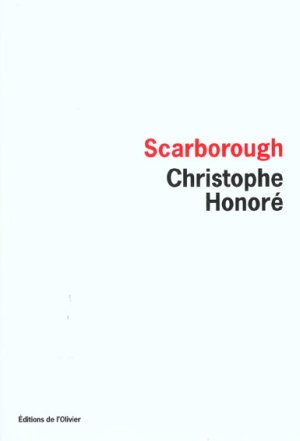 La
barque est un peu
chargée. Jugez plutôt : dans un texte liminaire, on nous annonce que
les deux protagonistes, Baptiste et Steven, deux frères, ont fui la
France pour l'Angleterre. L'un des deux est un lâche, nous apprend-on,
l'autre un criminel. Ils sont en outre porteurs d'un secret qui les
désigne à la vindicte publique : ils sont amants. Ils débarquent dans
un port, Scarborough. (suite)
La
barque est un peu
chargée. Jugez plutôt : dans un texte liminaire, on nous annonce que
les deux protagonistes, Baptiste et Steven, deux frères, ont fui la
France pour l'Angleterre. L'un des deux est un lâche, nous apprend-on,
l'autre un criminel. Ils sont en outre porteurs d'un secret qui les
désigne à la vindicte publique : ils sont amants. Ils débarquent dans
un port, Scarborough. (suite)
"Attachements" de Victoria Horton (Quidam éditeur)
Le texte de Victoria Horton est une savante et subtile traîtrise. Il se déroule d'abord longuement comme un ruban pâle et soyeux, sans aspérité repérable ou prononcée. On pourrait presque confondre et lui confier un rôle dans une confite et assommante cérémonie familiale tant il paraît tout d'innocuité. C'est un roman épistolaire à la mode contemporaine c'est-à-dire qu'aux classiques missives se mêlent des mails (ou courriels) et la célérité, l'instantanéité qui caractérisent ces envois-là traduisent bien l'urgence dans laquelle se trouvent les personnages. (suite)
"La côte sauvage" de Jean-René Huguenin
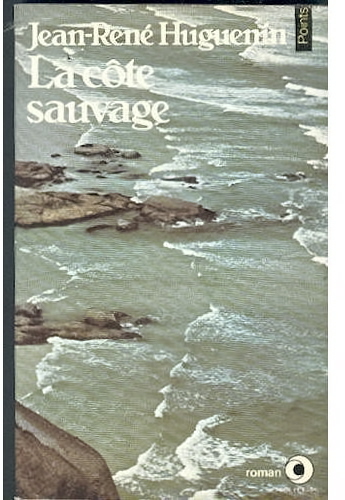 C'est
un texte pur comme un cristal. Vibrant du souffle de l'extrême
jeunesse. Passé par le fil de l'épée. L'histoire est éternelle. C'est
l'amour. L'impossible. Le consanguin. La tragédie cent fois tissée au
fil de la littérature mais ici revirginisée. Olivier, jeune homme
ombrageux revient dans la bretonne
propriété familiale après deux ans passés au service militaire. (suite)
C'est
un texte pur comme un cristal. Vibrant du souffle de l'extrême
jeunesse. Passé par le fil de l'épée. L'histoire est éternelle. C'est
l'amour. L'impossible. Le consanguin. La tragédie cent fois tissée au
fil de la littérature mais ici revirginisée. Olivier, jeune homme
ombrageux revient dans la bretonne
propriété familiale après deux ans passés au service militaire. (suite)
"Un souvenir indécent" d'Agustina Izquierdo
C'est un texte de cruauté et de foudre fissile. Un texte qui n'épargne personne, ni les protagonistes ni le lecteur. Tout est coupant, sans douceur ni consolation possibles. Il s'agit d'amour mais d'un amour noir et qui persécute. Une histoire d'envoûtement, de possession, de presque vampirisme. Nous sommes à Barcelone dans les années 30 et dans un climat insurrectionnel. Et c'est, sur fond de grondement révolutionnaire, le portrait fragmentaire d'une femme qui demeure opaque, impénétrable dans toutes les acceptions du terme. (suite)
"L'amour pur" d'Agustina Izquierdo
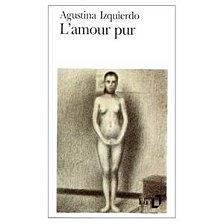 C'est un
livre de folie
et de sagesse profonde. Un livre à l'os où la chair est reine et
muselée. Cest
une histoire à tordre l'âme dans un autrefois qui pourrait être
maintenant et toujours, dans une Espagne qui pourrait être ici et
ailleurs. C'est l'universalité, la grande prodigalité de l'amour
impossible condensé dans deux corps qui battent à l'unisson mais dont
l'un fait en sorte et sans trêve que ce soit à contretemps. (suite)
C'est un
livre de folie
et de sagesse profonde. Un livre à l'os où la chair est reine et
muselée. Cest
une histoire à tordre l'âme dans un autrefois qui pourrait être
maintenant et toujours, dans une Espagne qui pourrait être ici et
ailleurs. C'est l'universalité, la grande prodigalité de l'amour
impossible condensé dans deux corps qui battent à l'unisson mais dont
l'un fait en sorte et sans trêve que ce soit à contretemps. (suite)
"Iceberg Memories" d'Ophélie Jaësan (Actes Sud)
 Ophélie
Jaësan évolue sur un fil si ténu que c'est le souffle retenu et parfois
coupé qu'on la suit, qu'on l'accompagne dans la crainte constante
qu'elle ne se brise. Sa voix est murmurée, c'est un chuchotement frêle,
une confidence sectionnée de partout et, en dépit de toute cette
apparente
fragilité, la violence amassée entre ces pages est extrême. (suite)
Ophélie
Jaësan évolue sur un fil si ténu que c'est le souffle retenu et parfois
coupé qu'on la suit, qu'on l'accompagne dans la crainte constante
qu'elle ne se brise. Sa voix est murmurée, c'est un chuchotement frêle,
une confidence sectionnée de partout et, en dépit de toute cette
apparente
fragilité, la violence amassée entre ces pages est extrême. (suite)
"Cyclone" de Frédéric-Yves Jeannet (Argol)
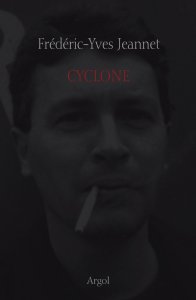 Voici un
livre-événement,
un livre-somme, un choc prolongé, un
rapt continu, un lancinant et langoureux vertige. C'est
à une minutieuse scrutation que nous convie Frédéric-Yves Jeannet, il
s'agit pour le lecteur de s'engager dans le sillage de ce
spéléologue-explorateur-clinicien. Géologue du verbe et du sens qui
examine sans relâche les strates successives et entrechoquées de sa
propre vie. (suite)
Voici un
livre-événement,
un livre-somme, un choc prolongé, un
rapt continu, un lancinant et langoureux vertige. C'est
à une minutieuse scrutation que nous convie Frédéric-Yves Jeannet, il
s'agit pour le lecteur de s'engager dans le sillage de ce
spéléologue-explorateur-clinicien. Géologue du verbe et du sens qui
examine sans relâche les strates successives et entrechoquées de sa
propre vie. (suite)
"Renégat, roman du temps nerveux" de Reinhard Jirgl (Quidam éditeur)
Le titre, éclair flagrant, tout du sublime fulgurance, sonne comme une très évocatrice déclaration d'intention et presque de guerre. Et, de fait, c'est un livre intimidant et qui intime de se soulever par-delà l'ordinaire pour être à la hauteur de ce qui se joue en lui. Car c'est un défi permanent que ce texte-là propose au lecteur, l'esprit dudit étant soumis à des secousses, heurts, embardées, glissements et dérapages qui chahutent en tous sens. (suite)
"Goldberg :
variations"
de Gabriel Josipovici (Quidam éditeur)
C'est un texte provocateur. De doutes, d'instabilité, de surprises, d'effervescences multiples. Un texte sans entrée discernable ni dénouement visible. Un fascinant dédale mental. C'est un récit-gigogne à l'envers : tout procède du même foyer mais c'est une force centrifuge qui propulse les fragments les uns à la suite des autres. C'est aussi quelque chose comme une aimable plaisanterie, une métaphore étincelante, une mise en abyme coruscante, facétieuse, ludique, filée tout au long du texte. (suite)
"Tout passe" de Gabriel Josipovici
 C'est
un texte troué et nu. D'une nudité extrême. Un texte à l'os, raclé,
défait de tout surplus et de tout superflu. Ce sont des pans de vie
nue, des instants prélevés sur le vif et qui se répercutent d'autant
plus violemment que le vide, autour, est un vertige. Un homme se
tient, seul, dans une pièce. Il se soumet à l'expérience pascalienne et
lui remontent dans le corps, par flux et saccades, des fragments de
scènes anciennes ou récentes, anodines ou cruciales mais toutes
signifiantes. (suite)
C'est
un texte troué et nu. D'une nudité extrême. Un texte à l'os, raclé,
défait de tout surplus et de tout superflu. Ce sont des pans de vie
nue, des instants prélevés sur le vif et qui se répercutent d'autant
plus violemment que le vide, autour, est un vertige. Un homme se
tient, seul, dans une pièce. Il se soumet à l'expérience pascalienne et
lui remontent dans le corps, par flux et saccades, des fragments de
scènes anciennes ou récentes, anodines ou cruciales mais toutes
signifiantes. (suite)
"Moo Pak" de Gabriel Josipovici (Quidam éditeur)
 EnsorC'est
une transe circulaire et déambulatoire qui agit comme un puissant
hypnotique. Un hypnotique qui, dans le même temps qu'il soumet et
jugule, survolte. Le narrateur rapporte les monologues, les
soliloques hantés de son ami Jack Toledano lequel, au fil de leurs
pérégrinations à travers Londres, développe considérations et
réflexions qui s'entrechoquent, se catapultent, fermentent, se
ramifient et se déversent dans une prose torrentielle. (suite)
EnsorC'est
une transe circulaire et déambulatoire qui agit comme un puissant
hypnotique. Un hypnotique qui, dans le même temps qu'il soumet et
jugule, survolte. Le narrateur rapporte les monologues, les
soliloques hantés de son ami Jack Toledano lequel, au fil de leurs
pérégrinations à travers Londres, développe considérations et
réflexions qui s'entrechoquent, se catapultent, fermentent, se
ramifient et se déversent dans une prose torrentielle. (suite)
"Cloués au port" de Jacques Josse (Quidam éditeur)
 C'est
un texte dans lequel on entend respirer et battre les silences. Un
texte qui explore les ressorts et les ressources de la mutité. C'est
un bref texte comme craché mais aussi enlevé et ciselé qui ravive, au
creux d'un petit port breton, d'éternelles figures cependant saisies
dans toute leur subtile singularité. Au premier rang desquelles le
Capitaine, massif et charismatique personnage, qui détient la haute
main sur la parole propagée. (suite)
C'est
un texte dans lequel on entend respirer et battre les silences. Un
texte qui explore les ressorts et les ressources de la mutité. C'est
un bref texte comme craché mais aussi enlevé et ciselé qui ravive, au
creux d'un petit port breton, d'éternelles figures cependant saisies
dans toute leur subtile singularité. Au premier rang desquelles le
Capitaine, massif et charismatique personnage, qui détient la haute
main sur la parole propagée. (suite)
"Fever" de Leslie Kaplan (P.O.L)
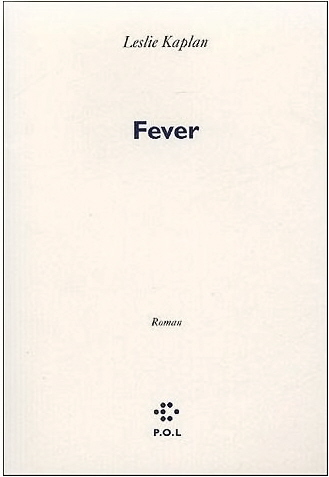 "Fever",
c'est l'effervescence adolescente, la fièvre des sens et de l'esprit
qui
s'empare de Damien et de Pierre , deux inséparables et exemplaires
élèves de terminale. Subjugués
par leur jolie et excellente prof de philo, Mme Martin, ils s'enivrent
de la capacité réflexive qu'ils se découvrent. Tournant autour des
notions de déterminisme et de hasard, ils s'échauffent, ils décident
d'accomplir un acte gratuit, régi par le seul hasard. (suite)
"Fever",
c'est l'effervescence adolescente, la fièvre des sens et de l'esprit
qui
s'empare de Damien et de Pierre , deux inséparables et exemplaires
élèves de terminale. Subjugués
par leur jolie et excellente prof de philo, Mme Martin, ils s'enivrent
de la capacité réflexive qu'ils se découvrent. Tournant autour des
notions de déterminisme et de hasard, ils s'échauffent, ils décident
d'accomplir un acte gratuit, régi par le seul hasard. (suite)
"Le pont de Brooklyn" de Leslie Kaplan (Ed. P.O.L)
"Le pont de Brooklyn" c'est cinq personnages, quatre adultes et un enfant, pris dans le bouillonnement fiévreux de New-York. Il ya deux jeunes femmes, Mary et Anna et deux hommes jeunes Julien et Chico. Ey il y a Nathalie, l'enfant de Mary. Au début c'est une ballade, les uns et les autres se croisent, déambulent, se rencontrent au parc, au restaurant, dans leurs logements respectifs. (suite)
"Corniche Kennedy" de Maylis de Kerangal (Verticales)
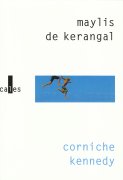 C'est un
livre dont
les
phrases claquent comme des coups de fouet. Un récit mené à fond de
train, à plein régime, à bride abattue. Un texte sous haute tension
dont le voltage , la forte charge électrique jamais ne fléchit. C'est
un texte qui braque sa lumière sur les corps, les
projette en avant, les saisit dans leurs danses pulsionnelles, leurs
transes voltigeuses. Ce sont les corps marqués par les outrances et
outrecuidances adolscentes ou par les stigmates et déglingues d'une vie
cahotée. (suite)
C'est un
livre dont
les
phrases claquent comme des coups de fouet. Un récit mené à fond de
train, à plein régime, à bride abattue. Un texte sous haute tension
dont le voltage , la forte charge électrique jamais ne fléchit. C'est
un texte qui braque sa lumière sur les corps, les
projette en avant, les saisit dans leurs danses pulsionnelles, leurs
transes voltigeuses. Ce sont les corps marqués par les outrances et
outrecuidances adolscentes ou par les stigmates et déglingues d'une vie
cahotée. (suite)
"Fermer l’œil de la
nuit" de
Pauline Klein (Allia)
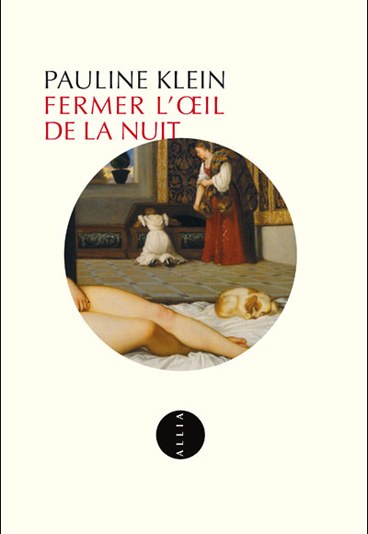 C’est un éclat de
rire déguisé en
pure candeur. Une souriante et parfois cinglante ironie qui prend des
allures
de vaporeuse ritournelle. C’est une ironie
enlevée,
suspendue, un humour à froid, avec des ellipses, un humour tout troué
d’ellipses comme on retient un souffle. C’est aussi une
souriante et
parfois riante expérience. Car Pauline Klein va loin dans le dynamitage
ludique : elle se joue des codes au sein de ces mêmes codes, elle
déroule
des écheveaux qu’elle cisaille à mesure, elle se délecte à se faire
Parque des
vies qu’elle tisse. (suite)
C’est un éclat de
rire déguisé en
pure candeur. Une souriante et parfois cinglante ironie qui prend des
allures
de vaporeuse ritournelle. C’est une ironie
enlevée,
suspendue, un humour à froid, avec des ellipses, un humour tout troué
d’ellipses comme on retient un souffle. C’est aussi une
souriante et
parfois riante expérience. Car Pauline Klein va loin dans le dynamitage
ludique : elle se joue des codes au sein de ces mêmes codes, elle
déroule
des écheveaux qu’elle cisaille à mesure, elle se délecte à se faire
Parque des
vies qu’elle tisse. (suite)
" La fille de l’air" de Sophie Koltcha (Mercure de France)
 Voici un texte comme
un tour de
prestidigitation infiniment délicat. Un texte qui cache son jeu et ses
enjeux
ou plutôt qui les dévoile à mesure, et par petites touches, mais de
manière si
subtile et virtuose qu’on est à la fois charmé et comme étourdi. On
pourrait croire à
un énième
roman d’apprentissage, à une classique éducation sentimentale et les
figures
travaillées sont on ne peut plus éculées puisqu’il s’agit d’une part de
la
jeune étudiante piquante, intrépide s’éprenant d’un quadragénaire marié
et
d’autre part de l’amitié passionnée, teintée de désir mimétique, que la
narratrice éprouve pour ladite étudiante. (suite)
Voici un texte comme
un tour de
prestidigitation infiniment délicat. Un texte qui cache son jeu et ses
enjeux
ou plutôt qui les dévoile à mesure, et par petites touches, mais de
manière si
subtile et virtuose qu’on est à la fois charmé et comme étourdi. On
pourrait croire à
un énième
roman d’apprentissage, à une classique éducation sentimentale et les
figures
travaillées sont on ne peut plus éculées puisqu’il s’agit d’une part de
la
jeune étudiante piquante, intrépide s’éprenant d’un quadragénaire marié
et
d’autre part de l’amitié passionnée, teintée de désir mimétique, que la
narratrice éprouve pour ladite étudiante. (suite)
"Portrait(s) de George" d'Emmelene Landon (Actes Sud)
 Voici un texte allègre,
véloce,
qui foisonne de chaleur, de vie. Et déborde d'empathie. C'est aussi un
texte
infiniment délicat, un texte tout en nuances qui épouse les méandres et
les
fluctuations d'une âme subtile et chahutée. Car c'est l'âme d'une
créatrice
qu'Emmelene Landon nous rend lisible et pénétrable ou presque. Elle
nous rend au
moins sensibles les ondes telluriques qu'elle enregistre et qui la
percutent. L'énigmatique George
du titre est
une femme peintre qui nous invite dans son atelier et nous initie moins
aux
secrets de son art qu'aux liens insolites, singuliers, qui l'unissent
aux
modèles dont elle brosse le portrait. (suite)
Voici un texte allègre,
véloce,
qui foisonne de chaleur, de vie. Et déborde d'empathie. C'est aussi un
texte
infiniment délicat, un texte tout en nuances qui épouse les méandres et
les
fluctuations d'une âme subtile et chahutée. Car c'est l'âme d'une
créatrice
qu'Emmelene Landon nous rend lisible et pénétrable ou presque. Elle
nous rend au
moins sensibles les ondes telluriques qu'elle enregistre et qui la
percutent. L'énigmatique George
du titre est
une femme peintre qui nous invite dans son atelier et nous initie moins
aux
secrets de son art qu'aux liens insolites, singuliers, qui l'unissent
aux
modèles dont elle brosse le portrait. (suite)
"Cahiers d'enfance" de Norah Lange (éd. Christian Bourgois)
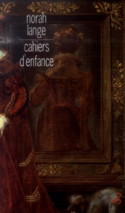 Les
souvenirs d'enfance de Norah Lange sont des vitraux découpés à même le
gel. Ils brillent, scintillent et se détachent avec une précision
inouïe. Chaque détail est d'une netteté tranchante, un trait pur et
sans repentir. Cela, qui émerge, se passe en Argentine au début
du XX° siècle mais cela pourrait se produire à peu près n'importe quand
et sous n'importe quelles latitudes tant ce qui importe ce n'est pas
l'inscription dans le temps et dans l'espace mais l'essence même de
l'enfance que Norah Lange ressuscite avec une éblouissante maestria
doublée d'une économie de moyens impressionnante. (suite)
Les
souvenirs d'enfance de Norah Lange sont des vitraux découpés à même le
gel. Ils brillent, scintillent et se détachent avec une précision
inouïe. Chaque détail est d'une netteté tranchante, un trait pur et
sans repentir. Cela, qui émerge, se passe en Argentine au début
du XX° siècle mais cela pourrait se produire à peu près n'importe quand
et sous n'importe quelles latitudes tant ce qui importe ce n'est pas
l'inscription dans le temps et dans l'espace mais l'essence même de
l'enfance que Norah Lange ressuscite avec une éblouissante maestria
doublée d'une économie de moyens impressionnante. (suite)
"Délaissé" de Fred Léal (P.O.L)
Il faut le dire d'emblée : ni le texte ni le personnage ne sont plaisants. Ils rebutent l'un et l'autre (probablement parce que le narrateur s'énonce à la première pesonne et que c'est lui la voix du texte), ils exaspèrent dans la même mesure. C'est une parole hirsute, revêche, que déploie un homme incertain et faussement désinvolte. Et ce dernier, donc, on pourrait hâtivement l'expédier dans la catégorie des pauvres types si le texte entier ne s'ingéniait à le décliner sur le mode ambivalent et complexe. (suite)
"Attention" de Heather Lewis (P.O.L)
Vous qui franchissez le seuil de ce livre, abandonnez tout espoir. Préparez-vous à une plongée en apnée sans remontée aucune. Vous allez connaître une asphyxie progressive qui produit paradoxalement un effet de fascination et même d'hypnose. Lire ce livre équivaut à prendre une drogue violente : on est mal mais on est envoûté, on ne peut le lâcher. C'est un minutieux dépeçage, la scrupuleuse restitution d'une descente dans un enfer (qui est d'abord un enfermement) mental. On est immergé sans prévenir et sans ménagements dans l'intériorité distordue d'une jeune prostituée (suite)
"Ullung-do"
de Jung Lim (Galilée)
 C'est un texte d'une
délicatesse
arachnéenne et telle qu'il pourrait paraître vaporeux voire nébuleux.
Il
procède par touches sensibles, vibratoires et dans une douceur ouatée,
presque
engourdie, engourdissante. C'est un récit qui a des allures de roman
d'apprentissage, de parcours initiatique mais il excède d'emblée ces
catégories. On se trouve en Corée, à une époque indéterminée. La
narratrice
revient sur un épisode décisif de sa prime jeunesse. Elle en restitue,
chemin
faisant, non pas tant les plus infimes détails que les plus intimes
pulsations. (suite)
C'est un texte d'une
délicatesse
arachnéenne et telle qu'il pourrait paraître vaporeux voire nébuleux.
Il
procède par touches sensibles, vibratoires et dans une douceur ouatée,
presque
engourdie, engourdissante. C'est un récit qui a des allures de roman
d'apprentissage, de parcours initiatique mais il excède d'emblée ces
catégories. On se trouve en Corée, à une époque indéterminée. La
narratrice
revient sur un épisode décisif de sa prime jeunesse. Elle en restitue,
chemin
faisant, non pas tant les plus infimes détails que les plus intimes
pulsations. (suite)
"Des roses rouge vif" d'Adriana Lisboa (Métailié)
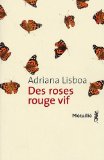 C'est un roman
qui
s'avance masqué. Un piège ensorceleur qui se referme sur le lecteur.
Des cailloux de petite poucette sont semés en grand nombre le long du
chemin, lovés au creux des phrases. On frémit parce qu'on sait avant de
savoir, l'art consommé du subliminal, les indices distillés en
filigrane, en transparence, agissent avec force et pourtant la
révélation finale produit l'effet d'un choc tétanique. (suite)
C'est un roman
qui
s'avance masqué. Un piège ensorceleur qui se referme sur le lecteur.
Des cailloux de petite poucette sont semés en grand nombre le long du
chemin, lovés au creux des phrases. On frémit parce qu'on sait avant de
savoir, l'art consommé du subliminal, les indices distillés en
filigrane, en transparence, agissent avec force et pourtant la
révélation finale produit l'effet d'un choc tétanique. (suite)
"Enquête aux quatre confidences" de Maria Gabriela Llansol (Pagine d’Arte)
 Voici, sous la forme
apparente
d’un journal intime, un texte sidéral, surgi d’un monde galactique, un
poudroiement d’étoiles, une queue de comète qui est aussi, en soi, une
cosmogonie
entière et irréductible. Cela n’a rien d’une
notation
circonstanciée des travaux et des jours. Ce sont les trajets, les
heurts,
pointes, percées, embardées et fulgurations d’une âme. Mais une âme si
singulière qu’elle génère non pas seulement sa propre langue mais aussi
un mode
de pensée unique et insubstituable. Avec Maria Gabriela
Llansol, on
n’est jamais ni en terrain conquis ni même en terrain familier. On va
de
décrochage en décrochage, on est projeté dans un paysage stellaire,
post
apocalyptique. (suite)
Voici, sous la forme
apparente
d’un journal intime, un texte sidéral, surgi d’un monde galactique, un
poudroiement d’étoiles, une queue de comète qui est aussi, en soi, une
cosmogonie
entière et irréductible. Cela n’a rien d’une
notation
circonstanciée des travaux et des jours. Ce sont les trajets, les
heurts,
pointes, percées, embardées et fulgurations d’une âme. Mais une âme si
singulière qu’elle génère non pas seulement sa propre langue mais aussi
un mode
de pensée unique et insubstituable. Avec Maria Gabriela
Llansol, on
n’est jamais ni en terrain conquis ni même en terrain familier. On va
de
décrochage en décrochage, on est projeté dans un paysage stellaire,
post
apocalyptique. (suite)
"Finita" de Maria Gabriela Llansol (Pagine D'Arte)
 Voici
un texte qui sort, qui s'extrait de tout à proportion même où il entre
et pénètre au plus profond. Un
texte qui s'excepte de tout genre, de toute catégorie, même du journal
intime auquel il semble d'abord ressortir. On est dans un journal dans
la mesure où les fragments sont datés, situés dans le temps
(entre novembre 1974 et août 1977) et on est, semble-t-il, aussi dans
l'intime puisque l'auteur, Maria Gabriela Llansol, puise dans sa
substance la plus secrète, la plus profonde. Mais le secret, la
substance profonde et l'intime ne se recouvrent pas nécessairement même
s'ils peuvent le faire. (suite)
Voici
un texte qui sort, qui s'extrait de tout à proportion même où il entre
et pénètre au plus profond. Un
texte qui s'excepte de tout genre, de toute catégorie, même du journal
intime auquel il semble d'abord ressortir. On est dans un journal dans
la mesure où les fragments sont datés, situés dans le temps
(entre novembre 1974 et août 1977) et on est, semble-t-il, aussi dans
l'intime puisque l'auteur, Maria Gabriela Llansol, puise dans sa
substance la plus secrète, la plus profonde. Mais le secret, la
substance profonde et l'intime ne se recouvrent pas nécessairement même
s'ils peuvent le faire. (suite)
"Décharges" de Virginie Lou-Nony (Actes-Sud)
 C'est
un texte sur lequel pèse, tout du long, une menace sourde comme une
charge orageuse qui jamais n'éclate franchement mais étrangle peu à
peu, et jusqu'à l'asphyxie, le souffle saccadé du texte. Les
êtres qui peuplent ce récit évoluent dans des zones frontalières,
limitrophes entre la vie et la survie. Ce sont des déshérités, des
sinistrés que chaque geste quotidien marque du sceau indélébile de
l'exclusion. (suite)
C'est
un texte sur lequel pèse, tout du long, une menace sourde comme une
charge orageuse qui jamais n'éclate franchement mais étrangle peu à
peu, et jusqu'à l'asphyxie, le souffle saccadé du texte. Les
êtres qui peuplent ce récit évoluent dans des zones frontalières,
limitrophes entre la vie et la survie. Ce sont des déshérités, des
sinistrés que chaque geste quotidien marque du sceau indélébile de
l'exclusion. (suite)
"Le bruit des autres" d'Amy Grace Loyd (Stock)
C'est un livre de pointe, de douceur trompeuse et de lancinante captation. Un texte qui s'effile sur le tranchant de l'impossible, qui se tient en lisière de ce qui ne se peut pas, juste en-deçà. C'est un récit qui procède par voltes souples et gracieuses et qui happe sans qu'on puisse opposer la moindre résistance active. C'est aussi un texte qui, sous des dehors d'innocuité, bascule imperceptiblement dans une moiteur sensuelle et toxique. Il s'agit de Celia, jeune veuve propriétaire d'un immeuble à Brooklyn. Dévastée par la mort de son mari, elle se dissout dans une langueur proche de la torpeur. (suite)
"La voie cruelle" d'Ella Maillart
... l'intérêts principal du livre réside dans le portrait, disséminé à travers les pages, qu'elle brosse de sa compagne de voyage, Annemarie Schwarzenbach. A l'époque où débute le récit (en juin 1939), cette dernière relève d'une cure de désintoxication, elle est encore très faible mais armée d'une volonté farouche : elle tient absolument à accompagner Ella Maillart dans son voyage ... (suite)
"L'ange incliné" de Pierre Mari (Actes Sud)
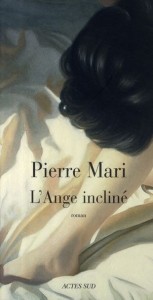 C'est
un livre précieux comme un secret offert, une donation fragile. C'est
une écriture de crête, la bride haut tenue par l'amour sacré de la
langue. Un phrasé délicat et ferme. Une odyssée intérieure, une prose
élégante qui en épouse les pics, les cieux, les vacillements. Un
texte brûlé, irradié en son centre par un miracle. Un style tendu,
sobre, tout de ferveur contenue. (suite)
C'est
un livre précieux comme un secret offert, une donation fragile. C'est
une écriture de crête, la bride haut tenue par l'amour sacré de la
langue. Un phrasé délicat et ferme. Une odyssée intérieure, une prose
élégante qui en épouse les pics, les cieux, les vacillements. Un
texte brûlé, irradié en son centre par un miracle. Un style tendu,
sobre, tout de ferveur contenue. (suite)
"De l'autre côté de l'hiver" de Benjamin Markovitz (Ed. Phébus)
C'est un roman qui n'a l'air de rien. Facture classique, écriture lisse (quoique raffinée), personnages assez stéréotypés, procédé éprouvé (4 parties, 4 personnages, chaque partie étant dédiée à l'une des figures qui intervient, satellisée, dans la partition des trois autres). Rien de novateur, donc et pourtant quelque chose. Quelque chose mais quoi ? (suite)
"Portrait robot Mon père, Portrait robot Ma mère" de Christoph Meckel (Quidam éditeur)
 C'est
un livre double à un seul tranchant. Un seul tranchant dédoublé. La
piété filiale vue, visée et découpée sous un angle très singulier. Un
regard qui cadre, coupe et dissèque, un regard chirurgical qui
accomplit cependant le tour de force de n'être (pour une part, du
moins) pas dénué de compassion ni d'amour. Quelques
années après la mort de son père, l'auteur, Christoph Meckel, met la
main sur le journal intime dudit père et les mots qu'il découvre alors
manquent de l'anéantir tant ils exigent de lui un remaniement total,
une refonte intégrale de l'image paternelle. (suite)
C'est
un livre double à un seul tranchant. Un seul tranchant dédoublé. La
piété filiale vue, visée et découpée sous un angle très singulier. Un
regard qui cadre, coupe et dissèque, un regard chirurgical qui
accomplit cependant le tour de force de n'être (pour une part, du
moins) pas dénué de compassion ni d'amour. Quelques
années après la mort de son père, l'auteur, Christoph Meckel, met la
main sur le journal intime dudit père et les mots qu'il découvre alors
manquent de l'anéantir tant ils exigent de lui un remaniement total,
une refonte intégrale de l'image paternelle. (suite)
"Roman à clefs" d'Alizé Meurisse (Allia)
 Alizé
Meurisse a encore quelque chose de la petite fille facétieuse qui saute
à cloche-pied sur la marelle de ses rêves. Elle vise le ciel mais ne
dédaigne pas les pauses, les détours, elle aime à marauder au fil de
son écriture buissonnière. Son sens de l'observation est aiguisé
et elle excelle particulièrement dans l'art d'épingler les détails
insolites. Son texte est un drôle de tissage : elle entrelace les
saisies sur le vif et les réflexions teintées d'adolescence sur
l'amour, la dictature du paraître, la difficulté d'habiter un corps
féminin ... (suite)
Alizé
Meurisse a encore quelque chose de la petite fille facétieuse qui saute
à cloche-pied sur la marelle de ses rêves. Elle vise le ciel mais ne
dédaigne pas les pauses, les détours, elle aime à marauder au fil de
son écriture buissonnière. Son sens de l'observation est aiguisé
et elle excelle particulièrement dans l'art d'épingler les détails
insolites. Son texte est un drôle de tissage : elle entrelace les
saisies sur le vif et les réflexions teintées d'adolescence sur
l'amour, la dictature du paraître, la difficulté d'habiter un corps
féminin ... (suite)
"L'impureté
d'Irène" de Philippe Mezescaze (Arléa)
Nous sommes
à la
Rochelle le temps d'un été aux contours
indécis. L'horizon est délimité par la mer,
le temps est scandé par le visage et le corps d'une femme. Le monde est
vu à hauteur d'enfant. La femme, c'est Irène, l'enfant c'est Emile, son
fils.Emile observe, fasciné, les faits et gestes d'Irène. Mais
si le charme opère, si on frôle l'envoûtement, Emile ne quitte pas
sa position surplombante et critique d'observateur.
(suite)
"Plein présent" de Natacha Michel (Verdier)
 Natacha Michel est
une
flibustière qui opère ni en eaux troubles ni en eaux profondes ni dans
le
grande large, mais dans des eaux houleuses qui les mêlent toutes. Elle
préside surtout
aux ondes bouillonnantes,
à une incessante effervescence. Effervescence à laquelle la coupante
précision
de son verbe interdit cependant le flou et la confusion. Notre
romancière
orchestre, avec
une redoutable maestria, une partition aussi complexe que pétillante
laquelle
entrelace des motifs aussi variés que l’amitié plurielle, l’amour
bafoué, la
tentation de l’engagement politique, la guerre d’Algérie, l’ivresse du
frais
savoir, les découvertes tous azimuts,
les rapports de pouvoir, de désir et d’amour entre des âges et des
sexes qui
n’auraient jamais dû se télescoper… (suite)
Natacha Michel est
une
flibustière qui opère ni en eaux troubles ni en eaux profondes ni dans
le
grande large, mais dans des eaux houleuses qui les mêlent toutes. Elle
préside surtout
aux ondes bouillonnantes,
à une incessante effervescence. Effervescence à laquelle la coupante
précision
de son verbe interdit cependant le flou et la confusion. Notre
romancière
orchestre, avec
une redoutable maestria, une partition aussi complexe que pétillante
laquelle
entrelace des motifs aussi variés que l’amitié plurielle, l’amour
bafoué, la
tentation de l’engagement politique, la guerre d’Algérie, l’ivresse du
frais
savoir, les découvertes tous azimuts,
les rapports de pouvoir, de désir et d’amour entre des âges et des
sexes qui
n’auraient jamais dû se télescoper… (suite)
"Sita" de Kate Millett (éd. des femmes)
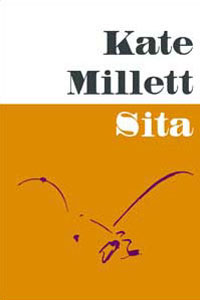 C'est
un livre dont les phrases claquent et résonnent. C'est aussi un flux
ininterompu, un monologue intérieur qui restitue, au plus près de sa
source, le ressassement qui accompagne une crise amoureuse aiguë. La
parole se livre par saccades tumulteuses, éperdues. Elle est cependant
corsetée dans des phrases nettes ciselées, du cousu main. Comme si la
rigueur du style était appelée à compenser, à endiguer le désordre de
la pensée et des sentiments. On a presque affaire à un procédé
racinien. (suite)
C'est
un livre dont les phrases claquent et résonnent. C'est aussi un flux
ininterompu, un monologue intérieur qui restitue, au plus près de sa
source, le ressassement qui accompagne une crise amoureuse aiguë. La
parole se livre par saccades tumulteuses, éperdues. Elle est cependant
corsetée dans des phrases nettes ciselées, du cousu main. Comme si la
rigueur du style était appelée à compenser, à endiguer le désordre de
la pensée et des sentiments. On a presque affaire à un procédé
racinien. (suite)
"Abîmes ordinaires" de Catherine Millot (Gallimard)
Où il est question de retournement de l'être, de "l'homme métaphysique". On visite les abîmes, certes, mais il s'y fomente une accession à l'extase. Alertée par des expériences personnelles fondatrices voire transfiguratrices, l'auteur mène l'enquête, elle interroge des cas qui lui paraissent s'apparenter au sien. Car il lui a été donné, par deux fois pendant son enfance et une fois au cours de sa jeunesse, de connaître des états d'absolu dénuement qui mystérieusement se sont mués en allégement, en transport, en illumination..(suite)
"Fake" de Giulio Minghini (Allia)
 Giulio Minghini est un
explorateur
des temps modernes, un
moraliste qui avance masqué, un fin limier qui nous conte les
mésaventures de
son double lequel s’est pris dans les rets d’une nasse qu’il pensait
contrôler. Son texte est un vertige, une transe
contemporaine, un
cauchemar qui vire et se développe à bas bruit. Au commencement, le
narrateur végète,
étrillé par une
rupture amoureuse qui l’a laissé sur le flanc. Sur les recommandations
d’une
amie pleine d’inquiète sollicitude au vu de son déclin, il
s’inscrit
sur un site de rencontres qui porte l’attrayant et peu offensif titre
de
« pointscommuns ». (suite)
Giulio Minghini est un
explorateur
des temps modernes, un
moraliste qui avance masqué, un fin limier qui nous conte les
mésaventures de
son double lequel s’est pris dans les rets d’une nasse qu’il pensait
contrôler. Son texte est un vertige, une transe
contemporaine, un
cauchemar qui vire et se développe à bas bruit. Au commencement, le
narrateur végète,
étrillé par une
rupture amoureuse qui l’a laissé sur le flanc. Sur les recommandations
d’une
amie pleine d’inquiète sollicitude au vu de son déclin, il
s’inscrit
sur un site de rencontres qui porte l’attrayant et peu offensif titre
de
« pointscommuns ». (suite)
"La disparition du monde réel" de Marc Molk
(Buchet-Chastel)
 Marc Molk est une
dentellière des
heures, un chroniqueur inspiré de la perdition douce. Chez lui, même la
violence est bien élevée, dressée à se taire, à se cacher, se
transmuer :
elle ne nous parvient que sous forme filtrée et tamisée mais percute,
sans préavis,
d’autant plus redoutablement. Marc Molk excelle à
dire la
nonchalance des heures estivales qui s’étirent et se dissolvent dans le
presque
rien. Il nous convie à un drame, une dramaturgie qui élisent pour cadre
et pour
conditions de nouement la plus grande bénignité, la plus parfaite
innocuité
apparente. (suite)
Marc Molk est une
dentellière des
heures, un chroniqueur inspiré de la perdition douce. Chez lui, même la
violence est bien élevée, dressée à se taire, à se cacher, se
transmuer :
elle ne nous parvient que sous forme filtrée et tamisée mais percute,
sans préavis,
d’autant plus redoutablement. Marc Molk excelle à
dire la
nonchalance des heures estivales qui s’étirent et se dissolvent dans le
presque
rien. Il nous convie à un drame, une dramaturgie qui élisent pour cadre
et pour
conditions de nouement la plus grande bénignité, la plus parfaite
innocuité
apparente. (suite)
"Un jeune homme triste" de Thibault de Montaigu (Ed. Fayard)
Ce pourrait être une bluette ou la plainte irritante d'un enfant gâté qui échoue à trouver un emploi valable pour son énergie. Ce pourrait être une coquille vide. Mais non. Dès les premières pages, il y a un ton, une voix, une présence qui requièrent. L'auteur, pourtant (Thibault de Montaigu, 28 ans), n'évite aucun des poncifs propres à la jeunesse dorée. Il y a là un jeune couple (Emmanuel et Camille) qui s'aime d'amour tendre et une vieille voiture qui a du cachet. (suite)
"Journée américaine" de Christine Montalbetti (P.O.L)
Dans "Journée américaine", Christine Montalbetti nous joue encore un des tours pendables dont elle a le secret. Elle se joue de nous mais avec une grâce si virtuose et un sens si consommé, si étincelant de la facétie qu'on serait malvenu de lui en tenir rigueur et qu'on en arrive même à désirer être plus souvent abusé et floué d'une façon si jubilatoire. Encore une fois, Christine Montalbetti ne se contente de s'amuser des codes et des clichés, elle ne se borne pas à broder des variations autour de figures éprouvées et de thèmes éculés. (suite)
"Petits déjeuners avec quelques écrivains célébres" de Christine Montalbetti (P.O.L)
 Christine
Montalbetti
est une rouée qui nous balade et nous égare avec une souriante
virtuosité. Son
texte est tout entier une promesse non tenue qui opère par glissements
et réalise cette acrobatie de muer l'inaugural et superficiel sentiment
déceptif en émerveillement. Car elle nous initie et nous convertit à ce
que nous n'attendions pas et qui s'avère autrement plus stimulant. Le
titre est prometteur qui nous convie à des "petits déjeuners avec
quelques écrivains célébres" et donc, semble-t-il, et ainsi que
renchérit la quatrième de couverture, à "quelque chose de doucement
people". (suite)
Christine
Montalbetti
est une rouée qui nous balade et nous égare avec une souriante
virtuosité. Son
texte est tout entier une promesse non tenue qui opère par glissements
et réalise cette acrobatie de muer l'inaugural et superficiel sentiment
déceptif en émerveillement. Car elle nous initie et nous convertit à ce
que nous n'attendions pas et qui s'avère autrement plus stimulant. Le
titre est prometteur qui nous convie à des "petits déjeuners avec
quelques écrivains célébres" et donc, semble-t-il, et ainsi que
renchérit la quatrième de couverture, à "quelque chose de doucement
people". (suite)
"Visage retrouvé" de Wajdi Mouawad (Actes Sud)
 Wajdi
Mouawad entre en littérature avec une belle candeur et un culot
mimétique de celui de Wahad, son narrateur adolescent. Ce qui est en
jeu dans son premier roman qui flirte allégrement avec la fable, c'est
"l'inquiétante étrangeté" qui s'empare du corps et de l'esprit lorsque
l'adolescence advient et frappe comme un foudroiement. Le roman
est divisé en trois parties qui couvrent trois périodes distinctes de
la vie du narrateur. (suite)
Wajdi
Mouawad entre en littérature avec une belle candeur et un culot
mimétique de celui de Wahad, son narrateur adolescent. Ce qui est en
jeu dans son premier roman qui flirte allégrement avec la fable, c'est
"l'inquiétante étrangeté" qui s'empare du corps et de l'esprit lorsque
l'adolescence advient et frappe comme un foudroiement. Le roman
est divisé en trois parties qui couvrent trois périodes distinctes de
la vie du narrateur. (suite)
"Alors Carcasse" de Mariette Navarro (Cheyne éditeur)
"Le devoir du soldat" de Sarah Neiger (Le préau des collines)
 C'est
un texte d'urgence absolue. Ecrit comme on crache, comme on crie ou
comme on tente, éperdu, de reprendre souffle alors que l'on se noie. Un
texte comme un jet de pierres, un lancer d'arbalète, et qui percute
plein coeur. A travers des phrases mitraillées, catapultées,
c'est une femme qui, progressivement, reprend possession d'elle-même,
de sa vie longtemps confisquée. Ce sont les fragments arrachés
d'une enfance massacrée, d'une jeunesse vacillante, titubante,
funambulesque, en équilibre instable sur un fil transparent et
spéculaire, infiniment déchirable et qui, plusieurs fois, se rompt. (suite)
C'est
un texte d'urgence absolue. Ecrit comme on crache, comme on crie ou
comme on tente, éperdu, de reprendre souffle alors que l'on se noie. Un
texte comme un jet de pierres, un lancer d'arbalète, et qui percute
plein coeur. A travers des phrases mitraillées, catapultées,
c'est une femme qui, progressivement, reprend possession d'elle-même,
de sa vie longtemps confisquée. Ce sont les fragments arrachés
d'une enfance massacrée, d'une jeunesse vacillante, titubante,
funambulesque, en équilibre instable sur un fil transparent et
spéculaire, infiniment déchirable et qui, plusieurs fois, se rompt. (suite)
"Les irréductibles" de Zoé Oldenbourg (Gallimard)
C'est
un roman empreint
d'une étrange grâce, d'une mélancolie rageuse, d'un élan déceptif, d'un
emportement blessé, désabusé. Le récit, très ancré dans l'époque qu'il
restitue est traversé de thèmes sans âge et il rejoint l'intemporel.Au
début nous suivons pas à pas un home et sa difficile
réimmersion dans sa ville, Paris, dans sa vie volée en éclats et
désormais privée de contours précis. Nous sommes en 1947. L'homme
s'appelle Elie, il n'a pas tout à fait 30 ans et il vient d'en passer
sept en captivité. (suite)
"Place ouverte à Bordeaux" de Hanne Ørstavik (Notabilia)
C'est un texte de bruine, de sel et de soleil flouté. Une succession de fugues gracieuses et déroutantes qui ne perdent jamais de vue le motif central et qui, à la tendresse vaporeuse, ajoutent le tranchant de la cruauté. C'est une quête sinueuse et une saignée insolite. Une série de prélèvements féroces dans la substance nue, la chair de l'amour. L'argument paraît simple : la narratrice, artiste plasticienne, divorcée et mère d'une adolescente, s'engoue d'un critique d'art dont les mots (ceux d'un article) l'ont touchée au plus vif. (suite)
"La lune sur le mur" d’Anna Maria Ortese (Verdier)
 Chez Anne Maria Ortese, tout est
interstitiel. Les choses
sont entre les mots et les mots se déploient et se posent très en avant
des
choses. Et dans les intervalles brillent, palpitent et frémissent des
ondes
d’une délicatesse et d’une sensibilité inouïes. On ne saurait dire s’il
s’agit
d’émotions, de sensations, de sentiments ou d’une vibration dont le
caractère
impersonnel, indécidable ne saurait se réduire à une émanation
subjective et
prendrait, de ce fait, un tour presque objectif. Ce qui est sûr, c’est
qu’on se
trouve face à une forme d’amour et que cet amour est si pur qu’il
étreint et
bouleverse continûment. (suite)
Chez Anne Maria Ortese, tout est
interstitiel. Les choses
sont entre les mots et les mots se déploient et se posent très en avant
des
choses. Et dans les intervalles brillent, palpitent et frémissent des
ondes
d’une délicatesse et d’une sensibilité inouïes. On ne saurait dire s’il
s’agit
d’émotions, de sensations, de sentiments ou d’une vibration dont le
caractère
impersonnel, indécidable ne saurait se réduire à une émanation
subjective et
prendrait, de ce fait, un tour presque objectif. Ce qui est sûr, c’est
qu’on se
trouve face à une forme d’amour et que cet amour est si pur qu’il
étreint et
bouleverse continûment. (suite)
"Mistero doloroso" d'Anna Maria Ortese (Actes Sud)
 C'est
un texte comme une lame, aigu, tranchant mais qui est en même temps
d'une qualité céleste et s'élève, tout du long, vers un point
asymptotique. Un
texte qui, sous des dehors apparemment classiques et au fil d'une trame
éprouvée, s'échappe et déjoue, sans faillir, sans désemparer, les
attentes du lecteur. L'intrigue semble d'une simplicité
déconcertante, désarmante même : au XVIII° siècle, à Naples, Flori, une
adolescente de basse extraction (sa mère est couturière) s'éprend
violemment, lors d'une rencontre fortuite, d'un jeune aristocrate, le
prince Cirillo, très convoité mais frappé de langueur et de mélancolie
romantique et dont le coeur initialement balance (âprement disputé
qu'il
est) entre deux jeunes femmes de son rang. (suite)
C'est
un texte comme une lame, aigu, tranchant mais qui est en même temps
d'une qualité céleste et s'élève, tout du long, vers un point
asymptotique. Un
texte qui, sous des dehors apparemment classiques et au fil d'une trame
éprouvée, s'échappe et déjoue, sans faillir, sans désemparer, les
attentes du lecteur. L'intrigue semble d'une simplicité
déconcertante, désarmante même : au XVIII° siècle, à Naples, Flori, une
adolescente de basse extraction (sa mère est couturière) s'éprend
violemment, lors d'une rencontre fortuite, d'un jeune aristocrate, le
prince Cirillo, très convoité mais frappé de langueur et de mélancolie
romantique et dont le coeur initialement balance (âprement disputé
qu'il
est) entre deux jeunes femmes de son rang. (suite)
"La vie hors du temps" de Tezer Özlü (Bleu autour)
"Ce que je n’entends
pas" de
Yaël Pachet (Aden)
 De livre en livre,
Yaël Pachet
trace un territoire très singulier au sein duquel elle évolue en
funambule, en
spéléologue à la fois sauvage, tremblante et très sûre. Ce territoire,
elle
l’explore avec minutie mais aussi avec désinvolture et avec une grande
liberté. Elle est minutieuse
dans ses
plongées, ses excavations qui s’attachent à cerner tous les éléments
qu’elle se
propose d’approcher et elle est désinvolte dans son mode
opératoire : elle
bondit d’un sujet à l’autre, d’un objet à l’autre au gré d’embardées
fantasques, au gré, surtout, d’une logique organique et des pulsations
intimes
qui régissent sa vie et son écriture. (suite)
De livre en livre,
Yaël Pachet
trace un territoire très singulier au sein duquel elle évolue en
funambule, en
spéléologue à la fois sauvage, tremblante et très sûre. Ce territoire,
elle
l’explore avec minutie mais aussi avec désinvolture et avec une grande
liberté. Elle est minutieuse
dans ses
plongées, ses excavations qui s’attachent à cerner tous les éléments
qu’elle se
propose d’approcher et elle est désinvolte dans son mode
opératoire : elle
bondit d’un sujet à l’autre, d’un objet à l’autre au gré d’embardées
fantasques, au gré, surtout, d’une logique organique et des pulsations
intimes
qui régissent sa vie et son écriture. (suite)
"L'autre vie de Valérie Straub" de Stéphane Padovani (Quidam éditeur)
 C'est
un bref texte en forme de coup de poing. Une percussion, une pluie
acide de mots criblés et perçants. C'est une vie dressée justicière
puis cardée, agrafée dans l'étroitesse des normes et nécessités. Une
vie rompue, fracturée en son centre mais jamais pliée ou rendue. Une
vie qui ne s'incline pas. Sinon devant la douceur. C'est une voix
sortie des fers, balafrée de tous côtés et au travers de tous les
ronciers, qui exhale une rage sourde et une profonde fatigue. Une voix
rassasiée de coups, calcinée de temps mort. (suite)
C'est
un bref texte en forme de coup de poing. Une percussion, une pluie
acide de mots criblés et perçants. C'est une vie dressée justicière
puis cardée, agrafée dans l'étroitesse des normes et nécessités. Une
vie rompue, fracturée en son centre mais jamais pliée ou rendue. Une
vie qui ne s'incline pas. Sinon devant la douceur. C'est une voix
sortie des fers, balafrée de tous côtés et au travers de tous les
ronciers, qui exhale une rage sourde et une profonde fatigue. Une voix
rassasiée de coups, calcinée de temps mort. (suite)
"Un baiser sous X" d'Eric Paradisi (Fayard)
 Eric
Paradisi doit aimer les défis, les marges, les états-limites du corps.
Il en fait la convaincante et troublante démonstration dans son dernier
roman "Un baiser sous X". Pour autant, s'il prise les extrêmes, il
opère en douceur. Il explore mais par touches légères, sans
appuyer, sans insister et sans prétendre à l'exhaustivité. Il
s'immisce en catimini, mais avec une belle droiture, une belle
intégrité, dans un corps interdit, un corps impensable. Impensable et
incompensable. Corps fantasme de plénitude que la société stigmatise,
dont elle fait une déficience, une solitude qui ne peut s'apparier. (suite)
Eric
Paradisi doit aimer les défis, les marges, les états-limites du corps.
Il en fait la convaincante et troublante démonstration dans son dernier
roman "Un baiser sous X". Pour autant, s'il prise les extrêmes, il
opère en douceur. Il explore mais par touches légères, sans
appuyer, sans insister et sans prétendre à l'exhaustivité. Il
s'immisce en catimini, mais avec une belle droiture, une belle
intégrité, dans un corps interdit, un corps impensable. Impensable et
incompensable. Corps fantasme de plénitude que la société stigmatise,
dont elle fait une déficience, une solitude qui ne peut s'apparier. (suite)
"Suicide girls" d'Aymeric Patricot (Léo Scheer)
 C'est
l'histoire de deux vies qui, lentement, irrépressiblement, convergent
l'une vers l'autre à la manière de deux astres radioactifs, deux
étoiles noires. Un jeune professeur débutant et une femme, très
jeune. Lui est titulaire d'une vie apparemment des plus lisses
(campagne charmante, aussi ravissante qu'impeccable, métier qui
requiert vigilance et la plus totale maîtrise de soi) mais dynamitée de
l'intérieur et qui peu à peu se lézarde et se délite. Elle vient d'une
vie éventrée depuis la prime adolescence. Tous deux, pour des
raisons distinctes, tendent vers la mort. (suite)
C'est
l'histoire de deux vies qui, lentement, irrépressiblement, convergent
l'une vers l'autre à la manière de deux astres radioactifs, deux
étoiles noires. Un jeune professeur débutant et une femme, très
jeune. Lui est titulaire d'une vie apparemment des plus lisses
(campagne charmante, aussi ravissante qu'impeccable, métier qui
requiert vigilance et la plus totale maîtrise de soi) mais dynamitée de
l'intérieur et qui peu à peu se lézarde et se délite. Elle vient d'une
vie éventrée depuis la prime adolescence. Tous deux, pour des
raisons distinctes, tendent vers la mort. (suite)
"Polaire" de Marc Pautrel (Gallimard)
 C’est une histoire
simple et
déchirante, de celles dont on ne se remet pas. Marc Pautrel aborde
son amour
comme un enfant les galeries fabuleuses de son imagination : avec
un
émerveillement incrédule. Il est devant son amour comme un
enfant : les
mains nues et le cœur pas davantage vêtu. L’objet de cet amour
est une
jeune femme de trente ans et elle surgit dans le texte, qu’elle
exhausse et
illumine, comme un elfe irrésistible, une fée radieuse, rayonnante et
crépitante de vie. (suite)
C’est une histoire
simple et
déchirante, de celles dont on ne se remet pas. Marc Pautrel aborde
son amour
comme un enfant les galeries fabuleuses de son imagination : avec
un
émerveillement incrédule. Il est devant son amour comme un
enfant : les
mains nues et le cœur pas davantage vêtu. L’objet de cet amour
est une
jeune femme de trente ans et elle surgit dans le texte, qu’elle
exhausse et
illumine, comme un elfe irrésistible, une fée radieuse, rayonnante et
crépitante de vie. (suite)
"Sans un regard" de José Luis Pexeito (Grasset)
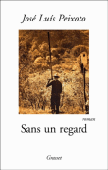 C'est
un premier roman stupéfiant de beauté exténuée. Un souffle d'une
ampleur et d'une puissance mythologiques surgi comme de dessous la
terre. Chaque mot est d'une densité, d'une force de percussion et
d'une justesse telles qu'il s'égale au plus solennel, au plus sacré des
silences. Les
voix qui montent viennent des entrailles et de plus
loin encore, voix millénaires chargées de la légende des siècles et de
la douleur des peuples opprimés, douleur des offensés et des humiliés. (suite)
C'est
un premier roman stupéfiant de beauté exténuée. Un souffle d'une
ampleur et d'une puissance mythologiques surgi comme de dessous la
terre. Chaque mot est d'une densité, d'une force de percussion et
d'une justesse telles qu'il s'égale au plus solennel, au plus sacré des
silences. Les
voix qui montent viennent des entrailles et de plus
loin encore, voix millénaires chargées de la légende des siècles et de
la douleur des peuples opprimés, douleur des offensés et des humiliés. (suite)
"Le cimetière des pianos" de Jose Luis Peixoto (Folio Gallimard)
 Jose
Luis Peixoto est un acrobate hors pair et aussi un écrivain d'une
infinie sensibilité. Que les deux se trouvent rassemblés en un même
être, la virtuosité et l'aptitude à restituer des émotions vibrantes,
est une chose si rare qu'elle mérite d'être mentionnée. Si Jose Luis
Peixoto brouille les pistes, s'il joue avec la chronologie et va
jusqu'à confondre les identités, ce n'est pas seulement pour éprouver
ses dons de créateur surdoué mais pour mieux faire jaillir l'émotion
brute. (suite)
Jose
Luis Peixoto est un acrobate hors pair et aussi un écrivain d'une
infinie sensibilité. Que les deux se trouvent rassemblés en un même
être, la virtuosité et l'aptitude à restituer des émotions vibrantes,
est une chose si rare qu'elle mérite d'être mentionnée. Si Jose Luis
Peixoto brouille les pistes, s'il joue avec la chronologie et va
jusqu'à confondre les identités, ce n'est pas seulement pour éprouver
ses dons de créateur surdoué mais pour mieux faire jaillir l'émotion
brute. (suite)
"C’est curieux" d’Isabelle Pinçon (Cheyne éditeur)
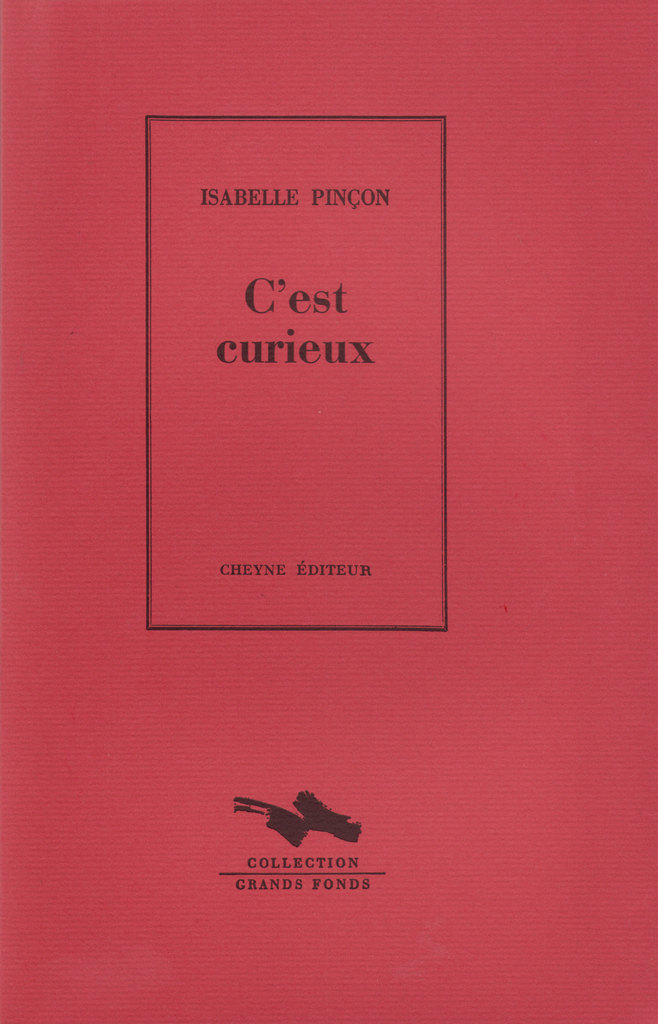 Isabelle Pinçon n’y
va pas par
quatre chemins et, en même temps, elle brouille toutes les pistes.
L’objet de sa
curiosité, de ses
investigations, de son affection est clairement désigné et ciblé :
c’est
l’homme familier qui est, dans le même temps, parfaitement étranger. Et
l’angle d’approche
privilégie
exclusivement ce dernier aspect : l’insolite, l’incongru,
l’altérité qui
saisit, interloque, presque suffoque et souvent prête à rire. C’est que
le regard
d’Isabelle
Pinçon décape la vision de toute afféterie, de toute paresse, de toute
convention. C’est un regard radiant qui perce toutes les poches et
toutes les
coques de confort et d’aisance autoroutière. Un regard qui fait éclater
les
bulles perceptives protectrices. L’homme paraît mais tel qu’on ne l’a
jamais
vu. (suite)
Isabelle Pinçon n’y
va pas par
quatre chemins et, en même temps, elle brouille toutes les pistes.
L’objet de sa
curiosité, de ses
investigations, de son affection est clairement désigné et ciblé :
c’est
l’homme familier qui est, dans le même temps, parfaitement étranger. Et
l’angle d’approche
privilégie
exclusivement ce dernier aspect : l’insolite, l’incongru,
l’altérité qui
saisit, interloque, presque suffoque et souvent prête à rire. C’est que
le regard
d’Isabelle
Pinçon décape la vision de toute afféterie, de toute paresse, de toute
convention. C’est un regard radiant qui perce toutes les poches et
toutes les
coques de confort et d’aisance autoroutière. Un regard qui fait éclater
les
bulles perceptives protectrices. L’homme paraît mais tel qu’on ne l’a
jamais
vu. (suite)
"L’enfer musical"
d’Alejandra
Pizarnik (ypsilon.éditeur)
 Alejandra Pizarnik
est une
flibustière hors-catégorie et c’est aussi une voix qui, dégagée des
décombres,
perce et désigne l’insondable. On va de l’obscur à l’obscur, c’est une
conscience ténébreuse, obstruée, qui va fouiller une matière menaçante,
et
cependant, tout du long, ce sont des esquilles de lumière, des éclats
éblouis
qui surgissent. Ce à quoi l’on assiste, ce n’est pas à une joute ou un
combat,
mais à un véritable corps à corps, féroce, implacable, avec la langue.
Car,
pour Aleandra Pizarnik, c’est tout l’objet de son écriture en même
temps que
c’est tout l’enjeu de sa vie que de s’identifier à travers une langue
qui lui
est propre. Car, écrit-elle, "un vide gris est mon nom, mon
prénom. » Il est question,
beaucoup,
d’enfance, de nuit, de mutité, d’absence, de solitude, de mort. (suite)
Alejandra Pizarnik
est une
flibustière hors-catégorie et c’est aussi une voix qui, dégagée des
décombres,
perce et désigne l’insondable. On va de l’obscur à l’obscur, c’est une
conscience ténébreuse, obstruée, qui va fouiller une matière menaçante,
et
cependant, tout du long, ce sont des esquilles de lumière, des éclats
éblouis
qui surgissent. Ce à quoi l’on assiste, ce n’est pas à une joute ou un
combat,
mais à un véritable corps à corps, féroce, implacable, avec la langue.
Car,
pour Aleandra Pizarnik, c’est tout l’objet de son écriture en même
temps que
c’est tout l’enjeu de sa vie que de s’identifier à travers une langue
qui lui
est propre. Car, écrit-elle, "un vide gris est mon nom, mon
prénom. » Il est question,
beaucoup,
d’enfance, de nuit, de mutité, d’absence, de solitude, de mort. (suite)
"Le prisonnier" d'Anne Plantagenet (Stock)
 Anne
Plantagenent écrit à l'économie et sur le fil d'une fièvre continue.
Elle resserre l'espace, raréfie l'air à mesure qu'elle dilate l'âme,
ouvre les portes de l'esprit. Elle maintient tout du long une cadence
haletée qui oblige à lire, à regarder à neuf . La tension qui jamais ne
décroît nettoie et annule les scories. On est happé par une force
centripète qui pulvérise le superflu. (suite)
Anne
Plantagenent écrit à l'économie et sur le fil d'une fièvre continue.
Elle resserre l'espace, raréfie l'air à mesure qu'elle dilate l'âme,
ouvre les portes de l'esprit. Elle maintient tout du long une cadence
haletée qui oblige à lire, à regarder à neuf . La tension qui jamais ne
décroît nettoie et annule les scories. On est happé par une force
centripète qui pulvérise le superflu. (suite)
"Disproportion de l'homme" de Laurence Plazenet (Gallimard)
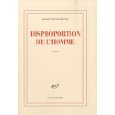 Pour
ceux qui sont familiers de l'oeuvre de Laurence Plazenet,
"Disproportion de l'homme" peut faire office de clef de voûte,
d'éclairage cru jeté sur un dense mystère longtemps infissurable. Pour
les autres, les bienheureux qui découvrent, c'est encore
et tout de suite, le rapt, l'aspiration vers le haut. C'est le portrait
d'un homme, Simon qui, au seuil de la
quarantaine, traverse une crise sans précédent. Il
possède tous les attributs de l'homme moderne rassasié de biens, comblé
de tous les signes extérieurs de réussite. (suite)
Pour
ceux qui sont familiers de l'oeuvre de Laurence Plazenet,
"Disproportion de l'homme" peut faire office de clef de voûte,
d'éclairage cru jeté sur un dense mystère longtemps infissurable. Pour
les autres, les bienheureux qui découvrent, c'est encore
et tout de suite, le rapt, l'aspiration vers le haut. C'est le portrait
d'un homme, Simon qui, au seuil de la
quarantaine, traverse une crise sans précédent. Il
possède tous les attributs de l'homme moderne rassasié de biens, comblé
de tous les signes extérieurs de réussite. (suite)
"L'amour seul" de Laurence Plazenet (Albin Michel)
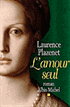 C'est
un livre de fièvre sèche et d'air raréfié. De sarments qui brûlent si
haut que l'âme en est presque asphyxiée. Noblesse
native, noblesse de coeur, rudesse des exigences, vies taillées,
élaguées au plus dru, vies rougies, bronzées sous le fouet des
contraintes, sous l'aiguillon des pénitences, il n'y a là pas de place
pour aucun accommodement avec la tiédeur. (suite)
C'est
un livre de fièvre sèche et d'air raréfié. De sarments qui brûlent si
haut que l'âme en est presque asphyxiée. Noblesse
native, noblesse de coeur, rudesse des exigences, vies taillées,
élaguées au plus dru, vies rougies, bronzées sous le fouet des
contraintes, sous l'aiguillon des pénitences, il n'y a là pas de place
pour aucun accommodement avec la tiédeur. (suite)
"Les ballons d'hélium" de Grégoire Polet (Gallimard)
 C'est
un texte en forme de chute indéfiniment reprise et rééditée, une coulée
à vif et à pic qui ne cesse que pour opérer, ailleurs et autrement,
cette cavalcade renversée, cette malédiction de Sisyphe projetée dans
les profondeurs. C'est une plongée dans les entrailles d'une vie
hantée, une vie arrachée à elle-même mais où l'altération
majeure et la déportation véritable ne sont pas celles qu'on croit. (suite)
C'est
un texte en forme de chute indéfiniment reprise et rééditée, une coulée
à vif et à pic qui ne cesse que pour opérer, ailleurs et autrement,
cette cavalcade renversée, cette malédiction de Sisyphe projetée dans
les profondeurs. C'est une plongée dans les entrailles d'une vie
hantée, une vie arrachée à elle-même mais où l'altération
majeure et la déportation véritable ne sont pas celles qu'on croit. (suite)
"Les saisons" de Maurice Pons (Christian Bourgois)
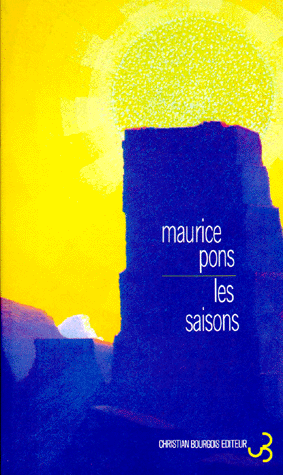 Comment
aborder un livre estampillé "culte" avec un regard virginal ? Difficle
... On craint que la réputation de chef-d'oeuvre ne soit surfaite et on
redoute pareillement de n'avoir pas la sensibilité, la perméabilité
requises pour apprécier ce joyau ... Autrement dit, le livre sera-t-il
à la hauteur et réciproquement, sera-t-on, soi-même à la hauteur ?
Quand,
au mépris de toutes ces appréhensions, on se lance, voilà ce qu'on
trouve : soit un homme, Siméon, disgracié, remarquable tant par sa
visible pauvreté que par sa repoussante laideur physique, qui arrive un
beau jour dans un bourg. Et quel bourg ! (suite)
Comment
aborder un livre estampillé "culte" avec un regard virginal ? Difficle
... On craint que la réputation de chef-d'oeuvre ne soit surfaite et on
redoute pareillement de n'avoir pas la sensibilité, la perméabilité
requises pour apprécier ce joyau ... Autrement dit, le livre sera-t-il
à la hauteur et réciproquement, sera-t-on, soi-même à la hauteur ?
Quand,
au mépris de toutes ces appréhensions, on se lance, voilà ce qu'on
trouve : soit un homme, Siméon, disgracié, remarquable tant par sa
visible pauvreté que par sa repoussante laideur physique, qui arrive un
beau jour dans un bourg. Et quel bourg ! (suite)
"Les exigences" d’Olivia Profizi (Actes Sud)
Voici un texte
fragile,
vacillant, incertain, un texte courageux qui n’hésite pas à se frotter
à ce
qui, précisément, pourrait le distordre et le disqualifier. Un texte
qui va même
jusqu’à
établir ses fondements et déployer son mode opératoire au sein même du
travail
de sape. Le périlleux pari est
le
suivant : le texte est bâti autour d’une destruction, une
destruction
avérée qui tente, simultanément, de remonter son cours, d’identifier
les
conditions qui présidèrent à sa mise en œuvre et de se conjurer
elle-même. Le dispositif
dramaturgique est
le suivant : la voix majeure est celle de Rachel, une jeune femme
confinée
dans une unité psychiatrique. Au fil du texte, elle déroule deux lignes
qui se
développent en parallèle ou convergent et se superposent. (suite)
"Regarder le soleil" de Anne Provoost (Fayard)
 C'est
une histoire d'étrangeté, une histoire voilée, un texte qui joue du
clair-obscur jusque dans ses phrases filtrées et tamisées.Une dureté
inouïe élimée, vaincue par le génie d'une petite fille. On
se trouve dans un ranch isolé en Australie. Il y a Chloé,
la narratrice, encore enfant, il y a sa mère, Linda, il y a
son père
très tôt
soufflé, expulsé du récit, mort à la suite d'un accident équestre,
alcoolisé et troublement familial. Il y a encore Ilana, demi-soeur
adolescente de Chloé, née d'une première noce de Linda. Et puis il y a
Rockie et Lorna, couple d'amis proches, débordants d'une sollicitude
embarrassée. (suite)
C'est
une histoire d'étrangeté, une histoire voilée, un texte qui joue du
clair-obscur jusque dans ses phrases filtrées et tamisées.Une dureté
inouïe élimée, vaincue par le génie d'une petite fille. On
se trouve dans un ranch isolé en Australie. Il y a Chloé,
la narratrice, encore enfant, il y a sa mère, Linda, il y a
son père
très tôt
soufflé, expulsé du récit, mort à la suite d'un accident équestre,
alcoolisé et troublement familial. Il y a encore Ilana, demi-soeur
adolescente de Chloé, née d'une première noce de Linda. Et puis il y a
Rockie et Lorna, couple d'amis proches, débordants d'une sollicitude
embarrassée. (suite)
"Un hiver à Rome" d'Elisabetta Rasy (Seuil)
C'est un roman de l'infime, du souffle contenu, des situations vaporeuses, soulevées presque à partir de rien. C'est la trajectoire, zigzaguée, toute de flux contradictoires, d'une femme qui semble à peine posée dans la vie. C'est un texte au charme trouble dont le mystère tient autant aux ellipses, aux coupes sombres pratiquées dans la matière vive, qu'au sens explicite, livré, très délicatement exprimé. (suite)
"La Dame de pierres" de Virginie Reisz (Le temps qu'il fait)
 C'est
un texte de haute tension, de grands fonds et de ligne claire. Un texte
qui orchestre la rencontre entre la plus rugueuse réalité, le concret
le plus pragmatique et la poésie la plus aiguë. C'est
une quête incantatoire. Des voix s'élèvent, habitées, âpres, éperdues.
Deux hommes sont réunis, soudés au plus profond par une ivresse, un
désir fou qui n'est pas d'une femme mais d'une bâtisse. Une distillerie
sise aux confins du monde, dans une île des Hébrides et dont le
sauvetage mobilise toutes leurs forces. (suite)
C'est
un texte de haute tension, de grands fonds et de ligne claire. Un texte
qui orchestre la rencontre entre la plus rugueuse réalité, le concret
le plus pragmatique et la poésie la plus aiguë. C'est
une quête incantatoire. Des voix s'élèvent, habitées, âpres, éperdues.
Deux hommes sont réunis, soudés au plus profond par une ivresse, un
désir fou qui n'est pas d'une femme mais d'une bâtisse. Une distillerie
sise aux confins du monde, dans une île des Hébrides et dont le
sauvetage mobilise toutes leurs forces. (suite)
"Le professeur de rhétorique" de
Marie-Hélène Renoux (Cheyne éditeur)
 Une femme rencontre
un homme. Cet
homme est un philosophe italien du début du XVIII° siècle, il se nomme
Gianbattista Vico et cette rencontre est à ce point décisive que la
femme (qui
est aussi la narratrice) décide de lui consacrer un texte qui n’est pas
d’hommage. Elle explique, dans
un
avant-propos, la nature singulière de son entreprise : il s’agit,
pour
elle, de s’adresser au philosophe reconfiguré en jeune homme et qu’elle
suit
pas à pas et évoque au gré de secrètes vibrations intimes. Le texte
comporte
aussi un second volet tout autre : l’auteur y dialogue avec un
spécialiste
de l’œuvre de Vico à l’appréciation duquel elle soumet le premier volet
et elle
mêle à cette exploration duelle ou conjuguée de Vico une esquisse de
récit la
mettant en scène elle en compagnie de son aimé. (suite)
Une femme rencontre
un homme. Cet
homme est un philosophe italien du début du XVIII° siècle, il se nomme
Gianbattista Vico et cette rencontre est à ce point décisive que la
femme (qui
est aussi la narratrice) décide de lui consacrer un texte qui n’est pas
d’hommage. Elle explique, dans
un
avant-propos, la nature singulière de son entreprise : il s’agit,
pour
elle, de s’adresser au philosophe reconfiguré en jeune homme et qu’elle
suit
pas à pas et évoque au gré de secrètes vibrations intimes. Le texte
comporte
aussi un second volet tout autre : l’auteur y dialogue avec un
spécialiste
de l’œuvre de Vico à l’appréciation duquel elle soumet le premier volet
et elle
mêle à cette exploration duelle ou conjuguée de Vico une esquisse de
récit la
mettant en scène elle en compagnie de son aimé. (suite)
"Efina" de Noëlle Revaz (Gallimard)
 Noëlle
Revaz est une joueuse. Elle a l'esprit; le verbe, l'approche, l'accent
et la cadence ludiques. Elle joue des mots et des codes et
ses
phrases ont l'oeil qui frise et les pointes qui pétillent.On a,
au départ, les éléments suivants : une jeune femme, Efina, qui se rend
au théâtre et T., un comédien d'âge mûr, brillant semble-t-il. Efina
voit
T. se produire et s'entiche de lui. Il y a un échange de lettres. T.
répond aux emballements et embardées d'Efina avec complaisance et
condescendance. (suite)
Noëlle
Revaz est une joueuse. Elle a l'esprit; le verbe, l'approche, l'accent
et la cadence ludiques. Elle joue des mots et des codes et
ses
phrases ont l'oeil qui frise et les pointes qui pétillent.On a,
au départ, les éléments suivants : une jeune femme, Efina, qui se rend
au théâtre et T., un comédien d'âge mûr, brillant semble-t-il. Efina
voit
T. se produire et s'entiche de lui. Il y a un échange de lettres. T.
répond aux emballements et embardées d'Efina avec complaisance et
condescendance. (suite)
"Rose Envy" de Dominique de Rivaz (Zoé)
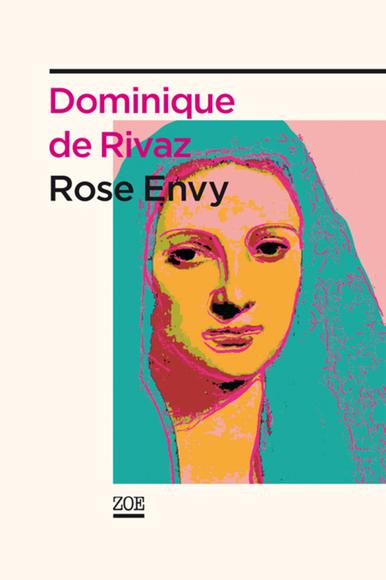 Voici un texte comme
un ballon
d’hélium, un texte qui tout vaporise, tiré et aspiré vers le haut et
qui,
cependant, est cousu et couturé au plus près du corps. C’est un texte
plein de
grâce, tout piqueté d’éclats tranchants et prodigue en fantasques
faveurs et
pourtant il ne cède rien à la facilité et pas davantage aux charmes
éprouvés. C’est un parcours
initiatique des
plus singuliers, un roman de formation des plus insolites. Tout se
resserre, se
polarise autour d’un motif incongru qui intrigue, interloque et
entraîne dans
une prenante, une hypnotique fascination. (suite)
Voici un texte comme
un ballon
d’hélium, un texte qui tout vaporise, tiré et aspiré vers le haut et
qui,
cependant, est cousu et couturé au plus près du corps. C’est un texte
plein de
grâce, tout piqueté d’éclats tranchants et prodigue en fantasques
faveurs et
pourtant il ne cède rien à la facilité et pas davantage aux charmes
éprouvés. C’est un parcours
initiatique des
plus singuliers, un roman de formation des plus insolites. Tout se
resserre, se
polarise autour d’un motif incongru qui intrigue, interloque et
entraîne dans
une prenante, une hypnotique fascination. (suite)
"Fond de carte" de Marie Rivière (Melville - Léo Scheer)
 Marie
Rivière a écrit un récit de désenchantement des plus originaux. Elle
orchestre une errance presque statique doublée d'une très mobile
cavalcade mentale, de ruades et d'embardées internes suraiguës. Rafaël,
l'ulysséen narrateur est un étudiant bordelais
en rupture. Avec ses études. Avec Bordeaux. Avec sa vie tout entière.
Il sort de trois semaines de prostration passées en tête à tête avec
son
canapé et il entend bien fuir à jamais la ville dans laquelle il
s'éprouve englué. (suite)
Marie
Rivière a écrit un récit de désenchantement des plus originaux. Elle
orchestre une errance presque statique doublée d'une très mobile
cavalcade mentale, de ruades et d'embardées internes suraiguës. Rafaël,
l'ulysséen narrateur est un étudiant bordelais
en rupture. Avec ses études. Avec Bordeaux. Avec sa vie tout entière.
Il sort de trois semaines de prostration passées en tête à tête avec
son
canapé et il entend bien fuir à jamais la ville dans laquelle il
s'éprouve englué. (suite)
"La mort et le printemps" de Mercè Rodoreda (L'imaginaire Gallimard)
C'est une voix, d'abord, qui prend corps en vous. Une voix étrange, surplombante, comme blanchie, absente à elle-même et pourtant prenante, obsédante.C'est un adolescent qui nous parle depuis l'ailleurs où il vit et qui nous initie aux éclats insolites du monde qu'il habite. Racontant, il recense, il se fait témoin et mémorialiste des pratiques singulières, des rituels énigmatiques qui rythment sa vie et celle de la communauté à laquelle il appartient. (suite)
"Joséphine" de Jean Rolin (Gallimard)
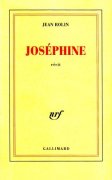 C'est
un livre de failles. Un livre de cris et chuchotements. Un cri qui
fulgure sans les allures trompeuses du chuchotement. C'est un texte de
l'éperdu, un tombeau qui prélève le plus vif et le plus vrai de la
femme
aimée et perdue. Le profil perdu peu à peu émerge, sort de
l'indistinction. Une jeune femme d'abord interchangeable qui
s'identifie, se singularise au fil des traits précis, saillants, dont
la
doue l'écrivain. Mais cette identification s'accomplit comme du
bout des doigts, du bout des mots. (suite)
C'est
un livre de failles. Un livre de cris et chuchotements. Un cri qui
fulgure sans les allures trompeuses du chuchotement. C'est un texte de
l'éperdu, un tombeau qui prélève le plus vif et le plus vrai de la
femme
aimée et perdue. Le profil perdu peu à peu émerge, sort de
l'indistinction. Une jeune femme d'abord interchangeable qui
s'identifie, se singularise au fil des traits précis, saillants, dont
la
doue l'écrivain. Mais cette identification s'accomplit comme du
bout des doigts, du bout des mots. (suite)
"Ninive" de Henrietta Rose-Innes (Zoé)
"Ninive" est un texte de résistance et un texte qui prend la tangente. C'est une odyssée improbable, une croisade menée par les chemins de traverse les plus singuliers, les plus inusités. C'est une drôle de guerre qui se double d'un insoluble conflit d'amour. C'est un carnage familial qui file sa propre métaphore de vertigineuse façon. Comme si les blessures les plus secrètes, les plus profondes, étaient brutalement exhibées, non sur la peau, non sur les membres eux-mêmes, mais sur une prothèse non moins lisible. (suite)
"Le revolver de Lacan" de Jean-François Rouzières (Seuil)
 Le
titre intrigue et escroque. On s'attend à une énième
facétie du maître, à un de ces tours pendables dont il avait le secret
(et la secrète jouissance) et qui l'égalaient à un irrécusable et
indécrottable polisson. L'escroquerie,
cependant, n'est pas totale. Car il sera question de violence autant
que de psychanalyse. Et il ne s'agit pas non plus seulement d'une
métonymie. Car le revolver de Lacan surgira bel et bien au cours du
récit et il s'illustrera de la plus éclatante façon. (suite)
Le
titre intrigue et escroque. On s'attend à une énième
facétie du maître, à un de ces tours pendables dont il avait le secret
(et la secrète jouissance) et qui l'égalaient à un irrécusable et
indécrottable polisson. L'escroquerie,
cependant, n'est pas totale. Car il sera question de violence autant
que de psychanalyse. Et il ne s'agit pas non plus seulement d'une
métonymie. Car le revolver de Lacan surgira bel et bien au cours du
récit et il s'illustrera de la plus éclatante façon. (suite)
"Halte à Yalta" d'Emmanuel Ruben (JBz & Cie)
C'est un périple qui va comme un cheval dételé et semble, par moments, celui d'un train qui doucement déraille. C'est l'histoire d'une rencontre insolite et d'un lien non moins singulier et purement circonstanciel qui se tisse entre deux hommes, deux pérégrins. C'est, depuis la Crimée, à bord d'un train soviétique cahotant et poussif, une traversée de l'espace russe, une plongée abrupte dans une durée bringuebalée, chahutée par deux âmes qui se cognent. (suite)
"Retour, retour" de Catherine
Safonoff (Zoé)
C’est un livre
détaché de tout,
un livre suspendu, en apesanteur et qui ne se rapporte à rien. Rien de
repérable, d’identifiable dans ce récit inclassable qui nous emmène au
fil d’un
voyage presque immobile. On est projeté dans la conscience chaotique de
la
narratrice dont on a le sentiment qu’elle-même ne sait pas vraiment où
elle est
ni, surtout, où elle en est. Si l’on croit trouver
dans le
retour du titre éponyme un repère, un indice, on est vite
détrompé : en
fait de retour, c’est plutôt à un éternel faux départ qu’on a le
sentiment
d’assister. Ou à un impossible retour. (suite)
"Autour de ma mère" de Catherine Safonoff (Zoé)
 Catherine
Safonoff
écrit et rend
trait pour trait, mot uppercuté pour choc et percussion, mot et ombre
portée
pour impact et coup. Elle ne ménage ni n’aménage, elle écrit,
implacable, comme
on crie ou comme on cogne. Comme on frappe à coups redoublés. Et
pourtant, dans
son monde écrit, rien n’est symétrique et les mots disent, quand ils ne
les
compensent pas, toutes les parts manquantes. Dans cet opus,
Catherine Safonoff
procède comme à l’ordinaire : de façon apparemment buissonnière et
vagabonde mais en fait, secrètement et fortement architecturée, selon
un ordre
et une logique organiques qui répondent à une nécessité interne. (suite)
Catherine
Safonoff
écrit et rend
trait pour trait, mot uppercuté pour choc et percussion, mot et ombre
portée
pour impact et coup. Elle ne ménage ni n’aménage, elle écrit,
implacable, comme
on crie ou comme on cogne. Comme on frappe à coups redoublés. Et
pourtant, dans
son monde écrit, rien n’est symétrique et les mots disent, quand ils ne
les
compensent pas, toutes les parts manquantes. Dans cet opus,
Catherine Safonoff
procède comme à l’ordinaire : de façon apparemment buissonnière et
vagabonde mais en fait, secrètement et fortement architecturée, selon
un ordre
et une logique organiques qui répondent à une nécessité interne. (suite)
"La part d’Esmé" de
Catherine Safonoff (L’Age d’homme)
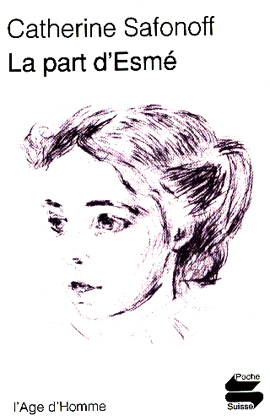 Esmé est une drôle de
zigue qui
appréhende la vie en zigzags et surtout jamais de façon rectiligne.
C’est une
jeune femme oblique qui jette sur les êtres et les choses un regard
jamais
attendu. Esmé semble baguenauder et marauder sa vie avec légèreté,
espièglerie
mais tout de suite on perçoit une sourde inquiétude, une gravité qui
imprègne
le texte et dément cette impression première. Esmé virevolte et
vibrionne mais
ses cabrioles sont étrangement veinées de gris et de mélancolie comme
si elle
aimantait la limaille cachée de l’existence, toutes les peines secrètes
et les
sanglots contenus. En vérité Esmé crapahute, vivote et peine entre les
éboulements, sur des sentes ordinaires, dont le caractère ordinaire,
précisément,, la mortifie car ce n’est pas ce chemin-là qui miroitait
dans ses
rêves enluminés et elle s’accommode mal du principe de réalité. (suite)
Esmé est une drôle de
zigue qui
appréhende la vie en zigzags et surtout jamais de façon rectiligne.
C’est une
jeune femme oblique qui jette sur les êtres et les choses un regard
jamais
attendu. Esmé semble baguenauder et marauder sa vie avec légèreté,
espièglerie
mais tout de suite on perçoit une sourde inquiétude, une gravité qui
imprègne
le texte et dément cette impression première. Esmé virevolte et
vibrionne mais
ses cabrioles sont étrangement veinées de gris et de mélancolie comme
si elle
aimantait la limaille cachée de l’existence, toutes les peines secrètes
et les
sanglots contenus. En vérité Esmé crapahute, vivote et peine entre les
éboulements, sur des sentes ordinaires, dont le caractère ordinaire,
précisément,, la mortifie car ce n’est pas ce chemin-là qui miroitait
dans ses
rêves enluminés et elle s’accommode mal du principe de réalité. (suite)
"Le mineur et le canari" de
Catherine Safonoff (Zoé)
 On entre dans le livre de
Catherine Safonoff presque comme chez soi : c’est ouvert,
accueillant,
chaleureux, coloré, débordant de vie et de fantaisie
et il s’y déploie une parole qui est une
parole amie. Mais rien n’est
simple et uni
pour autant. Catherine Safonoff est une irrégulière qui écrit
irrégulièrement.
Sa prose vagabonde et fantasque nous entraîne le long des chemins de
traverse,
des chemins creux et aussi dans les fondrières. Et si rien ne va de
soi, si le
cours de l’écriture est heurté, imprévisible, c’est qu’il épouse au
plus près
celui, si diablement inventif, de la vie. (suite)
On entre dans le livre de
Catherine Safonoff presque comme chez soi : c’est ouvert,
accueillant,
chaleureux, coloré, débordant de vie et de fantaisie
et il s’y déploie une parole qui est une
parole amie. Mais rien n’est
simple et uni
pour autant. Catherine Safonoff est une irrégulière qui écrit
irrégulièrement.
Sa prose vagabonde et fantasque nous entraîne le long des chemins de
traverse,
des chemins creux et aussi dans les fondrières. Et si rien ne va de
soi, si le
cours de l’écriture est heurté, imprévisible, c’est qu’il épouse au
plus près
celui, si diablement inventif, de la vie. (suite)
"Franny et Zooey" de J.D. Salinger
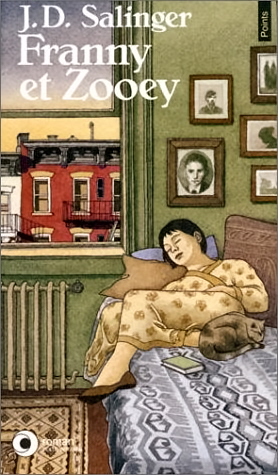 Ce sont des esprits
feux-follets. Trop rapides, alertes et agiles pour les frêles corps qui
les abritent. Ce sont des corps au sortir de l'adolescence affligés
d'une intellignece si aiguë qu'elle en devient invalidante. Ils
perçoivent le monde à travers des prismes si complexes qu'ils leur
donnent le tournis. Ce sont Franny et Zooey, ils sont frères et soeur,
cadets d'une famille de sept enfants, tous dotés d'une intelligence
surdimensionnée, (suite)
Ce sont des esprits
feux-follets. Trop rapides, alertes et agiles pour les frêles corps qui
les abritent. Ce sont des corps au sortir de l'adolescence affligés
d'une intellignece si aiguë qu'elle en devient invalidante. Ils
perçoivent le monde à travers des prismes si complexes qu'ils leur
donnent le tournis. Ce sont Franny et Zooey, ils sont frères et soeur,
cadets d'une famille de sept enfants, tous dotés d'une intelligence
surdimensionnée, (suite)
"Un bonheur parfait" de James Salter
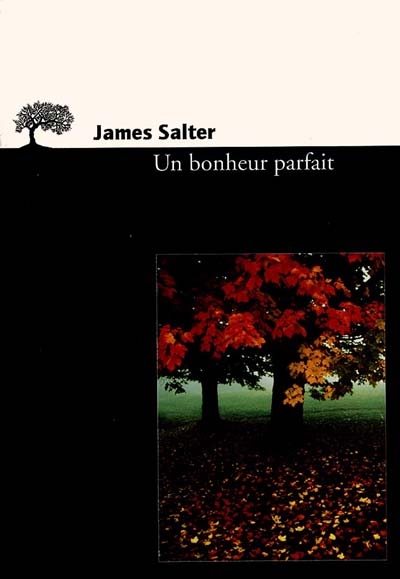 C'est
un texte tout de langueurs et de volutes pâles et rosées. Un texte
comme tout en écharpes, en bandeaux veloutés de soleil couchant. Tout
en
douceurs pastel et en mélancolie contenue. Un texte trompeur. Traître
et fourbe comme un marécage, surface étale mais enfoncement garanti et
lame de fond abrasive. Un
texte qui, en un fabuleux et quasi imerceptible exercice de
prestidigitation, retourne plusieurs fois les apparences. Un texte aux
entrés innombrables, aux strates multiples, aux sédiments cachés qui
affleurent sans cesse. (suite)
C'est
un texte tout de langueurs et de volutes pâles et rosées. Un texte
comme tout en écharpes, en bandeaux veloutés de soleil couchant. Tout
en
douceurs pastel et en mélancolie contenue. Un texte trompeur. Traître
et fourbe comme un marécage, surface étale mais enfoncement garanti et
lame de fond abrasive. Un
texte qui, en un fabuleux et quasi imerceptible exercice de
prestidigitation, retourne plusieurs fois les apparences. Un texte aux
entrés innombrables, aux strates multiples, aux sédiments cachés qui
affleurent sans cesse. (suite)
"Le bord du ciel" de Maïca Sanconie (Quidam éditeur)
 Maïca
Sanconie est une orfèvre. De la langue et des sensations. Et, chose
plus rare, des lignes mélodiques qu'elle parvient merveilleusement à
transcrire en mots. C'est
un singulier récit de formation qui
dit la mue d'abord subie puis consentie d'un homme vibrant qui se
réapproprie sa vie. Il
faut savourer chaque page de ce texte car chaque page est une miniature
parfaite, une oeuvre d'art à part entière, un chef-d'oeuvre d'émotion
contenue, de beauté infiniment subtile et ciselée. (suite)
Maïca
Sanconie est une orfèvre. De la langue et des sensations. Et, chose
plus rare, des lignes mélodiques qu'elle parvient merveilleusement à
transcrire en mots. C'est
un singulier récit de formation qui
dit la mue d'abord subie puis consentie d'un homme vibrant qui se
réapproprie sa vie. Il
faut savourer chaque page de ce texte car chaque page est une miniature
parfaite, une oeuvre d'art à part entière, un chef-d'oeuvre d'émotion
contenue, de beauté infiniment subtile et ciselée. (suite)
Annemarie Schwarzenbach : une figure fascinante à découvrir
Deux livres hautement recommandables :
- "Annemarie S. ou les fuites éperdues" de Vinciane Moeschler aux Editions de l'Age d'Homme,
- "Elle, tant aimée" de Melinia G. Mazzucco aux Editions Flammarion..
pages_livres/souviraa.html#ParadesTous deux sont des biographies romancées d'un personnage d'exception, Annemarie Schwarzenbach (suite)
"La mort en Perse" d'Annemarie Schwarzenbach
"La mort en Perse" Annemarie Schwarzenbach, Editions Petite Bibliothèque PAYOT.
"La mort en Perse" est un livre étrange, atypique. A l'image de son auteur, il déconcerte et exerce un charme singulier. Au sens strict du terme, il déroute car le lecteur ne s'y retrouve jamais en terrain connu (suite)
"Les Amis de Bernhard" d'Annemarie Schwarzenbach (Phébus)
 C'est
un livre comme une verrerie délicatement ouvragée et recouverte d'un
glacis précieux. C'est aussi un précis d'adolescence finissante. C'est
si transparent qu'on est ébloui, c'est si transparent qu'on voit tout,
qu'on croit tout pénétrer au premier regard, à la première lecture,
mais la
profondeur est là, qui affleure derrière les mots diaphanes. C'est
un ton, clair et posé, une voix prenante et qui déjà, sous des dehors
cristallins, possède la capacité de diffuser dans le corps des ondes
troubles et troublantes et des secrets
subliminaux. (suite)
C'est
un livre comme une verrerie délicatement ouvragée et recouverte d'un
glacis précieux. C'est aussi un précis d'adolescence finissante. C'est
si transparent qu'on est ébloui, c'est si transparent qu'on voit tout,
qu'on croit tout pénétrer au premier regard, à la première lecture,
mais la
profondeur est là, qui affleure derrière les mots diaphanes. C'est
un ton, clair et posé, une voix prenante et qui déjà, sous des dehors
cristallins, possède la capacité de diffuser dans le corps des ondes
troubles et troublantes et des secrets
subliminaux. (suite)
"Retour à Brooklyn" d'Hubert Selby Jr. (10/18)
C'est un texte qui se referme sur vous comme un piège. Une bombe à retardement mais dont les effets ravageurs se font sentir tout de suite tant ils remplissent et intoxiquent l'atmosphère. C'est la réduction progressive des possibles la strangulation des espoirs à l'oeuvre même au coeur de l'apparente expansion. C'est un mélange explosif d'empathie et de cruauté. C'est une éblouissante réussite. (suite)
"Blouse" d'Antoine Sénanque (Grasset)
Voici l'abrupte confession d'un "médecin malgré lui". Vertigineuse plongée dans l'intimité d'un homme douloureusement familier de ses abîmes. Qui n'a de connaissance que par les gouffres. Un auto-portrait des plus féroces. Le narrateur est neurologue. On suit, chronologiques, les étapes de sa formation puis de sa vie professionnelle.(suite)
"La grande garde" d'Antoine Sénanque
C'est un roman écrit comme une bombe amorcée par un observateur éclairé. C'est un compte à rebours qui fait sauter quelques battements de coeur. C'est prenant et bouleversant de bout en bout. Je ne sais si le médecin qui a commis ce livre est un grand neurologue mais il est sans nul doute un grand styliste. (suite)
"Basse ville" de Jacques Serena (Minuit)
 C'est
un texte bancal et branque. A l'image des personnages plus que
cabossés, erratiques, qui semblent évoluer dans un no man's land,
projection de leur esprit post-apocalyptique où n'ont plus cours aucun
des repères normés qui jalonnent la vie béquillée du commun des
mortels. Deux
paroles lèvent et se déploient en deux monologues alternatifs. On ne
sait pas bien d'où venues ni vers quoi dirigées ni non plus dans quel
milieu elles évoluent. (suite)
C'est
un texte bancal et branque. A l'image des personnages plus que
cabossés, erratiques, qui semblent évoluer dans un no man's land,
projection de leur esprit post-apocalyptique où n'ont plus cours aucun
des repères normés qui jalonnent la vie béquillée du commun des
mortels. Deux
paroles lèvent et se déploient en deux monologues alternatifs. On ne
sait pas bien d'où venues ni vers quoi dirigées ni non plus dans quel
milieu elles évoluent. (suite)
"Plus rien dire sans toi" de Jacques Serena (Minuit)
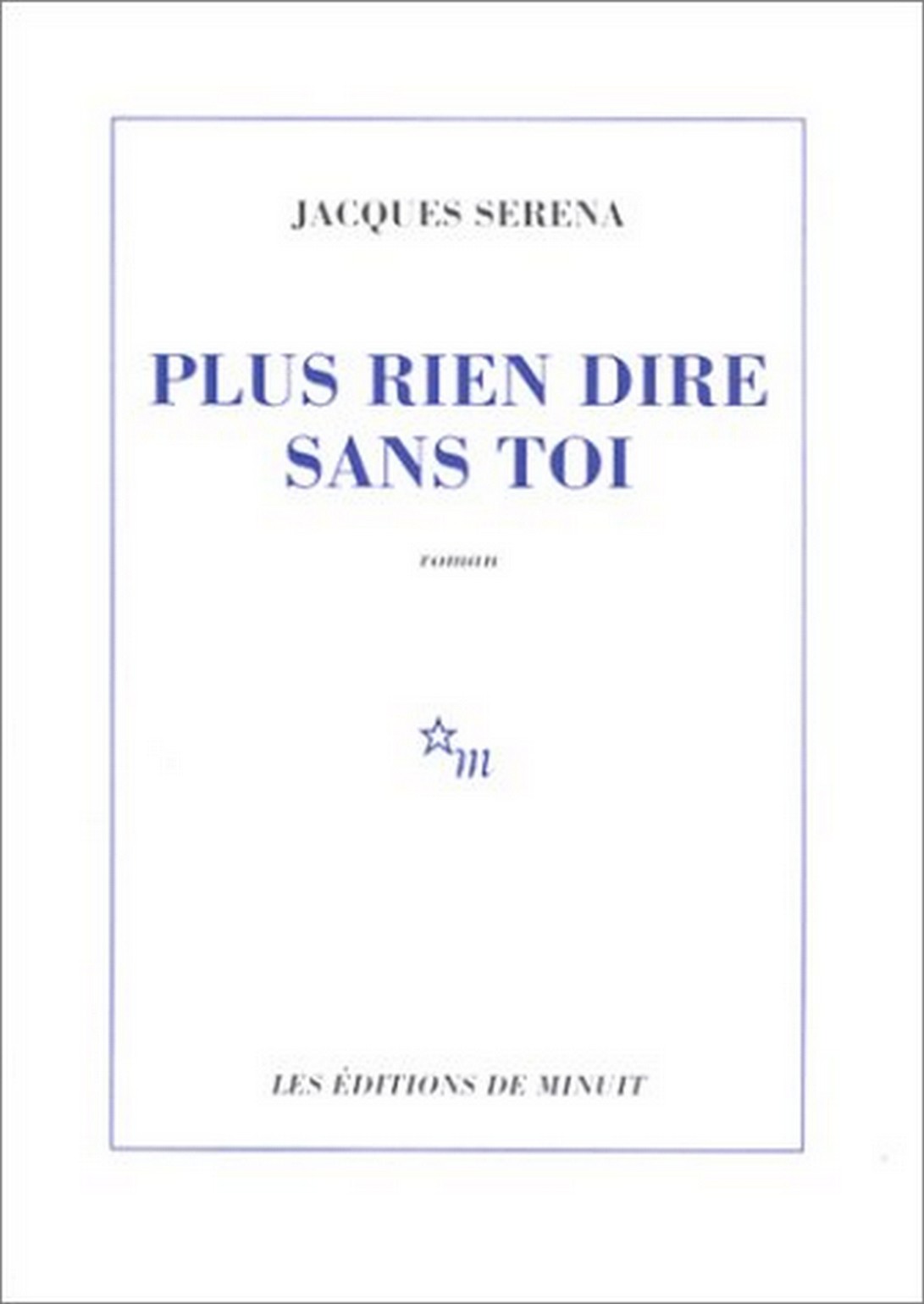 On
ne sait pas où on est. Catapulté sans préambule dans la tête d'un type.
Un type qui déraille. Mais qui déraille avec une froide lucidité. A la
fois collé à son délire et distinct, détaché, observant, démontant et
trafiquant ses propres circuits avec une passion fanatique. Oui, on se
trouve dans un observatoire, un laboratoire psychique et verbal, témoin
privilègié d'une folie organisée - autant qu'organique - dont le
processus est méticuleusement restitué. (suite)
On
ne sait pas où on est. Catapulté sans préambule dans la tête d'un type.
Un type qui déraille. Mais qui déraille avec une froide lucidité. A la
fois collé à son délire et distinct, détaché, observant, démontant et
trafiquant ses propres circuits avec une passion fanatique. Oui, on se
trouve dans un observatoire, un laboratoire psychique et verbal, témoin
privilègié d'une folie organisée - autant qu'organique - dont le
processus est méticuleusement restitué. (suite)
"A la hauteur de Grand Central Station je me suis assise et j'ai pleuré" d'Elizabeth Smart (Les herbes rouges)
C'est un récit qui tient du cri, de la prière, de l'incantation tour à tour exultante ou éperdue. C'est un cantique, une supplique à bout de souffle, une évocation hantée bien plus qu'un récit. Ce sont les transes et les stances d'une femme amoureuse qui élève l'amour au rang d'expérience sacrée. Ce sont des épiphanies et des fulgurances successives qui foudroient jusqu'au fond de l'âme. C'est une mélopée entêtante qui hésite, oscille entre le cri d'extase et le chant d'agonie. (suite)
"L'épouse américaine" de Mario Soldati (Le Promeneur)
 On
pourrait croire qu'on se trouve face à une énième version de
l'archirebattu triangle amoureux (le mari, la femme, l'amante) et c'est
le cas, en vérité, mais Mario Soldati (l'auteur des magnifiques et
mémorables "Lettres de Capri") réussit le tour de force de déjouer
l'attendu, de ne jamais puiser dans ce réservoir à clichés ni glisser
sur la pente du vaudeville. Et comment s'y prend-il pour ce faire
? Il nous présente son héros en état de surprise et même de sidération
continue si bien que nous sommes conduits, nous aussi, à envisager la
situation sous un angle singulier et inédit.(suite)
On
pourrait croire qu'on se trouve face à une énième version de
l'archirebattu triangle amoureux (le mari, la femme, l'amante) et c'est
le cas, en vérité, mais Mario Soldati (l'auteur des magnifiques et
mémorables "Lettres de Capri") réussit le tour de force de déjouer
l'attendu, de ne jamais puiser dans ce réservoir à clichés ni glisser
sur la pente du vaudeville. Et comment s'y prend-il pour ce faire
? Il nous présente son héros en état de surprise et même de sidération
continue si bien que nous sommes conduits, nous aussi, à envisager la
situation sous un angle singulier et inédit.(suite)
"Parades" de Bernard Souviraa (l'Olivier)
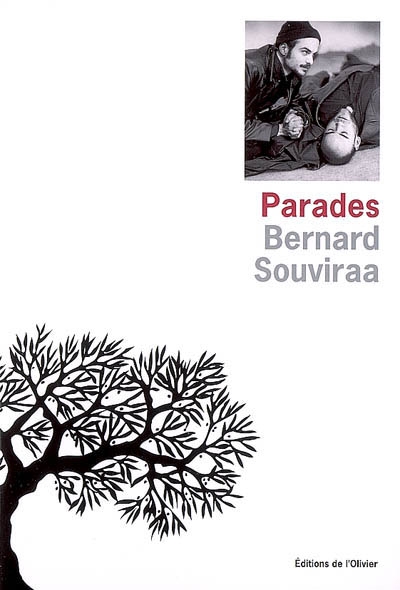 C'est
un récit qui plonge loin dans les racines de la mémoire. Loin non pas
tellement dans le temps mais dans ce qui fonde une personnalité et même
un destin. C'est l'histoire d'une de ces rencontres décisives qui
infléchissent le cours d'une existence, d'une fascination adolescente
qui resurgit vingt ans après avec une violence inouïe. (suite)
C'est
un récit qui plonge loin dans les racines de la mémoire. Loin non pas
tellement dans le temps mais dans ce qui fonde une personnalité et même
un destin. C'est l'histoire d'une de ces rencontres décisives qui
infléchissent le cours d'une existence, d'une fascination adolescente
qui resurgit vingt ans après avec une violence inouïe. (suite)
"Edie" de Jean Stein (Christian Bourgois)
C'est
l'histoire
d'une luxueuse déchéance. La trajectoire météorique d'une gamine
pourrie de dons, comblée de possessions matérielles, socialement
favorisée à outrance. Tout est donné à profusion et cependant le socle
fondateur fait défaut. C'est l'histoire d'une plaie béante qui fleurit
sur un sol trop riche en névroses, chargé de ferments
toxiques. (suite)
"Le livre de l'immaturité" d'Eva Steinitz
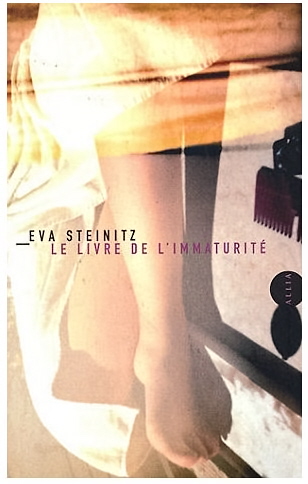 Ce
sont les carnets d'une fille de vingt et un ans, des notes prises sur
le vif qui, assemblées, forment une sorte de parcours initiatique. La
fille vit à Lisbonne, elle y dessine, hante les expositions, les bars,
les soirées. Des rencontres la réchauffent, des voyages l'électrisent,
des amitiés la galvanisent, elle se frotte aux garçons, s'essaie aux
jeux de l'amour et du hasard ... Elle est neuve et elle dit comment la
vie la traverse et la transforme. (suite)
Ce
sont les carnets d'une fille de vingt et un ans, des notes prises sur
le vif qui, assemblées, forment une sorte de parcours initiatique. La
fille vit à Lisbonne, elle y dessine, hante les expositions, les bars,
les soirées. Des rencontres la réchauffent, des voyages l'électrisent,
des amitiés la galvanisent, elle se frotte aux garçons, s'essaie aux
jeux de l'amour et du hasard ... Elle est neuve et elle dit comment la
vie la traverse et la transforme. (suite)
"Le lieu le plus obscur" de Michel Suffran (Maurice Nadeau)
Voici un roman débusqué chez un bouquiniste et qu'il fait bon dépoussiérer. Publié en 1982 chez Maurice Nadeau, ce livre est un kaléidoscope de scènes à la fois tranchées et glissantes qui s'entrechoquent, s'additionnent, se contredisent, avancent en boitant puis se propulsent au loin. Ces fragments nous troublent, nous égarent mais pour mieux nous recentrer sur une urgence, une évidence cruciale : quitter l'enfance, de corps et d'âme, est une perdition sans retour. (suite)
"Petit éloge de la rupture" de Brina Svit (Folio Gallimard)
 Brina
Svit s'est lancée dans une étrange entreprise dont elle explique la
genèse complexe, semée de tribulations, agitée de moult convulsions
morales. Il
paraîtrait que (si toutefois nous sommes suffisamment centrés et
équipés pour) nous allons toujours vers ce qui nous fait le plus peur.
Question d'intensité mais aussi de sens à imprimer à notre terrestre
trajectoire, rapport aussi au nécessaire dépassement. C'est donc parce
qu'elle
croyait redouter au-delà de tout la rupture que Brina Svit s'est
attachée et attaquée à ce motif dont elle décline les différentes
figures explorant les configurations qu'elle a revêtues dans sa propre
vie. (suite)
Brina
Svit s'est lancée dans une étrange entreprise dont elle explique la
genèse complexe, semée de tribulations, agitée de moult convulsions
morales. Il
paraîtrait que (si toutefois nous sommes suffisamment centrés et
équipés pour) nous allons toujours vers ce qui nous fait le plus peur.
Question d'intensité mais aussi de sens à imprimer à notre terrestre
trajectoire, rapport aussi au nécessaire dépassement. C'est donc parce
qu'elle
croyait redouter au-delà de tout la rupture que Brina Svit s'est
attachée et attaquée à ce motif dont elle décline les différentes
figures explorant les configurations qu'elle a revêtues dans sa propre
vie. (suite)
"La mort n'en saura rien" de Georgina Tacou (Melville Léo Scheer)
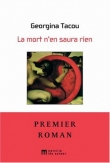 C'est une prose
torrentueuse et syncopée à la fois. Un ovni littéraire comme il est
d'usage, désormais, de nommer les textes qui n'offrent pas de prise ou
d'aspect préfabriqué. C'est une langue cascadée, carambolée, qui
charrie avec un même bonheur fureurs vulcanisées, rageuses explosions
éructées et délicates floraisons poétiques. C'est cru et cruel,
emporté, lyrique, baroque et aussi très rock. C'est de la fièvre
concassée et cadencée, cavalant à fleur d'abîme. (suite)
C'est une prose
torrentueuse et syncopée à la fois. Un ovni littéraire comme il est
d'usage, désormais, de nommer les textes qui n'offrent pas de prise ou
d'aspect préfabriqué. C'est une langue cascadée, carambolée, qui
charrie avec un même bonheur fureurs vulcanisées, rageuses explosions
éructées et délicates floraisons poétiques. C'est cru et cruel,
emporté, lyrique, baroque et aussi très rock. C'est de la fièvre
concassée et cadencée, cavalant à fleur d'abîme. (suite)
"Gordon" d'Edith Templeton (Robert Laffont)
 C'est un livre
vénéneux et
limpide à la fois. Un texte d'une sauvagerie contrôlée, cadenassée par
un style de haute tenue. Un texte d'une grande modernité bien qu'il ait
été publié dans
les années 60 et relate des faits survenus à Londres dans les années de
l'immédiat après-guerre. Un teste auto biographique d'une grande
impudeur. (suite)
C'est un livre
vénéneux et
limpide à la fois. Un texte d'une sauvagerie contrôlée, cadenassée par
un style de haute tenue. Un texte d'une grande modernité bien qu'il ait
été publié dans
les années 60 et relate des faits survenus à Londres dans les années de
l'immédiat après-guerre. Un teste auto biographique d'une grande
impudeur. (suite)
"Crevasse" de Pierre Terzian (Quidam éditeur)
 C'est
un texte séparé et qui, de toutes les manières possibles et par tous
les moyens stylistiques dont il dispose, profère cette séparation.
C'est
une voix des tréfonds, la voix d'un revenu de tout, d'un méconnu de
tous, d'un pourfendu, un déclassé, un oublié de la vie, un mal-vivant,
un laissé pour-compte, un collectionneur du mécomptes, un laissé tout
court, un absolu délaissé. C'est un autre. Un radicalement autre. Un
étranger à tout, même à son propre corps. (suite)
C'est
un texte séparé et qui, de toutes les manières possibles et par tous
les moyens stylistiques dont il dispose, profère cette séparation.
C'est
une voix des tréfonds, la voix d'un revenu de tout, d'un méconnu de
tous, d'un pourfendu, un déclassé, un oublié de la vie, un mal-vivant,
un laissé pour-compte, un collectionneur du mécomptes, un laissé tout
court, un absolu délaissé. C'est un autre. Un radicalement autre. Un
étranger à tout, même à son propre corps. (suite)
"Le plancher de Jeannot" d'Ingrid Thobois
(Buchet-Chastel)
C'est un texte bref, brut, serré comme un coup de poing et assené comme tel. C'est l'histoire d'une femme et d'une famille qui dévore ses enfants. C'est dans une famille paysanne du Béarn à l'époque de la guerre d'Algérie. Il y a Alexandre le père piégeur et saccageur, Joséphine la mère dite la glousse qui tout avale, tout rengorge, y compris les enfants qu'elle a expulsés. Il y a Simone la frondeuse, la belliqueuse, qui ne s'attarde pas au sein de cette famille massacreuse. Et puis Jean (Jeannot) et Paule. Jean est le bras armé de la glousse, l'héritier, le mâle chargé d'apporter compensation et réparation. (suite)
"Sollicciano" d'Ingrid Thobois (Zulma)
 C'est,
par salves
successives, le portrait d'une femme
singulière et sensationnelle. Cette
femme porte, de façon très préméditée, très délibérée, le prénom chargé
de Norma-Jean. Elle enseigne, avec une coupante ferveur, la
philosophie à des étudiants magnétisés, enamourés voire pâmés. C'est
une prof avec des allures et une aura fracassantes d'héroïne frappée
par le sort, élue pour figurer dans la légende. Elle apparaît
donc comme source et réservoir de fantasmes mais il y a quelque chose
en elle de flou, de mal fini qui empêche que la cristallisation ait
lieu. (suite)
C'est,
par salves
successives, le portrait d'une femme
singulière et sensationnelle. Cette
femme porte, de façon très préméditée, très délibérée, le prénom chargé
de Norma-Jean. Elle enseigne, avec une coupante ferveur, la
philosophie à des étudiants magnétisés, enamourés voire pâmés. C'est
une prof avec des allures et une aura fracassantes d'héroïne frappée
par le sort, élue pour figurer dans la légende. Elle apparaît
donc comme source et réservoir de fantasmes mais il y a quelque chose
en elle de flou, de mal fini qui empêche que la cristallisation ait
lieu. (suite)
"Le souffle de l'Harmattan" de Sylvain Trudel (Les Allusifs)
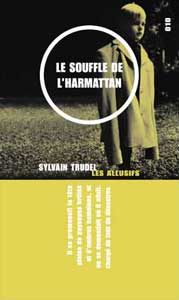 Ce
roman se signale d'abords par sa langue. Dense, inventive, fleurie de
trouvailles inédites et saisissantes. C'est la langue de l'ailleurs, de
l'exil, une langue de haute solitude qui oblige à un surcroît de
créativité. Celui
qui la profère, c'est Hugues, un orphelin qui ne trouve pas dans sa
famille d'accueil de répondant. (suite)
Ce
roman se signale d'abords par sa langue. Dense, inventive, fleurie de
trouvailles inédites et saisissantes. C'est la langue de l'ailleurs, de
l'exil, une langue de haute solitude qui oblige à un surcroît de
créativité. Celui
qui la profère, c'est Hugues, un orphelin qui ne trouve pas dans sa
famille d'accueil de répondant. (suite)
"Les Carnets" de Marina Tsvetaeva (éd. des Syrtes)
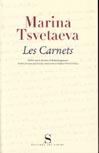 Quand
on entre dans les "Cartnets" de Marina Tsvetaeva, tout autre journal
intime, et quelle que soit sa qualité, est instantanément frappé de
discrédit et même tombe en poussière. Car ces pages ne sont pas des
pages, ces écrits ne sont pas des écrits. C'est
une expérience physique qui frappe au plexus et transperce au plus
profond et laisse étourdi, le coeur gonflé, rempli et vacillant,
dansant sous les étoiles. Ce qui ressort de ces carnets, c'est que
Marina est un monstre au sens mythologique du terme. (suite)
Quand
on entre dans les "Cartnets" de Marina Tsvetaeva, tout autre journal
intime, et quelle que soit sa qualité, est instantanément frappé de
discrédit et même tombe en poussière. Car ces pages ne sont pas des
pages, ces écrits ne sont pas des écrits. C'est
une expérience physique qui frappe au plexus et transperce au plus
profond et laisse étourdi, le coeur gonflé, rempli et vacillant,
dansant sous les étoiles. Ce qui ressort de ces carnets, c'est que
Marina est un monstre au sens mythologique du terme. (suite)
"Vivre dans le feu" de Marina Tsvetaeva (Robert Laffont)
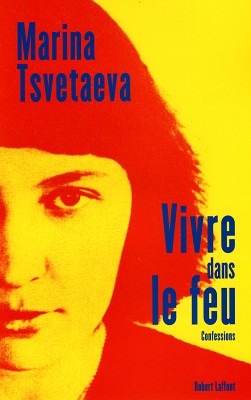 C'est
une femme dont la vie fut une croisade incessante contre toute forme de
médiocrité. Une engagée volontaire sur les chemins de la plus haute
exigence. Une femme qui a brûlé ses vaisseaux sur l'autel de l'absolu.
Une forcenée du verbe. Une affamée d'amour. Une championne de
la démesure. Une athlète de l'âme. Une russe, une vraie de vraie ! Aux
prises avec les convulsions de son temps, elle a traversé
drames historiques et intimes avec une hauteur de vue peu commune. (suite)
C'est
une femme dont la vie fut une croisade incessante contre toute forme de
médiocrité. Une engagée volontaire sur les chemins de la plus haute
exigence. Une femme qui a brûlé ses vaisseaux sur l'autel de l'absolu.
Une forcenée du verbe. Une affamée d'amour. Une championne de
la démesure. Une athlète de l'âme. Une russe, une vraie de vraie ! Aux
prises avec les convulsions de son temps, elle a traversé
drames historiques et intimes avec une hauteur de vue peu commune. (suite)
"Chute libre" d'Emilie de Turckheim (éd. du Rocher)
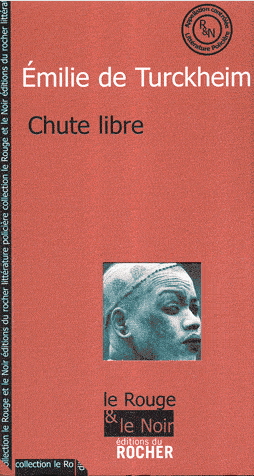 Voici
une fille culottée. C'est son deuxième livre et elle s'attaque au roman
noir sans craindre de s'affranchir des lois du genre. Elle avance en
roue libre, elle fonce allègrement et nous déroute au fil d'une
intrigue drôlement bine troussée. Voici Jean, un homme lige, un
homme ligoté. Son existence ne va pas de soi. Il se répand en
remerciements inopportuns et en excuses intempestives. C'est pour son
innocuité qu'il a été promu, dans le magazine qui l'emploi, au poste de
rédacteur adjoint. (suite)
Voici
une fille culottée. C'est son deuxième livre et elle s'attaque au roman
noir sans craindre de s'affranchir des lois du genre. Elle avance en
roue libre, elle fonce allègrement et nous déroute au fil d'une
intrigue drôlement bine troussée. Voici Jean, un homme lige, un
homme ligoté. Son existence ne va pas de soi. Il se répand en
remerciements inopportuns et en excuses intempestives. C'est pour son
innocuité qu'il a été promu, dans le magazine qui l'emploi, au poste de
rédacteur adjoint. (suite)
"Les oreilles du loup" d'Antonio Ungar (Les Allusifs)
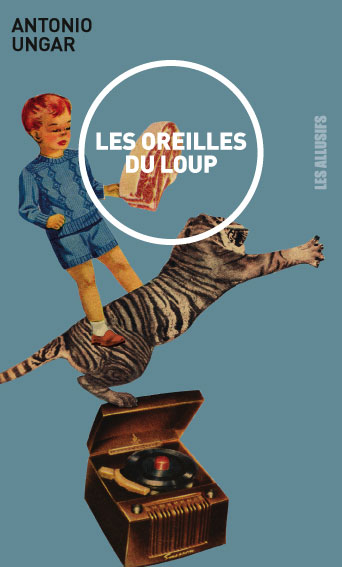 C'est une voix frêle
et
penchée mais aussi fraîche et claire. C'est un petit, tout petit garçon
(il a cinq ans au début du récit, sept à la fin) qui fait
l'apprentissage de la sauvagerie du monde. Il vit entouré de sa mère et
de sa petite soeur, laquelle, à
ses yeux, relève du miracle : maigre, nerveuse, agile, souple,
gracieuse et farouche, elle a tout d'un chat sans en être un et cela ne
laisse pas d'émerveiller notre jeune poète. (suite)
C'est une voix frêle
et
penchée mais aussi fraîche et claire. C'est un petit, tout petit garçon
(il a cinq ans au début du récit, sept à la fin) qui fait
l'apprentissage de la sauvagerie du monde. Il vit entouré de sa mère et
de sa petite soeur, laquelle, à
ses yeux, relève du miracle : maigre, nerveuse, agile, souple,
gracieuse et farouche, elle a tout d'un chat sans en être un et cela ne
laisse pas d'émerveiller notre jeune poète. (suite)
"Forêts noires" de Romain Verger (Quidam éditeur)
 Romain Verger nous
joue,
dans son nouvel ouvrage, un air doux-amer, il nous enrobe dans une
grinçante suavité. Inaugurant
une structutre narrative inédite (une série de courtes proses qui se
répondent et communiquent par capillarité), il nous entraîne à la suite
du narrateur, chercheur en biologie, venu exercer ses talents au Japon,
au pied du Fuji-Yama. Notre homme est maintenu de force en lisière de
la forêt d'Aokigahara où il est censé opérer et la
proximité de cette masse impénétrable l'aimante jusqu'à l'envoûtement
et déclenche en lui des
réminiscences en cascade. (suite)
Romain Verger nous
joue,
dans son nouvel ouvrage, un air doux-amer, il nous enrobe dans une
grinçante suavité. Inaugurant
une structutre narrative inédite (une série de courtes proses qui se
répondent et communiquent par capillarité), il nous entraîne à la suite
du narrateur, chercheur en biologie, venu exercer ses talents au Japon,
au pied du Fuji-Yama. Notre homme est maintenu de force en lisière de
la forêt d'Aokigahara où il est censé opérer et la
proximité de cette masse impénétrable l'aimante jusqu'à l'envoûtement
et déclenche en lui des
réminiscences en cascade. (suite)
"Grande Ourse" de Romain Verger (Quidam)
 C'est
une histoire de corps métaphysique. C'est un texte pareil à une figure
aux arêtes précisément dessinées. Ce ne sont pas les phrases seules qui
sont ciselées mais le corps entier du récit. Le lecteur est projeté
dans un univers pour le moins déconcertant et dépaysant. Car nous voici
d'abord, il y a 35.000 ans, en compagnie d'Arcas, un homme isolé, seul
rescapé des guerres claniques et des épidémies qui ont décimé sa
tribu. (suite)
C'est
une histoire de corps métaphysique. C'est un texte pareil à une figure
aux arêtes précisément dessinées. Ce ne sont pas les phrases seules qui
sont ciselées mais le corps entier du récit. Le lecteur est projeté
dans un univers pour le moins déconcertant et dépaysant. Car nous voici
d'abord, il y a 35.000 ans, en compagnie d'Arcas, un homme isolé, seul
rescapé des guerres claniques et des épidémies qui ont décimé sa
tribu. (suite)
"Les oiseaux" de Tarjei Vesaas (Plein Chant)
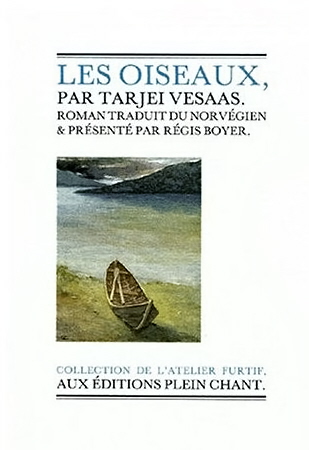 Il s'appelle Mathis
mais on
le surnomme "La Houppette". Il a 37 ans et une altérité qui dérange.
Parce que ses perceptions sont étranges et qu'il use d'un langage qui
lui est propre, on le considère comme un simple d'esprit dans le bourg
norvégien où il vit aux côtés de sa soeur Hege la sage. Hege,
si sensée, si bonne, si commune, tout le monde la plaint et loue son
courage car elle tricote sans relâche, elle est condamnée à travailler
dur pour entretenir son frère qui vagabonde, pour assurer leur
subsistance à tous les deux. (suite)
Il s'appelle Mathis
mais on
le surnomme "La Houppette". Il a 37 ans et une altérité qui dérange.
Parce que ses perceptions sont étranges et qu'il use d'un langage qui
lui est propre, on le considère comme un simple d'esprit dans le bourg
norvégien où il vit aux côtés de sa soeur Hege la sage. Hege,
si sensée, si bonne, si commune, tout le monde la plaint et loue son
courage car elle tricote sans relâche, elle est condamnée à travailler
dur pour entretenir son frère qui vagabonde, pour assurer leur
subsistance à tous les deux. (suite)
"Les Mots pauvres" de Christiane
Veschambre (Cheyne éditeur)
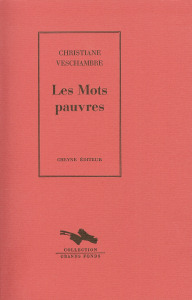 Voici un texte d’une
simplicité
souveraine. Souveraine est la parole qui se dépose sur la page et
souveraine
l’humilité qui préside à cette déposition. C’est un murmure qui
flue, doux,
enveloppant, jamais péremptoire, mais la netteté des phrases,
l’intégrité de la
pensée et l’exigence vers quoi regarde le texte, forcent le respect,
imposent
de relever la tête et de se dresser plus haut que nature. Un événement
déclenche
l’écriture : au commencement, la narratrice perd (sans cause
assignable)
la parole. Mais ce drame inaugural est
déjà rapporté comme à bas bruit, à voix basse, murmurée, sans fracas et
sans
effet. Comme si l’écriture se mettait instantanément au diapason, en
adéquation
avec l’état du corps dont elle rend compte. (suite)
Voici un texte d’une
simplicité
souveraine. Souveraine est la parole qui se dépose sur la page et
souveraine
l’humilité qui préside à cette déposition. C’est un murmure qui
flue, doux,
enveloppant, jamais péremptoire, mais la netteté des phrases,
l’intégrité de la
pensée et l’exigence vers quoi regarde le texte, forcent le respect,
imposent
de relever la tête et de se dresser plus haut que nature. Un événement
déclenche
l’écriture : au commencement, la narratrice perd (sans cause
assignable)
la parole. Mais ce drame inaugural est
déjà rapporté comme à bas bruit, à voix basse, murmurée, sans fracas et
sans
effet. Comme si l’écriture se mettait instantanément au diapason, en
adéquation
avec l’état du corps dont elle rend compte. (suite)
"Ci-gît l’amour fou" d’Ornela
Vorpsi (Actes-Sud)
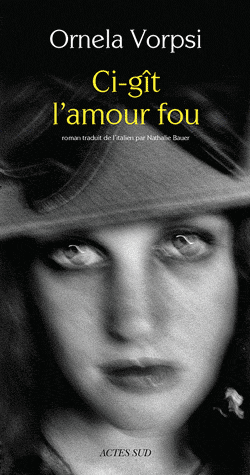 Ornela Vorpsi a une
écriture
sorcière et des dons de voyance, ou, du moins, d’exceptionnelle
pénétration.
Elle vogue, navigue, slalome, voltige entre le dehors et le dedans,
entre réel
et surréel avec une aisance déconcertante. Elle oscille, effectue le
va-et-vient, efface les frontières avec une ébouriffante virtuosité.
Elle possède le rare
pouvoir de
se glisser non pas dans mais sous la peau de ses personnages. Et voici
qu’elle
investit la vie
secrète et pulsatile de Tamar. Tamar est une adolescente, translucide
dont les
contours mal finis ou mal définis ne mordent ni ne tranchent le réel.
Elle traverse
la vie, fantomale, sans jamais parvenir à déposer son empreinte. (suite)
Ornela Vorpsi a une
écriture
sorcière et des dons de voyance, ou, du moins, d’exceptionnelle
pénétration.
Elle vogue, navigue, slalome, voltige entre le dehors et le dedans,
entre réel
et surréel avec une aisance déconcertante. Elle oscille, effectue le
va-et-vient, efface les frontières avec une ébouriffante virtuosité.
Elle possède le rare
pouvoir de
se glisser non pas dans mais sous la peau de ses personnages. Et voici
qu’elle
investit la vie
secrète et pulsatile de Tamar. Tamar est une adolescente, translucide
dont les
contours mal finis ou mal définis ne mordent ni ne tranchent le réel.
Elle traverse
la vie, fantomale, sans jamais parvenir à déposer son empreinte. (suite)
"Nos mères" d'Antoine Wauters (Verdier)
 Antoine Wauters est
un poète
vibrant qui nous offre ici un récit d'une frémissante sensibilité
parcouru
d'ondes sourdement sismiques. C'est un récit d'une saisissante
étrangeté mais
une étrangeté distillée au fil d'une narration si fluide qu'elle en
devient
presque insoupçonnable. Le narrateur est un
enfant profus
appelé à naviguer entre plusieurs mères contre (dans toutes les
acceptations du
terme) lesquelles il s'édifie et se définit. Le premier volet se
déroule dans
une ville quelconque du Proche-Orient. La guerre fait rage et, son père
étant
mort, l'enfant est percuté simultanément par les mitrailles répétées et
par les
tentatives d'encerclement, d'enveloppement strangulatoire que sa mère,
chaque
jour réitère.(suite)
Antoine Wauters est
un poète
vibrant qui nous offre ici un récit d'une frémissante sensibilité
parcouru
d'ondes sourdement sismiques. C'est un récit d'une saisissante
étrangeté mais
une étrangeté distillée au fil d'une narration si fluide qu'elle en
devient
presque insoupçonnable. Le narrateur est un
enfant profus
appelé à naviguer entre plusieurs mères contre (dans toutes les
acceptations du
terme) lesquelles il s'édifie et se définit. Le premier volet se
déroule dans
une ville quelconque du Proche-Orient. La guerre fait rage et, son père
étant
mort, l'enfant est percuté simultanément par les mitrailles répétées et
par les
tentatives d'encerclement, d'enveloppement strangulatoire que sa mère,
chaque
jour réitère.(suite)
"Ali si on veut" de Ben Arès - Antoine Wauters
(Cheyne éditeur)
 C'est une langue de limon, de
sulfures, de failles
et
brûlures. Une langue qui soulève, fouaille, brasse, bouillonne, broie
et
foisonne. Une écriture d'épines et de musc, de pavane et de castagne,
de
gouaille déferlée, de verve torrentueuse et de silence rêche. Ce sont
des instantanés qui acquièrent un
caractère intemporel. Des prélèvements, des
prises, des rafles d'un présent dont l'épaisseur excède de loin la
seule saisie
de l'instant. Ce sont les moments d'Ali, jeune transfuge, nouvel Ulysse
à la
tête d'une transhumance, d'une odyssée de sève, de feu, de songes très
charnus,
très odorants. Ce sont des mots d'écorché, arrachés à la glèbe
originelle, ce
sont des phrases écourtées, écorcées, convulsées et contractées,
catapultées en
rafales. (suite)
C'est une langue de limon, de
sulfures, de failles
et
brûlures. Une langue qui soulève, fouaille, brasse, bouillonne, broie
et
foisonne. Une écriture d'épines et de musc, de pavane et de castagne,
de
gouaille déferlée, de verve torrentueuse et de silence rêche. Ce sont
des instantanés qui acquièrent un
caractère intemporel. Des prélèvements, des
prises, des rafles d'un présent dont l'épaisseur excède de loin la
seule saisie
de l'instant. Ce sont les moments d'Ali, jeune transfuge, nouvel Ulysse
à la
tête d'une transhumance, d'une odyssée de sève, de feu, de songes très
charnus,
très odorants. Ce sont des mots d'écorché, arrachés à la glèbe
originelle, ce
sont des phrases écourtées, écorcées, convulsées et contractées,
catapultées en
rafales. (suite)
"Césarine de nuit" d'Antoine Wauters (Cheyne
éditeur)
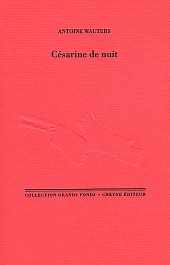 C'est un bloc
météorique chu sur
chaque page. Un bloc de temps et de vie crue. Un bloc, aussi, coulée
galvanique, de langue corsée, radiante, furieuse. Ce sont des
personnages comme
des astres, un texte comme la trajectoire d'une comète. Mais les astres
sont
veinés,
irrigués de sombre. Les astres sont calcinés et, même, en voie de
carbonisation. Ce sont des créatures animales et célestes et c'est
peut-être
dans leur animalité que leur beauté culmine. Et la nuit est celle
qui tombe
sur deux enfants. Ils sont deux, frère
et sœur,
gémellaires et soudés sang à sang et chair à chair, bien plus loin et
plus
profond qu'il n'est admis. (suite)
C'est un bloc
météorique chu sur
chaque page. Un bloc de temps et de vie crue. Un bloc, aussi, coulée
galvanique, de langue corsée, radiante, furieuse. Ce sont des
personnages comme
des astres, un texte comme la trajectoire d'une comète. Mais les astres
sont
veinés,
irrigués de sombre. Les astres sont calcinés et, même, en voie de
carbonisation. Ce sont des créatures animales et célestes et c'est
peut-être
dans leur animalité que leur beauté culmine. Et la nuit est celle
qui tombe
sur deux enfants. Ils sont deux, frère
et sœur,
gémellaires et soudés sang à sang et chair à chair, bien plus loin et
plus
profond qu'il n'est admis. (suite)
"L’amour sans visage" d’Hélène Waysbord (Christian
Bourgois)
 Hélène Waysbord est
une orfèvre.
De la vie et des mots. Elle cisèle les heures, les drames, l’indicible
et les
phrases avec la même extrême délicatesse. Avec un sens implacable de la
beauté. Le temps est éclaté
et la langue,
pareillement, se diffracte en une multitude d’éclats prismatiques. Il
appartient au lecteur de restituer le sens comme la chronologie et
c’est une
opération des plus captivantes. C’est l'histoire
d’une perte
originelle incompensable et d’une réappropriation progressive qui
advient au
terme d’une quête tissée de cris rengorgés, d’impacts invisibles et
qui,
cependant, ponctionnent et vident peu à peu tout le sang. Et toute la
sève. (suite)
Hélène Waysbord est
une orfèvre.
De la vie et des mots. Elle cisèle les heures, les drames, l’indicible
et les
phrases avec la même extrême délicatesse. Avec un sens implacable de la
beauté. Le temps est éclaté
et la langue,
pareillement, se diffracte en une multitude d’éclats prismatiques. Il
appartient au lecteur de restituer le sens comme la chronologie et
c’est une
opération des plus captivantes. C’est l'histoire
d’une perte
originelle incompensable et d’une réappropriation progressive qui
advient au
terme d’une quête tissée de cris rengorgés, d’impacts invisibles et
qui,
cependant, ponctionnent et vident peu à peu tout le sang. Et toute la
sève. (suite)
"Le roman de Thomas Lilienstein" de Laurence Werner David (Buchet-Chastel)
 C'est
un texte ciselé très au-dessus du niveau de la mer, dans la tessiture
d'une voix haut tenue, dans la matière même des songes ou presque.
C'est
une quête menée au nom de l'amour mais qui prend tout de suite des
allures de composition poétique et abstraite, d'élaboration raffinée et
diffractée. C'est
donc le roman de Thomas Lilienstein tel qu'il est rêvé, et presque
halluciné, par Mikel, la jeune femme qui l'aime et le cherche et le
traque partout y compris quand il se trouve à ses côtés. (suite)
C'est
un texte ciselé très au-dessus du niveau de la mer, dans la tessiture
d'une voix haut tenue, dans la matière même des songes ou presque.
C'est
une quête menée au nom de l'amour mais qui prend tout de suite des
allures de composition poétique et abstraite, d'élaboration raffinée et
diffractée. C'est
donc le roman de Thomas Lilienstein tel qu'il est rêvé, et presque
halluciné, par Mikel, la jeune femme qui l'aime et le cherche et le
traque partout y compris quand il se trouve à ses côtés. (suite)
"Terre légère" de Claire Wolniewicz (Viviane Hamy)
C'est une
succession
de voix qui prennent du volume, de l'ampleur et aussi s'affûtent,
s'aiguisent comme autant d'instruments de précision à mesure que le
texte évolue. C'est un voyage qui déclenche le mouvement et le roulis
des âmes qui s'auscultent.C'est une réunion de famille presque
aléatoire, presque improvisée et qui se tient, suspendue dans l'espace,
à l'autre bout du monde (suite)
"Ici et à jamais" de Sue Woolfe (Phébus)
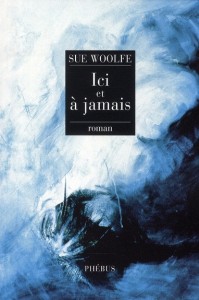 C'est
l'histoire d'un ravage. D'une possession. D'un père et de sa fille mais
funestement par le crime et par l'art. C'est une lutte à mort, un duel
qui emporte tout. Le père donne la vie, donne l'art et les reprend dans
le même mouvement. Le père est peintre, assez renommé et autocrate
redoutable.
Au début, la fille qui est aussi la narratrice a également une mère :
elle est douce, belle, talentueuse et entièrement assujettie.
(suite)
C'est
l'histoire d'un ravage. D'une possession. D'un père et de sa fille mais
funestement par le crime et par l'art. C'est une lutte à mort, un duel
qui emporte tout. Le père donne la vie, donne l'art et les reprend dans
le même mouvement. Le père est peintre, assez renommé et autocrate
redoutable.
Au début, la fille qui est aussi la narratrice a également une mère :
elle est douce, belle, talentueuse et entièrement assujettie.
(suite)
"Irène, Nestor et la vérité" de Catherine
Ysmal
(Quidam éditeur)
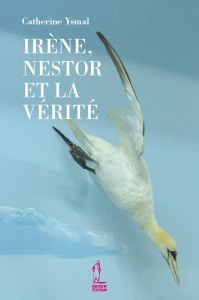 C’est un texte qui
herse,
fouaille, extirpe, sabre sans retenue. Un texte qui corsète, sangle,
harnache,
tenaille, sectionne et l’air se raréfie à mesure. C’est un texte qui,
dans un même
mouvement, vous soulève de terre et vous y précipite, étourdi, défait
par KO. Un texte qui broie
une matière
monstre et tellurique, un texte tout d'ondes sismiques qui plonge les
mains
dans l’humus, l’originel et le malpropre. Ce sont des voix,
trois voix
distinctes, juxtaposées, mais qui s’entrelardent et interfèrent tout le
temps. C’est la
traditionnelle
triangulation si ce n’est qu’entre le mari et la femme, ce n’est pas
l’amant
qui s’interpose, mais l’ami. Et l’époux a beau nourrir une certaine
suspicion
quant aux rapports entre sa femme et leur ami commun, ce n’est pas la
jalousie
amoureuse qui est le ressort principal du récit. (suite)
C’est un texte qui
herse,
fouaille, extirpe, sabre sans retenue. Un texte qui corsète, sangle,
harnache,
tenaille, sectionne et l’air se raréfie à mesure. C’est un texte qui,
dans un même
mouvement, vous soulève de terre et vous y précipite, étourdi, défait
par KO. Un texte qui broie
une matière
monstre et tellurique, un texte tout d'ondes sismiques qui plonge les
mains
dans l’humus, l’originel et le malpropre. Ce sont des voix,
trois voix
distinctes, juxtaposées, mais qui s’entrelardent et interfèrent tout le
temps. C’est la
traditionnelle
triangulation si ce n’est qu’entre le mari et la femme, ce n’est pas
l’amant
qui s’interpose, mais l’ami. Et l’époux a beau nourrir une certaine
suspicion
quant aux rapports entre sa femme et leur ami commun, ce n’est pas la
jalousie
amoureuse qui est le ressort principal du récit. (suite)
"La Fille sans qualités" de Juli Zeh
 Ada
surclasse tellement les autres qu'elle s'ennuie à mourir. Seul le
professeur d'histoire, en homme d'une intelligence supérieure, trouve
grâce à ses yeux. Ada
s'étiole insensiblement jusqu'à
l'arrivée, dans sa classe et dans sa vie, d'Alev. Alev est d'origine
cosmopolite et il est le double, la part manquante, la part maudite
d'Ada. Il sera à la fois catalyseur et détonateur. (suite)
Ada
surclasse tellement les autres qu'elle s'ennuie à mourir. Seul le
professeur d'histoire, en homme d'une intelligence supérieure, trouve
grâce à ses yeux. Ada
s'étiole insensiblement jusqu'à
l'arrivée, dans sa classe et dans sa vie, d'Alev. Alev est d'origine
cosmopolite et il est le double, la part manquante, la part maudite
d'Ada. Il sera à la fois catalyseur et détonateur. (suite)
"Une syllabe, battant de bois" de Mary-Laure Zoss (Cheyne éditeur)
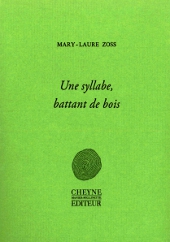 Mary-Laure Zoss est une
redoutable ensorceleuse, une sorcière qui concocte son brouet addictif.
Mais
elle opère avec des armes tout à fait insolites. Elle séduit, envoûte à
contre-courant, à rebrousse-poil, à coups de cravache, de fouettée
d'orties, de
sécateur. Ses phrases se hérissent et sabrent au fil d'escarpements et
selon
une progression sinueuse. Et cependant la magie, rêche et sans
concession,
opère et, très vite, on ne peut plus s'arracher à cette entêtante
mélopée. C'est une voix qui
joue du
dédoublement, qui s'adresse, au choix, au même ou à l'autre. Une voix
qui
intime, somme, profère des formules en forme de sentences mais qui sont
tout
sauf des poncifs. (suite)
Mary-Laure Zoss est une
redoutable ensorceleuse, une sorcière qui concocte son brouet addictif.
Mais
elle opère avec des armes tout à fait insolites. Elle séduit, envoûte à
contre-courant, à rebrousse-poil, à coups de cravache, de fouettée
d'orties, de
sécateur. Ses phrases se hérissent et sabrent au fil d'escarpements et
selon
une progression sinueuse. Et cependant la magie, rêche et sans
concession,
opère et, très vite, on ne peut plus s'arracher à cette entêtante
mélopée. C'est une voix qui
joue du
dédoublement, qui s'adresse, au choix, au même ou à l'autre. Une voix
qui
intime, somme, profère des formules en forme de sentences mais qui sont
tout
sauf des poncifs. (suite)