Livres-Addict.fr
David Bosc par Livres-Addict.fr
"Milo" de David Bosc (Allia)
Sauf
que c'est fautif parce que cela n'épuise de loin pas la substance du
texte. Sauf que cela ne résume pas le texte qui, d'ailleurs, ne se
résume pas. Il
est question de rupture, donc, et de lente recomposition. Si ce n'est
que le renouement avec la campagne s'effectue d'abord aussi sous le
signe de la rupture, dans le sentiment de la perte et le fracas d'une
solitude hantée. Car
Milo est étranger chez lui et rien ne lui est moins familier que cette
maison de famille qu'il réinvestit. Maison du reste en piteux état
qu'il va s'employer à rendre moins délabrée. La réfection extérieure,
tangible, s'accompagne d'un vaste chantier intérieur : Milo rendu,
revenu à lui-même, entreprend de se renover, de se revirginiser. Ce
renouvellement passe par le corps qu'il faut plier à des gestes neufs,
frotter à des moeurs inusitées. Pour autant, il ne s'agit pas du
rebattu "retour aux sources" ou à l'état de pure nature. C'est à un
combat qu'on assiste. Mené par Milo contre lui-même et contre
l'altérité redécouverte. Y compris celle qu'il recèle. Milo
fait aussi l'expérience du temps redevenu sensible. Il se colette avec
la matière, avec l'élément, l'élémentaire. Mais cela n'a rien d'une
révélation : c'est un lent ravaudage et c'est d'abord une perdition un
égarement, Milo se dépouille, s'élague et, bien sûr, cela ne va pas
sans douleur. Il
finit aussi par sortir de sa retraite forcée, sa forteresse de
désespoir. Il se frotte aux autochtones et aux "étrangers", à ceux qui
partagent le même espace. La vieille Emilie qui se prend pour lui
d'affection et le nourrit de ses mets de son babil. Il fréquente,
fantomatique, décalé, le seul café, rade perdu du soin où les frustes
saisonniers viennent ravitailler leur âme béante de paroles éventées. Et
puis il devient l'observateur sismographe d'une bande de vibrants
adolescents. Il enregistre leurs rituels, leurs manèges, les rapports
de force ou de séduction qui les régissent. Il se laisse frôler,
charmer un peu par de diaphanes jeunes filles au parler vert et rude. Milo,
notant, ébahi, les moeurs des gens du cru, est un Candide, un Persan
réinventé. Puis il retourne à sa solitude qui le sculpte. Ce texte est
un recueil et un recel sensoriel. Un réseau de sensations à vif qui
s'éclairent progressivement par capillarité et produisent de la lumière. La
langue est onduleuse, intrépide, toujours surprenante, elle est une
mine de jaillissements crus et de pépites poétiques. C'est une langue
neuve, une langue de rupture et d'hommage, une incantation souvent
hypnotique, un régal. BH
10/09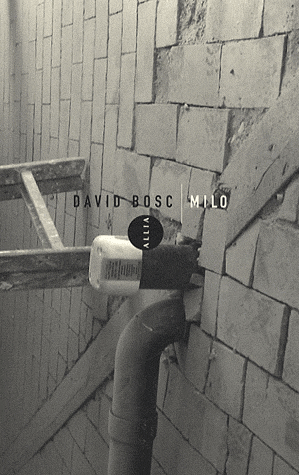 David
Bosc a inventé un genre. Ou il a écrit un récit inclassable. Mais la
première hypothèse est plus excitante. On pourrait croire que ce
singulier tissage qu'il a réalisé ressortit au récit poétique mais
c'est bien plus complexe que cela. Il s'agit d'un texte situé en
contrebas et à l'envers du récit normé et amarré. Un exode inversé. Un
retour amont sur les lieux rustiques, élémentaires de l'enfance
campagnarde. On pourrait avancer qu'il y a un héros, un personnage,
Milo qui, à l'aube de la quarantaine et à la suite d'une rupture
amoureuse, quitte la ville de ses déboires, réintègre la campagne de
ses jeunes années et que ce texte est le récit de cette réimmersion, de
cet apprentissage tardif, de cette étreinte longtemps différée avec les
origines.
David
Bosc a inventé un genre. Ou il a écrit un récit inclassable. Mais la
première hypothèse est plus excitante. On pourrait croire que ce
singulier tissage qu'il a réalisé ressortit au récit poétique mais
c'est bien plus complexe que cela. Il s'agit d'un texte situé en
contrebas et à l'envers du récit normé et amarré. Un exode inversé. Un
retour amont sur les lieux rustiques, élémentaires de l'enfance
campagnarde. On pourrait avancer qu'il y a un héros, un personnage,
Milo qui, à l'aube de la quarantaine et à la suite d'une rupture
amoureuse, quitte la ville de ses déboires, réintègre la campagne de
ses jeunes années et que ce texte est le récit de cette réimmersion, de
cet apprentissage tardif, de cette étreinte longtemps différée avec les
origines.